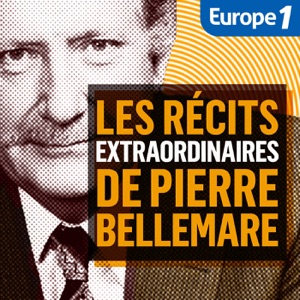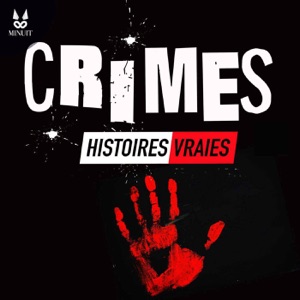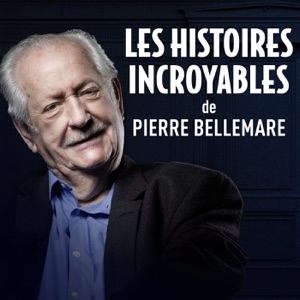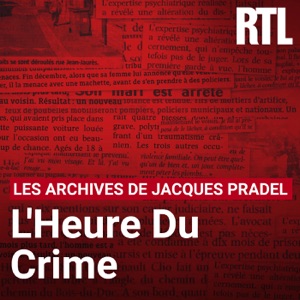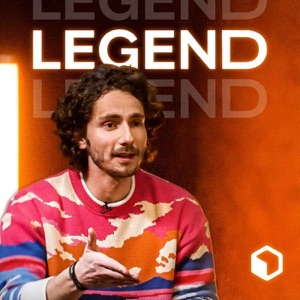Podcasts by Category

- 968 - «Les jeunes Africains sont emprisonnés chez eux», selon le chanteur sénégalais Lass
Lass est un chanteur attachant, ancré dans la tradition musicale de l’Afrique de l’Ouest, inspiré par les grands orchestres mais qui sait aussi teinter sa musique d’influences modernes et de rythmes électroniques. Il vient de publier son deuxième album, Passeport, l’occasion d’évoquer avec lui les attentes des nouvelles générations dans son pays, le Sénégal.
À lire aussiLe juste équilibre de Lass, entre influences afro et sonorités électro
Sat, 01 Jun 2024 - 967 - «La Libye joue le rôle de plateforme logistique pour la Russie» en Afrique, selon le collectif «All Eyes on Wagner»
La Libye, plus que jamais porte d'entrée de la Russie sur le continent africain. Selon plusieurs observateurs dont le collectif « All Eyes on Wagner », la Russie augmente depuis plusieurs mois sa présence dans des ports comme Syrte ou Tobrouk pour débarquer armes et militaires. Une stratégie qui atteste l'idée que Moscou et les supplétifs d'Africa Corps (ex-Wagner) ont bien décidé de renforcer leurs positions en Afrique du Nord et au Sahel. Lou Osborn du collectif « All Eyes on Wagner » est notre invité ce matin.
RFI : En ce moment, vos yeux sont particulièrement tournés vers la Libye. Depuis quelques mois, on constate un accroissement des livraisons d'armes et de débarquement d'hommes en provenance de Russie. Où ont lieu ces débarquements et quel est le but supposé ?
Lou Osborn : La première chose, c'est qu’une partie de ces combattants qui arrivent est, après, renvoyée dans les nouveaux territoires occupés par African Corps : le Niger et le Burkina Faso. Dans ce sens-là, la Libye joue le rôle de plateforme logistique pour les opérations de la Russie. C'était déjà le rôle que la Libye avait à un moment donné pour le groupe Wagner. Donc, ils remettent ça en route. La deuxième chose, c'est qu'une partie des combattants reste, à priori, en Libye. Mais la Russie a pour projet d'établir une base navale qui lui mettrait les pieds dans la Méditerranée.
Sur des emprises portuaires entre Syrte, en Libye, et Port-Soudan côté Soudanais, est-ce qu’il y a une volonté de trouver des accès portuaires, un débouché sur la mer, et à quoi correspondrait cette stratégie ?
Clairement, aujourd'hui - et je pense plus sur la Libye que sur le Soudan -, ça crée une espèce de couloir avec la Syrie, évidemment. Aussi, on a vu que toute la partie golfe persique était aussi dérangée par ce qui se passait avec le Yémen - les Houthis - et donc, derrière, un petit peu, la main de l'Iran. Quelque part, ça crée un couloir qui est assez intéressant pour les Russes avec une voie maritime qu’ils peuvent contrôler. Ça crée aussi des nouveaux points de pression sur le front occidental. Quand ils auront cette base navale en Libye, ils vont être directement en face de l'Europe. Cela sert à plusieurs choses.
Est-ce qu’il y a encore un distinguo entre les mercenaires d’Africa Corps et les autorités officielles, et - question subsidiaire : beaucoup de membres d’Africa Corps affichent encore des blasons Wagner sur leurs uniformes, est-ce un mélange des genres, une confusion, ou tout cela est en fait la même entité ?
C'est un peu la question à un million de dollars en ce moment ! La distinction n’est pas encore très claire et, aujourd'hui d'ailleurs, on remarque déjà que les pays employeurs, par exemple la Centrafrique, le Mali, le Burkina, le Niger, continuent à parler d'« instructeurs russes ». Eux, sont assez cohérents dans leur appellation. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un petit groupe de Wagner historique qui serait toujours en train de faire leurs propres affaires, plutôt en Centrafrique. Depuis la mort d’Evgueni Prigojine, il y a eu une volonté de reprise des activités du groupe Wagner et de les mettre sous contrôle, notamment du renseignement militaire russe, le GRU. Mais il reste très compliqué de vraiment distinguer qui est chez qui, qui fait quoi ? Cela étant, Wagner reste une « marque » qui a encore beaucoup de succès et qui pèse beaucoup, donc ils ne l’ont pas complètement détruite. D'ailleurs, cela serait stupide, car Wagner a une histoire, une légende, ses codes, etc. Finalement, ça crée de la cohésion et de l'envie d'aller travailler pour ce type de structure.
L'Iran et la Turquie, en conjugaison, en bonne intelligence avec la Russie, trouvent aussi des intérêts dans cette inversion, ce chamboulement des équilibres en Afrique ?
Sur l'Iran, aujourd'hui, on dirait qu'il y a plus une convergence d'intérêt. On voit, par exemple, qu'il y a un certain nombre de dirigeants qui vont d'abord rencontrer les Russes pour amener par la suite des discussions avec des dirigeants iraniens. Il y a cette convergence-là. Cependant, sur la Turquie, on voit plutôt une espèce d'opposition. Déjà en Libye, le gouvernement de Tripoli est historiquement plutôt soutenu par la Turquie, alors que les territoires du maréchal Haftar, c'est plutôt la Russie. Aujourd'hui, on voit l’arrivée sur une partie du Sahel d’une autre organisation paramilitaire qui s'appelle Sadat, qui est Turque, qui est déjà présente en Libye depuis plusieurs années et qui assurerait la sécurité d'officiels au Mali, alors qu'une autre partie des officiels est plutôt sécurisée par Wagner. Ils seraient aussi en train d'arriver au Niger. Là, grosse question, parce qu'ils vont se regarder en chiens de faïence, et ce n'est pas dit que ça soit forcément voulu.
Visiblement, les soldes versées aux mercenaires turcs sont d'un niveau inférieur à celles versées à Wagner. Cela veut dire que les Russes ne sont plus les seuls acteurs dans le mercenariat africain ?
C'est la première fois qu'on les voit arriver, plutôt sur la partie Sahel. Mais là où, à mon sens, il y a un avantage, c'est que la Turquie est aussi très active économiquement sur le continent. Aujourd’hui, elle est, peut-être, légèrement meilleure, un peu plus compétitive, voire possède de meilleures positions que la Russie. En tout cas, cela crée une nouvelle alternative ou un autre choix.
À lire aussi«Le groupe Wagner en Afrique apporte principalement du soutien aux gouvernements en place»
Fri, 31 May 2024 - 966 - RDC: «Réchauffement climatique, El Niño, déforestation sont les causes des averses et inondations»
El Niño est-il responsable des pluies torrentielles qui s'abattent sur l'Afrique de l'Est ? La question divise les spécialistes. Voici le point de vue du professeur congolais Jean-Pierre Djibu, qui dirige au Katanga l'Observatoire régional de changement climatique et qui enseigne à l'université de Lubumbashi. Selon lui, les averses ne viennent pas directement d'El Niño, dans l'océan Pacifique, mais d'une réplique de ce phénomène climatique au niveau de l'immense lac Tanganyika. D'où les très graves inondations à Kaliémie. En ligne de Lubumbashi, le climatologue congolais répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
RFI : Comment expliquez-vous ces pluies torrentielles qui s’abattent sur les provinces du Tanganyika et du Sud-Kivu ?
Jean-Pierre Djibu :Quand on prend le lac Tanganyika, c’est un lac de plus de 700 kilomètres de long et de 70 kilomètres de large, pratiquement 35 000 km² de superficie – l’équivalent d’un État comme la Belgique. Mais, ce lac draine un bassin de plus de 250 000 km² au niveau de quatre pays que sont le Burundi, la République démocratique du Congo (RDC), la Zambie et la Tanzanie. Alors, parmi les causes naturelles, il faut comprendre que, à l’allure où va le réchauffement de la partie superficielle du lac, il y a un risque, éventuellement, que la température augmente jusqu’à trois degrés d'ici à la fin du XXIe siècle. Et plus la température augmente à la surface du lac, plus on constate que le comportement se produit comme un phénomène El Niño. Bien sûr que ce phénomène se produit dans l’Océan, mais il est maintenant reflété au niveau du lac, parce qu’il s’agit d’un grand lac, qui couvre une grande superficie. La partie superficielle étant réchauffée, les eaux profondes étant beaucoup plus froides, qu’est-ce qui se passe ? Il y a une grande évaporation et une grande augmentation d’évaporation qui va rendre l’atmosphère humide. Toute la région devient humide et il y a une forte formation de nuages, ce que l’on appelle les cumulonimbus. On a des précipitations d’averses avec une certaine agressivité. C’est vraiment la toute première fois depuis 2013 qu’on a eu le niveau du lac qui a augmenté de 276 à 293 mètres, ce qui est une grande quantité.
Ce réchauffement des eaux à la surface du lac, à quoi est-il dû ?
Il est dû au réchauffement climatique.
Donc, on aurait affaire à l’addition de deux phénomènes : le réchauffement climatique, plus El Niño ?
Exactement. Avec le facteur aggravant qui est le facteur anthropique, la déforestation.
Et la surpopulation sur les berges ?
La surpopulation et l’aménagement anarchique de terrains, l’occupation anarchique du bassin du lac.
Donc, le phénomène El Niño, ce n’est pas simplement dans l’Océan Pacifique, c’est aussi sur le lac Tanganyika ?
Exactement. Nous avons, aujourd’hui, avec le réchauffement climatique, tout ceci qui a provoqué le phénomène El Niño au niveau de la plupart des lacs africains, mais c’est spécialement le lac Tanganyika qui devient indicateur dans cette tendance. Parce que les études faites nous montrent qu’il y a quelque chose qui est en train d’être modifié au niveau du comportement, en ce qui concerne le cycle de l’eau dans ce lac.
Est-ce que le même phénomène se produit au niveau du lac Victoria, plus au nord ?
Exactement, cela se fait de la même manière.
Ce phénomène El Niñosur le lac Tanganyika, est-ce qui s’est déjà produit au XIXe siècle ou au XXe siècle ?
Oui, au XVIIIe siècle, on a connu des fortes inondations au niveau du lac Tanganyika. Même au XXe siècle, on a connu [ce type d’inondations]. Mais, là, nous avons une particularité : le niveau d’eau, par rapport aux mesures déjà connues, pendant une longue période, est beaucoup plus élevé. On est arrivé à 793 mètres, ce qui est très élevé au niveau de la quantité d’eau qui a été augmentée.
793 mètres… Et cela, c’est un niveau exceptionnel ?
C’est un niveau exceptionnel, oui. Avant, le bassin du lac Tanganyika n’était pas un bassin aménagé. Ce sont là qu’interviennent des causes anthropiques. Actuellement, c’est un bassin qui a été loti, aménagé. Il y a des constructions, des villes, des maisons, des routes, des cultures… Il s’agit de lits [de rivière]. Et, malheureusement, ces lits ont été aménagés de manière quasiment anarchique, sans respecter les normes au niveau de l’environnement. C’est pourquoi nous avons des catastrophes qui sont liées aux activités anthropiques.
Lors de la précédente montée du lac Tanganyika en 2021, Madame la ministre de l’Environnement, Ève Bazaiba, dénonçait déjà l’occupation anarchique des berges du lac et des rivières. Est-ce que des mesures ont-été prises depuis trois ans ?
Non, aucune mesure. Normalement, dans des situations comme cela, on est censé prendre des mesures draconiennes ! Parce qu’il y avait déjà un avertissement, il y a plus de dix ans. Un avertissement sur le réchauffement superficiel des eaux du lac Tanganyika, lié au réchauffement climatique, avec le risque éventuel des inondations extrêmes. Mais, malheureusement, aucune mesure n’a été prise à ce niveau-là.
Par ailleurs, la construction de digues avait été annoncée ces dernières années, pour limiter la montée des eaux. Est-ce que ces digues ont été construites ?
C’est une solution sans valeur, parce que la meilleure des façons est de combiner des solutions. C’est-à-dire, même si on peut construire des digues éventuellement, on doit faire de la reforestation parce que tout le bassin du lac Tanganyika a été complètement déforesté. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de végétation et lorsqu’il n’y a pas de végétation, il n’y a plus de moyens de rétention afin de pouvoir garder l’eau et permettre l’infiltration. Ce qui se passe, c’est le ruissellement, et ce ruissellement est accompagné d’érosion. Donc, il faut combiner la construction de digues, ce qui doit être vraiment accessoire, avec le reboisement du bassin du lac. S’il faut reboiser le bassin du lac, ce n’est pas simplement se contenter de la partie congolaise ! Le bassin du lac, il comprend l’ensemble des quatre pays. La Zambie, la Tanzanie, le Burundi et la RDC. Cela signifierait qu’il faudrait des efforts communs entre les quatre pays. Même si on arrivait, également, à reforester, il faut passer par l’étape où l’on délocaliserait les personnes. On ne peut reforester que l’endroit qui n’est pas occupé. Or, tout le bassin, plus de 60%, est pratiquement aménagé. Il faudrait arriver à délocaliser les personnes avant de pouvoir faire le reboisement.
Mais, pour déménager ces personnes, il faut leur trouver de nouveaux emplacements et cela est très difficile, j’imagine…
Évidemment, c’est un autre aspect. Il y a quand même l’espace pour essayer de délocaliser les populations et les mettre à l’abri. Je crois que les quatre pays, dont la RDC, ont suffisamment d’espace pour ce genre de choses. Parce que ces catastrophes ont créé beaucoup de conséquences, il y a eu beaucoup de morts par inondations, que ça soit à Kalémie, à Uvira, à Kigoma… À Uvira, on a eu énormément de morts !
Autre phénomène, à quelques centaines de kilomètres plus au sud, en Zambie, où les populations sont touchées par une sécheresse exceptionnelle. Comment expliquez-vous qu’il pleuve beaucoup au Congo-Kinshasa et pas du tout en Zambie ?
Le phénomène El Niño fait les deux à la fois ! Soit une augmentation de température sur une surface d’eau, comme je l’ai dit sur les grands lacs, occupant une grande superficie et provoquant la formation de cumulonimbus, de nuages de précipitations, et on a des averses dans cette zone. Soit, en Zambie, il n’y a pas de lac, donc on a un sol qui se réchauffe et avec l’évaporation, il n’y a pas suffisamment d’humidité dans l’atmosphère et nous avons une sécheresse. Cette sécheresse est liée aussi au phénomène El Niño. Ça fait les deux ! Cela provoque soit les inondations, les fortes précipitations, soit également de fortes sécheresses. Cela est aggravé, également, par le désert de Namib qui a tendance à avancer vers le nord, donc en poussant vers l’Angola et la Zambie.
D’où le paradoxe El Niño, des pluies au Congo et la sécheresse en Zambie.
Exactement.
Est-ce que les autorités politiques de ces deux pays ont pris conscience de la gravité de ce phénomène climatique ?
Non ! C’est un autre aspect. En Zambie, ils sont en train de réfléchir en ce qui concerne les conséquences sur le plan de la sécurité alimentaire, sur le plan de la santé, parce que plus il fait chaud, plus il y a la prolifération de nouvelles maladies qui sont liées à des pandémies, liées à des virus qui ont tendance à vouloir muter génétiquement et à s’adapter à des conditions beaucoup plus extrêmes. Là, au moins, ils réfléchissent sur la sécurité sanitaire et la sécurité alimentaire. Bon, pas de manière aussi poussée, en RDC, nous avons l’impression que l’on en parle, qu’il y a de bonnes intentions, mais ça s’arrête là, il n’y a jamais de suivi !
À lire aussiInondations en RDC: «Aujourd'hui, la ville de Kalemie est coupée en deux»
Thu, 30 May 2024 - 965 - Matata Ponyo (RDC): «Les malédictions des institutions et du leadership sont les vraies causes du retard économique»
Quelle est la vraie cause du retard économique de la République démocratique du Congo ? Ce n'est ni le climat tropical, ni le poids des traditions, ni ce qu'on appelle la « malédiction des ressources naturelles », affirme l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon, qui publie Économie politique des malédictions du développement aux éditions Bruylant. Les vraies causes, dit-il, tiennent à des institutions fragiles et à un leadership défaillant. De passage à Paris, l'opposant congolais, qui a dirigé le gouvernement de 2012 à 2016 et qui vient d'être élu député national aux législatives du 20 décembre, répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
RFI : Les évènements meurtriers du 19 mai, à Kinshasa, est-ce qui s’agit, selon vous, d’une tentative de coup d’État ou d’une tentative d’assassinat ?
Matata Ponyo Mapon :Il est, pour moi, difficile d’affirmer qu’il s’agit d’une tentative de coup d’État. Une tentative de coup d’État vise à mettre fin au pouvoir d’un chef d’État. Alors que, dans le cas d’espèce, on a vu que cette tentative a visé plutôt la résidence d’un ex-ministre de l’Économie, d’un député devenu président de l’Assemblée nationale depuis la semaine dernière. Je crois que ce n’est pas, au sens propre, un coup d’État.
Quand son domicile a été attaqué, Vital Kamérhé n’avait pas encore été élu président de l’Assemblée nationale. Plusieurs partis de la coalition présidentielle de l’Union sacrée espéraient encore pouvoir l’empêcher de prendre le perchoir. Peut-il y avoir un lien entre l’attaque de son domicile et cette compétition pour le perchoir ?
Beaucoup de gens spéculent sur cette relation. Mais, moi, en tant que professionnel de la politique, je crois qu’il faut laisser les conclusions de l’enquête pouvoir déterminer quels types de relations existent entre cette tentative d’élimination physique et son élection au perchoir de l’Assemblée nationale.
Mais cela ne va pas créer un climat de méfiance au sein de la coalition présidentielle ?
Il va sans dire que cela va, effectivement, affecter le climat de confiance. Ce type de situation est de nature à créer des tensions entre les opérateurs politiques, parce que la méfiance va pouvoir s’installer et les gens seront appelés à devenir beaucoup plus prudents. Je pense qu’il y a moyen de pouvoir plaider pour une certaine détente politique.
Vous venez de publier, avec Jean-Paul K. Tsasa, Économie politique des malédictions du Développement aux éditions Bruylant. Un livre dans lequel vous partez en guerre contre les idées reçues sur le sous-développement. Quelles sont ces idées reçues ?
La première théorie essaye d’expliquer la relation qui existe entre la localisation géographique, ou le climat, et le développement. C’est ce que nous avons qualifié de la malédiction « climat », ou l’explication du sous-développement par la localisation géographique.
Et par le climat tropical.
Et par le climat tropical.
Mais c’est une fausse explication ?
Cette thèse, pour nous, n’est pas suffisante. Elle paraît cohérente, mais nous la classons comme étant une analyse qui n’est pas très approfondie. Pourquoi ? Parce que nous voyons, en ce qui concerne le pays à climat tropical, qu’il y en a qui sont avancés : le Brésil, par exemple.
Deuxième explication possible du sous-développement, dites-vous, celle que vous appelez le « binôme culture-race ».
Là aussi, nous avons essayé d’examiner. Parce qu’il y a des études théoriques et empiriques qui affirment que la culture et la race peuvent expliquer le sous-développement ! Nous prenons le cas des deux Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Deux pays qui ont la même culture, qui ont la même race, mais la Corée du Sud est, de loin, plus avancée que la Corée du Nord. Là aussi, la race et la culture ne sont pas en mesure d’expliquer de manière tout à fait fondamentale les différentiels de développement.
Troisième explication possible du sous-développement, dites-vous, la malédiction des ressources naturelles, mais, là aussi, vous n’y croyez pas ?
Non, c’est ce que l’on appelle le « paradoxe de l’abondance », c’est-à-dire que les ressources naturelles pourraient expliquer un certain sous-développement, comme la République démocratique du Congo qui est un exemple typique. Mais, laissez-moi vous dire qu’il y a beaucoup de pays qui ont des ressources naturelles, comme le Botswana, qui sont avancés. Si nous montons au nord, vous avez la Norvège, qui est un pays qui a beaucoup de ressources. Les États-Unis aussi ont des ressources, le Canada… Mais ces pays ne sont pas pour autant sous-développés.
Alors, quelle est, d’après-vous, la vraie cause du sous-développement d’un pays comme le vôtre ?
Peut-être, avant d’arriver à la vraie cause, peut-être que je pourrais évoquer cette malédiction du Fonds monétaire international (FMI). Parce que certaines études théoriques et empiriques essayent de dire que tous les pays qui ont été en programme avec le FMI affichent des croissances très faibles. Mais là aussi, l’étude que nous avons développée démontre cette insuffisance, ce n’est pas une cause suffisante !
Alors, quelle est la vraie cause ?
Les vraies causes, ce sont ce que nous avons appelé les malédictions des institutions et les malédictions de leadership. Ce que nous pouvons considérer comme les vraies causes du sous-développement parce que l’étude, qui a été menée notamment par Douglass North, Daron Acemoglu et James Robinson, montre que les institutions de qualité expliquent le progrès et le développement.
C’est ce que disait Barack Obama dans un célèbre discours au Ghana en juillet 2009, « l’Afrique n’a pas besoin d’hommes forts, mais d’institutions fortes ».
Oui, d’institutions fortes ! Les institutions de faible qualité entrainent le sous-développement. Les institutions de qualité, celles dont a parlé Obama, favorisent la bonne gouvernance, l’État de droit, la promotion du secteur privé. Mais, cette malédiction des institutions, elle ne nous paraît aussi pas très fondamentale. La malédiction de leadership, c’est celle qui explique la malédiction des institutions. Pourquoi ? Parce que les institutions sont créées par les hommes. Ce sont les hommes qui produisent les institutions de qualité ou les institutions de faible qualité.
Donc, vous allez plus loin qu’Obama, vous dites qu’il ne peut pas y avoir de bonnes institutions sans de bons leaders ?
Effectivement. Parce que, avec le temps, le leadership n’a plus la même vigueur. Ce sont les hommes qui produisent les bonnes institutions, qui les consolident et qui les solidifient.
Y a-t-il eu, dans l’histoire de votre pays, la République démocratique du Congo, des leaders compétents ?
Dans ce livre, nous essayons de démontrer, par rapport à la malédiction du Fonds monétaire international, que, entre 2012 et 2016 – j’étais Premier ministre – un leadership de qualité a permis de produire des institutions de qualité, qui ont permis d’avoir un taux de croissance moyen sur cinq ans de 7,7% contre une moyenne de 3,5% pour l’ensemble du continent africain !
Et, en dehors de vous-même, Matata Ponyo Mapon, y a-t-il eu dans l’histoire du Congo un Premier ministre, voire un président compétent ?
Bien sûr, le Premier ministre Patrice Lumumba, je crois que c’est un homme de valeur, malheureusement le Premier ministre Lumumba n’a pas eu le temps de travailler longtemps, il est mort, comme vous le savez, lors de l’accès de notre pays à l’indépendance.
Y a-t-il, dans l’histoire de l’Afrique, un président ou un Premier ministre qui a montré ses compétences de leader ces dernières années ?
Je crois que nous avons plusieurs pays… L’Éthiopie, dont le Premier ministre a reçu le prix Nobel en 2019. Vous avez une entreprise publique de transport aérien comme Ethiopian Airlines qui fait la fierté du continent africain. Cela, c’est le produit d’un leadership de qualité.
C’est le seul pays que vous donneriez en exemple sur le Continent ? Parce qu’il est très contesté, vous le savez, sur le plan des Droits de l’homme, notamment depuis la guerre civile avec le Tigré.
Vous savez, sur cette question-là, il faut plutôt analyser les choses globalement. Même le meilleur leadership ne manque pas de faiblesses…
L’une des conditions d’un bon leadership, c’est, dites-vous, l’intégrité, le refus de toute corruption. Or, vous-même, vous êtes accusé, en ce moment, par la justice congolaise, d’être impliqué dans le détournement de quelque 115 millions d’euros d’argent public, c’était lors du lancement du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. À l’époque, vous étiez le Premier ministre du président Joseph Kabila. Le procès doit s’ouvrir à Kinshasa le 22 juillet. Qu’est-ce que vous répondez à vos accusateurs ?
Écoutez, un leader se crée des ennemis et des adversaires farouches. Tout le monde le sait, que ce projet était porteur d’espoir pour le peuple congolais. C’est un projet qui avait l’ambition de révolutionner le secteur agricole, de garantir, pendant dix ans, une certaine autosuffisance alimentaire. Nous avons lancé ce projet de parc agro-industriel dont le point d’inflexion, c’est-à-dire le point où le coût de production devait être égal aux ventes, c’est-à-dire que les recettes devaient équivaloir aux coûts de production, c’était dans les cinq ans. Avant ces cinq ans, ce projet devait être financé par le gouvernement. Et c’est ce que nous avons essayé de faire. Par souci de gouvernance, nous avons confié ce projet, dans un partenariat public-privé, à une entreprise professionnelle sud-africaine, qui a reconnu avoir reçu tous les fonds et qui a témoigné par écrit n’avoir remis aucun dollar à quelqu’un du gouvernement congolais et encore moins au Premier ministre. Ces écrits ont été certifiés par des autorités compétentes sud-africaines. Mais comment pouvez-vous poursuivre un Premier ministre qui n’a jamais été impliqué, ni de loin, ni de près, à la gestion de ce projet ? Pour votre information, ce procès est plutôt politique. Pour avoir refusé d’intégrer l’Union sacrée, c’est-à-dire d’approcher la famille présidentielle, on m’a promis ce procès ! Mais ce procès, c’est quand même un déni de la démocratie dans notre pays, un déni de la justice ! Parce que la Constitution congolaise ne permet pas de poursuivre un ancien Premier ministre ! Mais, malheureusement, la Constitution, qui est au-dessus de tout le monde, est violée systématiquement.
Et si ce procès s’ouvre, comme prévu, le 22 juillet, vous serez présent au tribunal ?
Je n’ai jamais fui ! Cela fait trois ans que ce procès m’a été intenté pour avoir refusé d’intégrer l’Union sacrée. L’exil m’a été offert, j’ai refusé de m’exiler. Je serai dans mon pays et je demanderai que la Constitution soit respectée. J’espère que ces poursuites vont pouvoir s’arrêter parce que la raison principale, c’est que j’ai refusé d’intégrer l’Union sacrée. Le président a été élu, je crois que ce feuilleton de mauvais augure va pouvoir s’arrêter.
À la présidentielle de décembre dernier, vous avez d’abord été candidat. Puis, vous vous êtes ralliés à la candidature de Moïse Katumbi. Aujourd’hui, vous êtes député national, vous avez été élu à Kindu dans le Maniema avec l’un des meilleurs scores enregistrés aux législatives du 20 décembre dernier. Vous allez vous situer où, du côté de l’opposition ou du côté de la majorité ?
C’est très bien de le rappeler, je suis l’un des meilleurs élus de la République démocratique du Congo, compte tenu de mon attachement à cette ville natale de Kindu. Je dois vous dire, en toute sincérité, la volonté de ceux qui m’ont élu de rester dans l’opposition. Donc, je vais demeurer dans l’opposition.
Wed, 29 May 2024 - 964 - Présidentielle en Côte d’Ivoire: «Sans ambiguïté notre candidat s’appelle Alassane Ouattara» (RHDP)
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara est le « candidat naturel» du parti au pouvoir en vue de la présidentielle de l'année prochaine, a annoncé lundi 27 mai le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Pourquoi ce choix, alors qu'Alassane Ouattara, 82 ans, est déjà en train d'effectuer un troisième mandat présidentiel ? Et où en sont les relations Ouattara-Soro ? Mamadou Touré est le ministre de la Promotion de la jeunesse et le porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien. De passage à Paris où il vient de participer au salon Vivatech, il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
RFI : La présidentielle ivoirienne est dans 15 mois. Alors, Mamadou Touré, comment se prépare le parti au pouvoir, le RHDP ?
Mamadou Touré : Sans ambiguïté, notre candidat s'appelle Alassane Ouattara. Nous sommes en train d'achever la restructuration du parti et le parti est en ordre de bataille pour remporter cette élection présidentielle dans 15 mois, dès le premier tour, fort du bilan positif que nous avons, fort des actions positives qui ont été menées en faveur des populations et puis fort des résultats obtenus il y a un an lors des élections locales qui, pour nous, étaient des élections intermédiaires – où le RHDP a raflé la majorité des sièges et surtout la majorité des voix.
Mais êtes-vous certain qu’Alassane Ouattara va accepter la proposition que vous allez lui faire ?
Le Président n'a pas encore répondu à notre demande, mais ce qui est clair, sans ambiguïté, c'est que le RHDP, toutes les instances du parti, les cadres du parti et les militants du parti, estiment qu’Alassane Ouattara a encore beaucoup à apporter à ce pays. Et, dans un contexte national, sous-régional, mondial, aussi difficile, il a le leadership nécessaire pour conduire encore ce pays vers des lendemains meilleurs.
Le président Ouattara n'est plus tout jeune. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le RHDP devrait rajeunir ses cadres et investir un candidat plus jeune ?
Mais le RHDP a rajeuni ses cadres. Regardez, en comparaison à tous les autres partis politiques, les cadres ont été rajeunis au sein du RHDP de par la volonté politique du président Ouattara. Le rajeunissement des cadres dans un parti politique diffère du choix du candidat à l'élection présidentielle. Le choix du candidat à l’élection présidentielle, c'est avoir le meilleur poulain qui permet de rassembler le parti, le mettre en ordre de bataille, gagner l'élection présidentielle. Et cela, ce n'est pas une question d'âge, sinon, le président américain [Joe Biden], à 82 ans, ne serait pas candidat à sa propre succession, c'est une question de leadership et de capacité à rassembler sa famille politique et à fédérer les Ivoiriens pour gagner l’élection présidentielle. Et nous assumons qu'aujourd'hui, la meilleure personne qui remplit toutes ces conditions, c’est le président Alassane Ouattara. Et puis, aujourd'hui, l'enjeu pour notre pays, c’est un enjeu de stabilité. Vous savez, il ne faut pas regarder les choses simplement intra-Côte d'Ivoire, la Côte d’Ivoire doit être dans un ensemble sous-régional. On sait tous ce qui se passe aujourd'hui, on a besoin d'un chef qui peut garantir sa stabilité.
Alors dans l'opposition, du côté du PPA-CI, c'est Laurent Gbagbo qui vient d'être investi. Le problème, c'est que l'ancien président ivoirien n'est pas amnistié et reste donc inéligible. Est-ce que son amnistie est envisageable ?
Sur la question de l'amnistie, il est quand même curieux que – puisque l'amnistie est une loi qui passe au Parlement – le PPA-CI, qui a des députés à l'Assemblée nationale, n'ait jamais pris l'initiative d'une loi d’amnistie pour son propre candidat. C'est curieux. Donc le président Ouattara n'a aucun moyen aujourd'hui d'amnistier Laurent Gbagbo. Et le PPA-CI pourrait aussi initier un projet de loi à soumettre à l'Assemblée nationale.
Le PPA-CI demande à être reçu par le Premier ministre, est-ce que cette audience serait possible ?
Nous avons des institutions qui fonctionnent normalement. Le dialogue n'a jamais été rompu. Mais après, la question est de savoir : est-ce que, pour cette préoccupation du PPA-CI par rapport à une candidature de Laurent Gbagbo, la Primature est l'institution la plus indiquée ? Je pense que le PPA-CI sait qu'il y a des questions de justice, il y a des questions liées au processus électoral, et nous avons des institutions en charge de régler ces questions.
Autre adversaire du président Ouattara, son ancien Premier ministre, Guillaume Soro, qui vit en exil depuis 5 ans. Les deux personnalités, Alassane Ouattara et Guillaume Soro, ont échangé deux coups de téléphone fin mars, est-ce le signe de la réconciliation ?
Guillaume Soro a pris l'initiative d'appeler le président Alassane Ouattara pour lui présenter ses excuses pour les torts qu'il a pu lui causer et, en même temps, lui dire merci pour la libération de certains détenus proches de lui. Certains ont vu en cela un acte allant dans le sens d'un apaisement. Mais encore faut-il que les autres actes, en dehors de ce coup de fil, aillent dans ce sens. Ce que nous recherchons, c'est la sincérité dans les actes posés. Le président Ouattara a montré sa disposition à faire avancer ce pays et à consolider la paix. D'ailleurs, à la faveur de la CAN de janvier 2024, beaucoup de détenus militaires ou proches de l'opposition ont été libérés. Maintenant, il faut que chacun soit sincère dans les actes posés.
Vous doutez de la sincérité de Guillaume Soro. Cela veut-il dire que vous n'avez pas confiance en lui ?
Ce n’est pas mon opinion qui compte. Mais beaucoup d'observateurs considèrent qu'on ne peut pas la nuit demander pardon et la journée se mettre dans des activités subversives, ou avoir des propos à travers ses collaborateurs pour salir la réputation du président, etc. Et donc les actes posés par les plus proches collaborateurs ne sont pas en adéquation avec le coup de fil qui a été passé. Et cela amène à s'interroger.
Tue, 28 May 2024 - 963 - Procès de l’attaque terroriste d'In Amenas: «Nous attendons des réponses que nous n’avons pas à ce jour»
Ce 27 mai s’ouvre à Alger, le procès de quatre présumés terroristes, accusés du massacre d’In Amenas, dans le Sahara algérien. En janvier 2013, 38 employés avaient été tués sur ce site gazier par une colonne armée venue de Libye et commandée à distance par le chef terroriste Mokhtar Belmokhtar. Vingt-neuf assaillants avaient été abattus par l’armée algérienne. Parmi les employés internationaux tués dans cette attaque, il y avait le logisticien français Yann Desjeux. Aujourd’hui, sa sœur et son petit-frère sont à Alger pour assister au procès en tant que partie civile. Entretien avec Marie-Claude Desjeux.
RFI : Qu'est-ce que vous attendez de ce procès à Alger ?
Marie-Claude Desjeux : Nous attendons des réponses que nous n'avons pas encore eues à ce jour. La question qui est primordiale, c'est celle de tenter d'avoir la réponse définitive sur le lieu exact de la mort de mon frère Yann.
Et votre frère était retenu en otage par les terroristes, c'est ça ?
Tout à fait. Il a été retenu en otage. L'attaque a eu lieu vers 05h40 le mercredi 16 janvier [2013] au matin.
Et a-t-il été tué en même temps que les autres otages ?
C'est la question que nous ne connaissons pas, puisque nous avons eu des témoignages. Je sais qu'il y a eu deux nuits, en tous les cas les nuits du mercredi au jeudi et du jeudi au vendredi, où il a été attaché dos à dos avec un rescapé, qui est un Irlandais qui s'appelle Stephen McFaul, que nous sommes allés rencontrer en Angleterre et qui nous a dit que ces deux jours-là, il était avec lui. Ensuite, ils ont été mis dans le fameux convoi qui devait repartir sur la Libye.
Le convoi des terroristes ?
Le convoi des terroristes qui avait mis à bord les otages rescapés, puisque l'objectif était de retourner en Libye et de réclamer des rançons. Et Stephen McFaul a été mis dans un 4x4 différent de celui de mon frère, et il perd sa trace à ce moment-là.
Et on sait que ce convoi organisé par les ravisseurs est attaqué par les forces de sécurité algériennes…
Tout à fait. Ils ont été attaqués par des hélicoptères, plusieurs véhicules ont été brûlés. Et Stephen McFaul nous a bien confirmé que les hélicoptères tiraient du haut sur le convoi. Et Stephen McFaul, pour une raison qu'on ne connaît pas – d'ailleurs, il en est resté tellement traumatisé qu’il est dans un état épouvantable –, c'est quasiment le seul rescapé et il a vécu l'enfer.
On a longtemps soupçonné l'Algérie de ne pas dire toute la vérité sur l'issue de l'attaque d’In Amenas. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui de la part d'Alger un effort de transparence ?
On espère. Je serais tentée de vous dire que nous partons confiants. Nous sommes heureux de pouvoir aller jusqu'à Alger. Ça a été un peu à la force du poignet pour être très franche, mais nous y sommes arrivés grâce au concours des autorités françaises et de l'Algérie qui nous a accordé ces visas. Donc, on voit en cela quelque chose de positif et nous espérons effectivement y trouver les dernières réponses qui nous manquent.
Dans le box des accusés, il devrait y avoir, à partir de ce lundi, quatre présumés terroristes. Est-ce que vous avez des précisions sur leur identité ?
Alors, il y a le fameux Derouiche qui sera dans le box et qui, lui, a eu un rôle très actif et qui était un proche de Mokhtar Belmokhtar.
Qu'est-ce que vous attendez de ce dénommé Derouiche et des autres terroristes présumés ?
Écoutez, j'aimerais lui poser la question de savoir s'il a croisé mon frère. J'aimerais savoir où il a été tué. C'est quand même incroyable que, sur tous les otages qui ont été relevés sur place, il n'y en ait qu'un sur lequel nous n'avons pas d’informations.
Il y a beaucoup d'informations sur les autres otages tués, mais pas sur votre frère ?
Non, pas sur mon frère.
Mais lors des événements de 2013, vous avez pu aller une première fois à Alger pour identifier le corps de votre frère…
Oui, tout à fait, et son cercueil a été rouvert en France, où il y a eu une autopsie qui a donné comme précision qu’il avait été tué de neuf projectiles. Je vais être très franche, j'ai vu les photos de l'autopsie, c'est un carnage. Et il y a toute l'analyse des balles, des projectiles qui ont été utilisés, qui sont des projectiles de kalachnikov. Mais voilà, nous, on aura toujours un grand doute, c'est finalement de savoir par qui a-t-il été tué ? Par les terroristes ou par l'armée algérienne ? Ça ne changera rien à la finalité, mais c'est vrai que c'était une question qu'on s'est posée.
Le chef du groupe terroriste qui a attaqué In Amenas, c'était Mokhtar Belmokhtar, qui, lui-même, a été tué deux ans et demi plus tard dans le bombardement par des avions occidentaux de sa base de repli dans le désert libyen. Est-ce que vous regrettez sa mort ?
Pas du tout. Je n'ai pas de sentiment de haine. Enfin, je dis « je », mais c'est ma famille. Nous n'avons ni un sentiment de haine, ni un sentiment de vengeance. Donc, je vais dire que je ne m’appesantis pas sur son sort. De même que m'a été posée la question par des amis proches qui m'ont dit, « tu vas à un procès où la peine de mort existe ». Oui, mais je ne rentre pas dans ce débat-là. Moi, je viens d'un pays où la peine de mort a été abolie. Je ne vais pas me réjouir d'une peine de mort potentielle dans un autre pays, mais j'avoue que ça n'est pas mon sujet en y allant.
À lire aussiAlgérie: 11 ans après, le procès de l’attaque terroriste d'In Amenas s’ouvre à Alger
Mon, 27 May 2024 - 962 - Niger: «Près de 9 mois après le coup d'État, la population a besoin de solutions concrètes»
Rendez-vous manqué dimanche dernier à Agadez pour les militants panafricanistes Kémi Séba et Nathalie Yamb, et pour le ministre porte-parole du gouvernement. Le meeting qu’ils devaient y tenir a été annulé la veille au soir, car, selon plusieurs sources, la population ne souhaitait pas les recevoir. Pourquoi cette marque de défiance ? Est-ce le signe que le régime militaire est moins populaire qu’il le prétend dans cette région du Niger ? Entretien avec le journaliste nigérien Seidik Abba, président du Centre international d’études et de réflexions sur le Sahel.
Sat, 25 May 2024 - 961 - Me Bourdon: «Le cadastre de Dubaï illustre les acquisitions immobilières des kleptocrates africains»
Comment évaluer la fortune immobilière d'un certain nombre de personnalités africaines ? Tout simplement en se procurant le cadastre de l'Émirat de Dubaï, s'est dit un think tank américain, « Center for Advanced Defense Studies ». En France, c'est le journal Le Mondequi a publié la semaine dernière le fruit de cette enquête. On découvre ainsi le patrimoine immobilier des proches de plusieurs chefs d'État africains, notamment du Congolais Denis Sassou Nguesso et du Gabonais Ali Bongo. L'avocat français William Bourdon a fondé l'ONG Sherpa. Il y a six mois, il a publié Sur le fil de la défense, aux éditions du Cherche-Midi. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
RFI : Que retenez-vous de l’enquête « Dubai unlocked », qui a été publiée la semaine dernière par le journal Le Monde et qui s'appuie sur l'examen du cadastre de Dubaï, et donc sur l'identité des propriétaires africains de centaines de villas et appartements situés dans cet émirat ?
William Bourdon : Tout le monde sait depuis des années et des années que tous les chemins mènent à Dubaï. Je veux dire que tous les chemins empruntés par l'argent illicite, une grande partie des chemins, mènent à Dubaï, qui est devenu le territoire au monde le plus bardé de dispositifs anticorruption, de lois anti-blanchiment, affichant une modernité étincelante. Et il est en même temps le territoire que l'on peut assimiler à une machine à laver l'argent sale, tout à fait exceptionnelle et sophistiquée. Donc, il était tout à fait normal que les relevés de cadastres trahissent et illustrent la multiplication d'acquisitions immobilières par des oligarques, des kleptocrates, venus d'Afrique ou d'ailleurs.
À lire aussiLe patrimoine de chefs d'État africains à Dubaï révélé par une enquête de médias internationaux
On voit la trace de Dubaï dans un certain nombre de dossiers judiciaires. On voit la trace de Dubaï dans le dossier des biens mal acquis en France, où j'interviens en qualité d'avocat de Transparency international France. Mais on voit aussi l'impuissance des juges européens, et notamment des juges français, à obtenir quelque coopération que ce soit des autorités émiraties. Vous vous souvenez de la déception des policiers et des procureurs français, quand ils avaient obtenu l'arrestation de suspects de grande criminalité organisée, face à la décision des juges émiratis de les remettre en liberté. Donc, c'est un pays qui reste une forme de paradis judiciaire pour les plus grands voyous de la planète, qu'il s’agisse de voyous de sang ou de voyous d'argent.
Parmi les personnes citées par cette enquête réalisée par le think tankaméricain « Centre for Advanced Defense Studies », il y a plusieurs personnalités du Congo-Brazzaville, dont Nathalie Boumba Pembe, qui est originaire du Congo Kinshasa et qui est l'épouse de Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et fils du président Sassou Nguesso. En 2018, elle aurait acquis à Dubaï une villa de quelque 700 m² pour 3,5 millions d'euros. Votre réaction ?
Ce n’est pas du tout une surprise. Denis Christel Sassou Nguesso est l’un des personnages sans doute clé de l'instruction des biens mal acquis en France, même si, pour l'instant, il n'a pas été mis en examen. Ce n'est pas du tout une surprise. Denis Christel et son épouse sont répertoriés, y compris aux États-Unis où il y a eu des mesures de saisie très importantes qui ont été prises sur son patrimoine.
À lire aussi«Biens mal acquis»: «Le Canard enchaîné» révèle de nouveaux éléments contre Denis Christel Sassou-Nguesso
Donc, Dubaï était naturellement pour eux une destination qui ne pouvait pas gommer les arbitrages qu'ils font chaque jour pour essayer de se rendre le plus impuni possible. Aujourd'hui, Dubaï, c'est la garantie de l'impunité, c'est ce qui fait le succès de Dubaï. Donc, évidemment, c'est très alléchant pour des familles comme celles que vous rappelez.
Autre personne célèbre dans le viseur de cette enquête, Isabel Dos Santos, qui a été considérée longtemps comme la femme la plus riche d'Afrique. Elle a acheté un bien immobilier à Dubaï il y a dix ans et, aujourd'hui, elle répond que le pouvoir angolais fabrique de fausses preuves contre elle depuis que son père a quitté le pouvoir. Et elle conteste l'alerte rouge lancée contre elle par Interpol.
Alors ça, c'est un dossier que nous connaissons bien puisque les Luanda Leaks, c'est nous qui en sommes responsables. Quand je dis nous, c'est moi, en qualité de président de la plate-forme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, qui s'appelle Pplaaf et que les auditeurs africains connaissent sans doute. Donc s'il y a bien un dossier qui est étayé, c’est le dossier judiciaire de madame Isabel Dos Santos. C'est effectivement une des femmes les plus riches d'Afrique. Aujourd'hui, elle se cache on ne sait pas où, mais elle aura, à un moment ou à un autre, à répondre de la mécanique avec laquelle, de façon très systématique, elle s'est enrichie, elle et toute sa famille. Et d'ailleurs, Dubaï est un port de relâche et un port d'attache pour elle sans doute extrêmement précieux.
Côté gabonais, à présent, la personnalité la plus en vue dans cette enquête, c'est Marie-Madeleine Mborantsuo, qui a longtemps présidé la Cour constitutionnelle. Selon cette enquête, elle aurait déboursé 6 millions d'euros en 2013 pour s'offrir cinq appartements et deux villas à Dubaï. Mais depuis le putsch du 30 août, elle a perdu beaucoup de pouvoir et d'influence. Est-ce que cela peut lui compliquer les choses ?
Alors, je connais bien cette dame, puisque l'association Sherpa est partie civile dans ce dossier dont je vous rappelle qu'il est à l'instruction à Paris. Et on attend, on espère, on souhaite une mise en examen de cette ancienne dignitaire gabonaise. Elle a été la plus haute magistrate de son pays, ce qui, évidemment, symboliquement, nous dit quelque chose des ravages de la culture de la corruption. Ensuite, il y a un certain nombre d'informations qui circulent selon lesquelles les nouvelles autorités gabonaises seraient disposées à coopérer avec les juges européens, notamment les juges français chargés d'une procédure du type des biens mal acquis. Il n'est pas réaliste d'imaginer que tous les dignitaires qui ont volé leur pays rendent des comptes. Tous, ce n'est pas possible. Donc, dans ce dossier qui est à l'instruction à Paris, il y aura un procès du clan Bongo. Et d'ailleurs, je suis en mesure de vous dire que l’on peut souhaiter – même s'il y a eu des commissions rogatoires, des vérifications qu'il a fallu faire pour que le dossier soit le plus solide possible – un achèvement des investigations dans la procédure Bongo d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine.
Wed, 22 May 2024 - 960 - Brice Ahounou, anthropologue franco-béninois: «Il serait urgent que les frères d’Afrique viennent au secours d’Haïti»
En Haïti, plusieurs milliers de policiers kényans et béninois sont attendus dans les prochaines semaines pour tenter de mettre fin à la toute-puissance des bandes armées qui terrorisent la population. Cette opération multinationale serait financée par les États-Unis à hauteur de 300 millions de dollars. Pourquoi le Bénin accepte-t-il d'y aller ? La lettre ouverte du grand historien togolais Godwin Tété au président béninois Patrice Talon a-t-elle joué un rôle ? L'anthropologue franco-béninois Brice Ahounou est enseignant-chercheur. Il est aussi le correspondant à Paris du journal Haïti-Observateurde New York. Il répond à Christophe Boisbouvier.
RFI : Après des mois de tergiversations, le déploiement d'une force multinationale en Haïti est en train de prendre forme. Que pensez-vous de la présence majoritaire de soldats et de policiers africains, notamment kényans et béninois ?
Brice Ahounou : Cette question nous laisse toujours un peu perplexes. Que la communauté internationale vienne aider les Haïtiens, c'est une bonne chose. Seulement, on ne sait pas ce qu'il y a derrière tout cela. Parce que j'écoute, j'entends divers acteurs haïtiens qui se disent : il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière. On ne sait pas très bien, c'est ce qu'on nous dit. Pourquoi ne pas penser renforcer, par exemple, les hommes en armes qui sont en Haïti et qui peuvent faire face aux gangs ? Donc voilà, c'est cette chose-là qui est un peu curieuse, on ne comprend pas très bien. En fait, le scénario est extérieur, c'est ce que disent les Haïtiens. Le grand metteur en scène de cette affaire, c'est Washington, quelque part, et ses alliés. Voilà, on est face à quelque chose qui nous plonge dans beaucoup d'incertitudes.
La nouveauté, c'est le déploiement à venir de quelque 2 000 policiers béninois aux côtés des militaires et des policiers kényans. De fait, est-ce que les liens historiques et culturels entre le Bénin et Haïti ne justifient pas cet effort exceptionnel de la part de Cotonou ?
Je dirais oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez un homme politique togolais qui a vécu longtemps à Paris et qui est rentré la semaine dernière dans son pays. Un homme âgé de 97 ans, Tété Godwin. Il a écrit une lettre à Patrice Talon il y a de cela quelques semaines, en demandant au président béninois d'intervenir en Haïti et d'aider les frères haïtiens, ce que je trouve quand même assez exceptionnel comme démarche.
Ce courrier de Tété Godwin ?
Oui, ce monsieur dont je parle est né au Dahomey de parents togolais. On a l'impression que le président béninois répond favorablement à ce courrier-là et qu'il trouve lui aussi qu’Haïti est proche du Bénin. Tété Godwin pense qu'Haïti devrait se relever et que les frères d’Afrique pourraient aider Haïti.
À l'époque où Haïti demandait à adhérer à l'Union africaine, il y a une douzaine d'années, l'ancien Premier ministre haïtien, Laurent Lamothe, disait : « Notre demande est basée sur notre proximité culturelle et sur l'Histoire. Nous sommes la première République noire du monde, nous sommes la première et la dernière révolte d'esclaves ayant réussi. »
Oui, Lamothe le dit, puisque Haïti reste une pointe avancée de l'Afrique dans la mer des Caraïbes. Et après le séisme de l'année 2010, Lamothe et son président Martelly, effectivement, font la démarche d'entrer à l'Union africaine. Haïti a été pris d'abord comme un observateur, puis ensuite comme membre associé, et puis subitement, quelques années après, on est en 2016, l'Union africaine a rejeté Haïti.
Est-ce que vous aimeriez, Brice Ahounou, que l'Union africaine accueille à nouveau Haïti dans ses instances ?
Absolument. Parce que vous savez, l’Union africaine, par exemple, son siège est en Éthiopie. Et il y a un Haïtien, qu'on ne connaît peut-être plus aujourd'hui, qui s'appelait Benito Sylvain. C'était un journaliste haïtien du XIXème siècle. Il était le conseiller de l'empereur Menelik II. Il était présent quand la bataille d'Adoua a eu lieu, quand les Éthiopiens ont mis une raclée aux Italiens en 1896. Et en fait, les Haïtiens ont toujours été aux côtés de certains dirigeants africains. Benito Sylvain était le premier. Donc Haïti, pour moi, a toute sa place dans l'Union africaine et ce serait vraiment souhaitable que l'Union africaine réinscrive Haïti à son ordre du jour.
L'an prochain, 2025, marquera le 200e anniversaire de l'indemnité de quelque 150 millions de francs-or que la jeune République haïtienne a été obligée de payer à la France en 1825. Qu'est-ce que vous attendez de cette date anniversaire ?
Que l’on fasse beaucoup de bruit autour de cette date. C'est-à-dire qu'on en prenne conscience, parce que, quand on en parle aux gens qu'on rencontre, ils s'étonnent de cela. Mais dans un second temps, il serait bien qu'un pays comme la France, justement, qui est quand même en capacité de restituer, de rendre à Haïti un certain nombre de choses, examine la question sous l’angle d'une véritable réparation.
L'ancien Premier ministre français Jean-Marc Ayrault, qui préside la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, vient de déclarer : « Ce bicentenaire, espérons qu'il sera l'occasion d'un grand geste de fraternité de la part de la France à l’égard du peuple haïtien. »
Oui, c'est une phrase intéressante et un vœu intéressant. Mais j'aimerais quand même que cela soit concret, parce que Jean-Marc Ayrault a été le Premier ministre du président Hollande qui, en se rendant en Haïti, était passé par l’une des îles françaises des Caraïbes, la Guadeloupe ou la Martinique, je ne sais plus laquelle. Il avait dit alors qu'il partait en Haïti payer sa dette et il y a eu une levée de boucliers dans l'administration française contre lui. En arrivant à Port-au-Prince, il a dit qu'il voulait parler d'une dette morale et c'était la grande déception à Port-au-Prince. Donc, il faut que la France fasse un geste très symbolique et fort en termes de deniers, en renflouant les caisses haïtiennes de manière assez significative.
À lire aussiLe Bénin veut réaffirmer ses liens avec Haïti en participant à la future force multinationale
Tue, 21 May 2024 - 959 - Tentative de coup d'État en RDC: «Beaucoup d’amateurisme et des questions sur la facilité de l’opération»
Il reste beaucoup de questions ce lundi matin, 24 heures après les affrontements meurtriers qui ont eu lieu hier matin à Kinshasa, d’abord à la résidence du vice-Premier ministre Vital Kamerhe, puis au palais de la Nation. Que s’est-il passé exactement ? Pourquoi a-t-on voulu assassiner le vice-Premier ministre, qui est pressenti pour présider la nouvelle Assemblée nationale ? Le chercheur congolais Fred Bauma est le directeur exécutif d’Ebuteli, l’Institut congolais de recherches sur la gouvernance, la politique et la violence. En ligne de Kinshasa, il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
RFI : « Une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf », a déclaré hier le porte-parole de l'armée congolaise. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Fred Bauma :On ne sait pas très bien s'il s'agissait d'un coup d'État ou d'une tentative d'assassinat. Ça peut être l'un ou l'autre. Tout ce que l'on sait, c'est qu’hier, des personnes armées se sont attaquées à la résidence de Vital Kamerhe et ensuite, elles s’en sont pris au palais de la Nation, le bureau officiel du président de la République, avant d'être maîtrisées. La manière dont leurs opérations ont été présentées semble montrer beaucoup d'impréparation, beaucoup d'amateurisme, mais ça pose aussi beaucoup de questions sur la facilité avec laquelle ces personnes armées semblent avoir opéré.
« Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais », a ajouté le porte-parole. À quels étrangers a-t-il fait allusion ?
Le peu que l'on sait pour l'instant, c'est que, parmi les personnes responsables de cette tentative, leur leader, qui a été assassiné, Christian Malanga, est un citoyen congolais qui réside aux États-Unis. Et, parmi d'autres assaillants, il y avait son fils et il y avait également d'autres personnes dont certaines détenaient, il me semble, des passeports américains et canadiens.
Depuis deux ans, les relations entre Kinshasa et Kigali sont exécrables. Est-ce que les étrangers dénoncés par le porte-parole pourraient être aussi des Rwandais ?
Alors il n’y a rien qui montre pour l'instant qu'il y a des Rwandais parmi ceux qui ont commis cette tentative-là. Rien pour l'instant ne semble l'indiquer.
Ce qui vous frappe, c'est la facilité avec laquelle les assaillants sont entrés dans le palais de la Nation, c'est ça ?
Exactement. Donc, ce qu'on a appris, c'est qu’ils ont tenté d'assassiner Vital Kamerhe. Ils n'ont pas pu y arriver, mais ils ont tué deux policiers dans sa résidence. Ils se sont ensuite dirigés vers le palais de la Nation. Et on voit bien sur les réseaux sociaux des vidéos de cette troupe en train de se filmer, en train de changer les drapeaux de la République pour les remplacer par les drapeaux du Zaïre. Et le tout sans aucune intervention pendant plusieurs minutes. Quand on sait que le palais de la Nation, c'est quand même les bureaux officiels du président de la République et que c'est un espace très bien protégé par la Garde républicaine, une unité d'élite au sein de l'armée congolaise, on peut se demander pourquoi cela a été si facile [pour les assaillants] d'accéder jusque dans l’enceinte du palais de la Nation et d’enregistrer plusieurs vidéos avant qu’ils soient arrêtés. Cela donne quand même une impression d'insécurité en plein centre de Kinshasa.
Et d'éventuelles complicités ?
Je pense que c'est possible et il est certainement impossible que des personnes puissent être rentrées en RDC avec des tenues militaires et des armes et arrivent à mener des opérations jusque dans les endroits les plus sécurisés du pays… sans aucune complicité. J'imagine que les assaillants doivent être probablement dans un réseau et ce serait bien que la justice puisse élucider cela.
Mais en même temps, tout le monde sait que le président Félix Tshisekedi ne dort pas au palais de la Nation. Pourquoi ces assaillants s'en sont-ils pris à un palais qui était vide ?
Pour l'instant, je dois dire qu'il y a plus de questions que de réponses. Une des questions, c'est celle-là exactement : pourquoi s’en prendre au palais de la Nation si c'est un coup d'État, alors qu'on sait très bien que le président n'y réside pas ? Pourquoi s'attaquer à Vital Kamerhe ? Ça fait que même la qualification de coup d'État de ce qu’il s'est passé hier est quelque chose qu'il faudrait questionner, je pense.
L’un des faits marquants de ces événements d'hier, c'est en effet l'attaque, dans la nuit de samedi à dimanche, du domicile de Vital Kamerhe. Pourquoi les auteurs de ce coup de force s'en sont-ils pris d'abord à cette personnalité qui est Vice-Premier ministre et ministre de l’Économie ?
Je n’ai pas de réponse claire, mais Vital Kamerhe est connu comme étant l’un des alliés proches du président de la République, il est une personnalité qui est attendue pour être le président de l'Assemblée nationale et, de cette manière-là, il pourrait être l’une des personnalités les plus importantes du pays. Est-ce que c'est ce qui a fait qu'il soit la cible ? Je ne sais pas le dire. Il y a beaucoup de théories du complot qui se développent autour de cela, mais ça questionne, le fait de s'être attaqué particulièrement à Vital Kamerhe, plutôt qu'à beaucoup d'autres cibles potentielles.
Le 23 avril dernier, Vital Kamerhe a gagné en effet une primaire parmi les députés de l'Union sacrée pour devenir le prochain président de l'Assemblée nationale, mais il n'a pas que des amis au sein de cette coalition présidentielle…
Il n’a pas que des amis. Le fait qu'il soit passé par des primaires est dû d'ailleurs à des divisions au sein de l'Union sacrée, au manque de consensus autour de sa personne. Mais je pense qu'il est très tôt pour pouvoir lier les actions d'hier à la compétition politique au sein de l'Union sacrée. Et cependant, je pense qu'il est clair que ça ne va pas adoucir la relation entre Vital Kamerhe et des personnes qui sont opposées à lui au sein de leur coalition. Cela ne fera que durcir la relation entre Vital Kamerhe et d'autres leaders de l'Union sacrée.
► L’ambassadrice des USA en RDC exprime «son choc et sa préoccupation face aux rapports impliquant des citoyens américains dans les attaques». « Je suis choquée par les événements de ce matin et très préoccupée par les rapports faisant état de citoyens américains prétendument impliqués. Soyez assurés que nous coopérerons avec les autorités de la RDC dans toute la mesure du possible alors qu’elles enquêtent sur ces actes criminels et tiennent pour responsables tout citoyen américain impliqué dans des actes criminels », a déclaré Lucy Tamlyn dans un communiqué.
► Réaction de la Monusco. La représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU en RDC et cheffe de la mission onusienne, Bintou Keïta, a dit suivre de très près l’évolution de la situation et se tenir « à la disposition des autorités congolaises pour fournir tout appui entrant dans le cadre de son mandat ».
► Le gouvernement de la République du Congo a affirmé, par voie de communiqué, qu’un « obus en provenance de Kinshasa s’était malencontreusement abattu à Brazzaville, dans l’arrondissement 2 Bacongo, précisément au quartier M’Pissa dans la zone dite des Trois Francs». De ce côté-ci du fleuve, les autorités font état de blessés légers et affirment qu’il ne s’agissait que d’un « incident isolé ».
À lire aussiRDC: le président Tshisekedi veut remettre de l’ordre dans sa majorité à l’Assemblée
Mon, 20 May 2024 - 958 - Philippe Lacôte: «Le cinéma du monde n’est pas un genre. II faut essayer d'être plus authentique»
Le grand invité Afrique de ce matin est le réalisateur ivoirien Philippe Lacôte, parrain de la Fabrique du cinéma 2024 à Cannes, une initiative qui vise à aider la production des pays émergents, et ce depuis seize ans maintenant. Dix projets diversifiés de films ont été sélectionnés pour bénéficier de l'aide à la production. C'est l'occasion d'échanger avec le parrain de la Fabrique sur son parcours cinématographique, son pays et les jeunes créateurs qu'il va accompagner.
À lire aussiJournal du festival de Cannes 2024: une méga déception et deux belles surprises
Sat, 18 May 2024 - 957 - Femua: «En dehors de la musique, on peut être un pion essentiel pour le développement de son pays»
Salif Traoré, dit A'Salfo, leader du groupe Magic Systèm, est délégué général du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua), dont on fête la seizième édition. Un événement devenu une référence sur le continent africain par la qualité de sa programmation : Gims, Yémi Aladé, Sona Jobarteh, Tamsir partagent notamment la grande scène... mais il est surtout réputé pour son engagement permanent dans le développement social, économique et diplomatique, avec cette année, le thème de la santé mentale chez les jeunes. Entretien.
RFI : Musique, social… Pourquoi le Femua doit être intégré à la société ?
Salif Traoré : Quand on est artiste, on vit constamment engagé, parce qu’on a envie de dire des choses, on a la chance de faire l’un des plus beaux métiers du monde, qui est un canal pour promouvoir des valeurs… On a envie d’apporter notre contribution, on a envie d’apporter notre grain de sel. C’est ce qui nous amène à créer des activités qui peuvent être transversales entre la musique et tout ce qui peut contribuer au bien-être des populations.
À quel moment avez-vous compris que la musique, c’est de la politique ?
On l’a compris un peu trop tôt parce qu’il fallait sortir de ce canal. Le musicien, ce n’est pas seulement celui qui vient sur scène pour faire danser. Le musicien a un métier qui lui permet de s’adresser à tout le monde sans barrière linguistique, sans appartenance politique ni obédience religieuse. Il parle à tout le monde sans distinction. Il a une force et cette force, il peut l’utiliser à bon escient : contribuer à l’éducation, à promouvoir la paix, à promouvoir la cohésion sociale. En dehors de la musique, on peut être vraiment un pion essentiel pour le développement de son pays, quand on le veut. La classe politique écoute aussi quand nous avons des projets. Si on dit à la classe politique « on va chanter, on va danser », alors elle nous regardera chanter et danser.
Justement, cette année, un thème fondamental : la santé mentale chez les jeunes. Comment vous est venue cette idée ?
C’était important. Lors d’une visite à l’hôpital psychiatrique de Bingerville, j’ai vu ce qu’il se passait autour et j’ai parlé avec certaines personnes qui disaient que les gens les traitaient de « fous » alors que, généralement, ce ne sont pas des gens qui sont nécessairement dans la folie. Souvent, ce manque d’attention, ça les amène à se renfermer sur eux. Et puis, beaucoup de jeunes, aujourd’hui, sont confrontés à des difficultés qui les amènent souvent à emprunter des chemins qui ne sont pas forcément les meilleurs… La drogue, l’alcool, peuvent être des facteurs qui les amènent à développer cette pathologie. Souvent, ils ont besoin d’être écoutés, entendus. Si on dit que la richesse de l’Afrique, c’est sa démographie qui est à 70 % composée de jeunes, il faudrait aussi que l’on s’intéresse aussi aux problèmes de ces jeunes. Sinon, l’avantage de l’Afrique risque de devenir un inconvénient pour ce continent.
Est-ce qu’aujourd’hui, vous arrivez à chiffrer l’impact économique du festival, chaque année ?
Les données sont là, au bout de quinze années. Le groupe Magic System a pu offrir, avec le Femua, entre 12 000 et 15 000 emplois directs et indirects à travers le Femua. Il y a dix écoles qui ont été construites et deux en construction. Pendant le Femua, le taux de remplissage des hôtels augmente, les taxis roulent toute la nuit, les petits commerçants qui sont aux bords des routes vendent toute la nuit. Donc, il y a un fort impact économique. Et puis, cerise sur le gâteau, cela crée de la cohésion sociale. Aujourd’hui, le Femua est devenu comme une Coupe d’Afrique de la culture, cela crée de l’intégration aussi entre les pays africains. La preuve en est, la Guinée-Bissau cette année. Il y a des retombées qui sont incalculables.
Vous citez la Guinée-Bissau, qui est le pays invité. Là encore, ce festival, c'est de la diplomatie pure.
C’est de la diplomatie culturelle. Parce que la culture n’a pas de langue, comme on dit. C’est pourquoi la Guinée-Bissau, qui est un pays lusophone, se trouve aujourd’hui dans l’un des plus grands festivals francophones. Je crois que le Femua joue aussi son rôle, la musique joue son rôle, mais avec subtilité.
Pour terminer cet entretien, Salif Traoré, la question la plus difficile : quel est votre coup de cœur pour cette 16e édition du Femua ?
Pour le coup de cœur, je suis partagé entre Sona Jobarteh, qui est l’une des meilleures koralistes du monde… Elle tourne partout. J’ai trouvé qu’elle était plus à l’extérieur qu’en Afrique et qu’il fallait avoir Sona Jobarteh. Et il y a aussi Tamsir, qui est une étoile montante et qui fait là une de ses premières grandes scènes. Ce sont mes deux coups de cœur. Ce sont ceux-là que j’attends de voir.
À lire aussiCôte d'Ivoire: coup d'envoi pour le 16e FEMUA, grand festival des musiques urbaines africaines
Fri, 17 May 2024 - 956 - Cinéma en Afrique: «Les femmes participent à l'essor de l'industrie», dit Emma Sangaré
Le Festival de Cannes donne lieu à des projections cinématographiques, mais aussi à des rencontres et des forums sur le Septième art. Ce jeudi se tient un débat sur la place des femmes dans les secteurs du cinéma et de l’audiovisuel au « Pavillon Afriques ». Débat auquel participeront des réalisatrices, des productrices, des actrices, ainsi qu’Emma Sangaré, co-directrice de l’école de cinéma Kourtrajmé à Dakar, au Sénégal. Entretien.
RFI : On assiste, en ce moment, à un essor du cinéma africain, et notamment des productions télévisuelles. Est-ce que les femmes participent à ce mouvement ?
Emma Sangaré : Bien sûr que les femmes participent à l’essor de la production, de tout le développement et de la structuration de l’industrie du cinéma en Afrique. Premièrement, en étant représentées à tous les postes, elles prennent de plus en plus en place. Je pense à Kalista, Angèle, Chloé, productrices, à des réalisatrices comme Amina, Mariam, à des scriptes, à des techniciennes, des scénaristes, des formatrices, des actrices… Elles sont là, à tous les postes et de plus en plus présentes. On voit une vraie différence depuis quelques années.
Cet essor des femmes africaines dans le cinéma, il est dû à quoi ? Plus de centres de formation, plus de motivation ?
Il y a toujours eu des formations, que ce soit des ateliers, des masterclass, des écoles… Je pense que c’est surtout que la parole commence à se libérer, qu’on commence à les écouter, à leur laisser prendre le plus de place. Il n’empêche que, face aux opportunités, il y a encore des inégalités. Tout cela, c’est un problème systémique, à plusieurs facettes. La réponse est plurielle, mais je pense que, dans les centres de formation, on respecte aussi de plus en plus la parité, que ce soit pour les élèves ou pour les formateurs. Forcément, cela a un impact. Aussi, les jeunes femmes ont de plus en plus de modèles, elles s’identifient, elles se disent : « Pour moi aussi, c’est possible ». Elles osent plus facilement passer le cap en se disant : « Ce sont des voies, ce sont des filières possibles pour moi ». Surtout, les femmes savent qu’elles vont, de toute façon, devoir mettre beaucoup plus d’énergie, c’est encore la réalité, pour arriver au même poste. Elles sont juste encore plus battantes, encore plus motivées. Elles sont conscientes d’une chance et d’une opportunité qu’elles ne veulent pas laisser passer.
Vous parliez d’inégalités. À quelles inégalités font face les femmes du 7e art africain ?
Les difficultés auxquelles elles font face sont générales dans tout le métier et dans toute l’industrie. Elles touchent tous les corps de métier, elles touchent tous les salaires, la reconnaissance des statuts, un manque de soutien social, les préjugés de ces filières métiers vis-à-vis des familles. Elles sont vraiment à tous les niveaux. Ce sont des difficultés qui touchent autant les femmes que les hommes.
Emma Sangaré, vous êtes codirectrice de l’école Kourtrajmé à Dakar, école de cinéma. Est-ce que, depuis quelques années, vous avez constaté cette tendance des femmes à se diriger vers le cinéma ?
Dans les appels à candidature, on voit évidemment une différence. On reçoit plus de candidatures d’hommes, mais, en même temps, ce qui est positif, c’est que, en trois ans, on voit une évolution et surtout de plus en plus de femmes qui postulent, qui postulent au-delà du Sénégal. On a des élèves, des jeunes femmes, qui viennent de plusieurs pays de la sous-région. On voit vraiment cette évolution. Nous, dans nos sélections, on respecte et on fait très attention à la parité. Même parmi nos enseignants et nos formateurs, c’est important pour nous qu’il y ait des femmes enseignantes, parce qu’on transmet les choses différemment. Ce sont des métiers créatifs, il faut avoir différents points de vue, celui des femmes est tout aussi important.
Et justement, ce point de vue, quand on connait les différentes séries, c’est important d’avoir des femmes qui jouent, qui réalisent, qui écrivent pour d’autres femmes spectatrices ?
Bien sûr ! Je pense que, quand il s’agit de raconter des histoires féminines, pour toucher des spectatrices féminines, les femmes sont les mieux placées pour raconter ces histoires d’un point de vue de l’intime et de caractériser des personnages dans lesquelles les spectatrices vont s’identifier. C’est évident. Je pense, entre autres, à tout le travail que fait Kalista Sy. C’est une femme productrice, elle travaille sur des histoires de femmes, elle met en avant tous les postes de femmes. C’est un vrai exemple pour les jeunes femmes, c’est un vrai mentor.
À écouter aussi«Un cinéma africain marqué par des films de l’intime et une prise de pouvoir des femmes»
Thu, 16 May 2024 - 955 - Togo: «Le changement de régime vise à prolonger le mandat de Faure Gnassingbé indéfiniment»
Au Togo, le président Faure Gnassingbé est assuré de rester au pouvoir après la victoire de son parti aux législatives du 29 avril, mais à condition de changer de fauteuil. Suite au changement de Constitution, c'est le président du Conseil des ministres qui concentre désormais tous les pouvoirs. Pourquoi Faure Gnassingbé a-t-il fait adopter cette réforme ? Et pourquoi l'opposition n'a-t-elle pas réussi à l'en empêcher ? Entretien avec Bergès Mietté, chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde, à Sciences Po Bordeaux, dans le sud-ouest de la France.
RFI : Pourquoi Faure Gnassingbé est-il passé à un régime parlementaire, 19 ans après son arrivée au pouvoir ?
Bergès Mietté : Je pense que, sur cette question, il y a plusieurs raisons qui ont présidé au changement de régime au Togo. Selon le président, ce système, ce régime permet plus de représentativité des différentes sensibilités politiques du pays. Il permet aussi de consolider les acquis démocratiques. Et je pense qu’il y a une autre raison à cela, une raison principale. C’est que Faure Gnassingbé voulait se porter candidat à l’élection présidentielle en 2025, sauf qu’à l’issue de ce quinquennat, il ne pouvait plus prétendre à la magistrature suprême. Ce changement de régime visait, en réalité, à prolonger le mandat du président en exercice indéfiniment. Je pense que c’est l’une des principales raisons de ce changement de régime.
Parce que Faure Gnassingbé ne sera plus président de la République, mais président du Conseil des ministres, c’est cela ?
Oui, je pense que ce poste de président du Conseil des ministres a été taillé pour le président en exercice.
Et pour un mandat de six ans qui sera renouvelable autant de fois que son parti gagnera les législatives ?
Oui, tout à fait.
Alors, désormais, il va donc y avoir un président de la République et un président du Conseil des ministres. Mais est-ce que cela ne va pas instaurer une dualité, voire une rivalité, au sommet de l’État ?
Je ne pense pas qu’il y aura une réelle dualité au sommet de l’État puisque, selon la Constitution qui a été promulguée récemment, le chef de l’État, élu par les députés pour un mandat de quatre ans, ne dispose, pour ainsi dire, d’aucun pouvoir. La réalité du pouvoir est entre les mains du président du Conseil des ministres. Donc, pas vraiment de dualité du pouvoir au sommet de l’État.
Selon la Cour constitutionnelle, le parti au pouvoir Unir a remporté les élections législatives avec plus de 95 % des voix. Que vous inspirent ces résultats ?
Je pense que cette victoire écrasante est, pour ma part, sans surprise. Elle était requise pour pouvoir entériner le projet de changement de régime visant à assurer et garantir l’inamovibilité du président Faure Gnassingbé à travers le poste de président du Conseil des ministres. À bien des égards, cette victoire consacre, plus que jamais, l’emprise du président et de son parti sur le pays.
Alors, le parti au pouvoir Unir affirme que ces résultats sont le fruit d’un travail de terrain, y compris dans le sud, à Lomé, le fief habituel de l’opposition. Mais celle-ci réplique que ces résultats sont le fruit de bourrages d’urnes et de votes massifs par procuration.
L’opposition a voulu faire des législatives du 29 avril un référendum contre le projet du changement de régime porté par le parti présidentiel, mais n’y est pas parvenue. Et à cela, plusieurs raisons : tout d’abord, dans les bastions traditionnels de l’opposition, certains citoyens n’avaient pas pu s’enrôler durant la phase d’inscription sur les listes électorales. Une pratique que les partis d’opposition avaient d’ailleurs dénoncée. Ensuite, l’opposition n’est pas parvenue à rassembler ces partisans, sans doute faute de moyen, à la différence du parti présidentiel. Ou alors, son programme n’a pas séduit suffisamment d’électeurs. Enfin, l’adoption de la nouvelle Constitution à la veille du scrutin a eu un réel impact, aussi bien sur l’opposition que sur les citoyens, désormais résignés. Ce qui explique, entre autres, la faible participation des citoyens à ce scrutin. Ce qui a laissé champs-libre au parti présidentiel.
Il y a cette phrase de l’un des leaders de l’opposition, Dodji Apevon, des Forces démocratiques pour la République : « À cause de nos difficultés et de nos querelles, le parti au pouvoir en profite toujours pour truquer et pour voler. »
Je pense que les propos de M. Apevon sont très pertinents puisque les clivages au sein de l’opposition sont une réalité, une réalité très criarde et que, ces clivages n’ont pas permis à l’opposition de pouvoir s’organiser, de constituer des coalitions pour mener à bien cette campagne électorale. Les clivages ont joué dans le triomphe du parti au pouvoir. Il y a aussi la question des moyens, qui ne permet pas à l’opposition de pouvoir se mobiliser durant le processus électoral, à la différence du parti au pouvoir qui dispose de ressources beaucoup plus importantes.
À l’issue du scrutin, la Cédéao, l’Union africaine et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont exprimé leur satisfaction sur – je cite – le bon déroulement de la campagne et la tenue des élections dans le calme. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
Je pense que les propos de ces organisations internationales ne sont pas surprenants, puisque, alors même que l’opposition dénonçait des irrégularités durant le processus d’enrôlement sur les listes électorales, on a bien vu l’OIF qui a confirmé la fiabilité du fichier électoral, ce que dénonçait l’opposition à l’époque. Dans un contexte où l’on sait que les élections ont eu lieu quasiment à huit-clos, puisque les observateurs internationaux n’ont pas pu obtenir à temps, pour la plupart, les accréditations pour pouvoir observer de bout en bout ce processus électoral, c’est quand même assez curieux que ces organisations internationales se félicitent du bon déroulement de ces élections.
Est-ce à dire que l’opposition togolaise est isolée sur la scène internationale ?
Tout à fait. Je pense que l’opposition togolaise est à la croisée des chemins et qu’aujourd’hui elle n’a aucune alternative.
À la différence de Faure Gnassingbé, le président togolais, qui multiplie les médiations sur la scène sous-régionale ?
Oui, tout à fait. Je pense que le président Faure Gnassingbé a mis en place une politique assez intéressante sur la scène internationale puisque, à la différence de ses homologues ouest-africains, il arrive à faire l’entre-deux, à communiquer avec les pays faisant partie de l’Alliance des États du Sahel (AES) qui sont en rupture avec d’autres pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Je pense que le régime togolais arrive à concilier le discours avec l’action gouvernementale puisque le discours de paix prôné par le régime togolais trouve son écho à travers la politique sous-régionale du président, à travers les rencontres et le dialogue qu’il initie notamment avec les régimes putschistes d’Afrique de l’Ouest.
À lire aussiTogo: la Cour constitutionnelle confirme les résultats des législatives
Wed, 15 May 2024 - 954 - «Il y a une sorte de continuité dans l'action de la diplomatie sénégalaise»
Le Sénégal est sur tous les fronts. D'un côté, le président Diomaye Faye est allé la semaine dernière en Côte d'Ivoire. De l'autre, le Premier ministre Ousmane Sonko espère se rendre bientôt dans les trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Est-ce à dire que les nouveaux dirigeants sénégalais vont tenter une médiation entre la Cédéao et les trois États sahéliens qui ont quitté l'organisation ouest-africaine ? Entretien avec le chercheur sénégalais Pape Ibrahima Kane, spécialiste des questions régionales en Afrique.
RFI : La visite du président Bassirou Diomaye Faye à Abidjan, est-ce le signe que le nouveau régime sénégalais va poursuivre la politique de Macky Sall à l’égard de ses voisins d’Afrique de l’Ouest ?
Pape Ibrahima Kane : Tout à fait. Je pense que, pour ce qui concerne la diplomatie sénégalaise, on est dans une sorte de continuité, plutôt que dans une sorte de transformation systémique. Ce que Diomaye est en train de faire, c’est ce que Senghor a fait, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall ont fait. On est vraiment dans une sorte de continuité et on est en train de montrer que l’un des atouts majeurs du Sénégal, c’est sa diplomatie, c’est le rôle qu’il peut jouer dans les relations aussi bien inter-africaines que dans les relations internationales.
Oui, mais jusqu’à présent, les présidents Alassane Ouattara et Bassirou Diomaye Faye n’étaient pas de grands amis politiques. En juillet dernier, quand Macky Sall avait renoncé à un troisième mandat, Alassane Ouattara lui avait exprimé son désaccord et cela, bien entendu, Bassirou Diomaye Faye le sait. Comment expliquez-vous que la Côte d’Ivoire soit l’une des premières destinations du nouveau président sénégalais ?
D’abord, parce que la Côte d’Ivoire, au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), c’est la première puissance économique. Parce qu’également, au niveau de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), la Côte d’Ivoire est la deuxième puissance après le Nigeria. Et ensuite, il y a une forte communauté sénégalaise qui est établie depuis très longtemps en Côte d’Ivoire. Tout cela fait que le Sénégal est obligé d’entendre la voix de la Côte d’Ivoire, surtout quand ces autorités sénégalaises veulent jouer un rôle important dans le retour des trois pays du Sahel central qui avaient décidé de quitter la Cédéao. Je pense qu’il est nécessaire de savoir ce qui est en jeu pour vraiment pouvoir discuter sérieusement avec les dirigeants du Mali et pouvoir les convaincre de retourner dans la maison du père.
Justement, deux jours avant la visite du président Diomaye Faye à Abidjan, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé qu’il se rendrait bientôt en Guinée, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, les quatre pays sous régime putschiste. Est-ce qu’on peut parler, de la part du Sénégal, d’un double-jeu diplomatique ?
Non, pas du tout. D’abord, la diplomatie, c’est le domaine réservé du président de la République. Même si c’est Sonko qui va devoir se déplacer dans ces quatre pays, il le fait au nom du président de la République et il sera accompagné de la ministre des Affaires étrangères. Je pense que ce que le président Diomaye est en train de faire, parce que Sonko a une certaine proximité avec certains leaders de ces pays, c’est de l’envoyer en éclaireur, avoir un aperçu de ce que ces États reprochent à la Cédéao, aux dirigeants de la sous-région, pour pouvoir jouer le rôle qu’il lui revient, c’est-à-dire jouer les intermédiaires, faire en sorte qu’il y ait des discussions sérieuses sur des points qui sont soulignés par ces pays et les régler dans la meilleure des façons pour que la Cédéao continue d’être la région de référence au niveau de l’Afrique. Je pense que c’est plus une démarche cohérente… L’envoi de M. Sonko me paraît très utile parce qu’à ce moment-là, quand Diomaye pourra entrer dans le jeu, il pourra jouer un rôle. Parce que, s’il y va et qu’il échoue, cela veut dire qu’il n’y a plus de possibilité pour le Sénégal de jouer un rôle. Je pense que c’est quand même intelligent. Cela n’a rien à voir avec les relations avec les putschistes. Parce que, dans la tête des dirigeants sénégalais, le putsch… et ils l’ont dit quand Macky Sall avait agité l’idée que l’armée pouvait jouer un rôle, ils ne veulent en aucun cas que les militaires dirigent les États africains.
À Abidjan, le président Diomaye Faye a donc dit tout le bien qu’il pensait de la Cédéao, « un outil formidable d’intégration » a-t-il dit, que « nous gagnerons à préserver », a-t-il même ajouté. Alors, avec quels arguments Diomaye Faye et Ousmane Sonko vont-ils pouvoir convaincre le Mali, le Burkina Faso, le Niger de ne pas quitter l’organisation ouest-africaine ?
Ce que la Cédéao a réussi, c’est que c’est la première et la plus importante communauté économique régionale africaine, qui a réussi la libre circulation des personnes et des biens. Certes, la Cédéao a beaucoup de problèmes institutionnels. Par exemple, la question des sanctions est une question fondamentale dans la recherche de solutions à ces problèmes. Le régime de sanctions que la Cédéao a n’est pas un régime de sanction que l’on peut appliquer comme cela, à la va-vite, à la tête du client. Il faut que l’on révise le système dans le sens que les sanctions puissent servir à quelque chose de tangible, mais pas pour sanctionner des individus et autres. Tout cela me fait penser qu’aujourd’hui, il y a d’énormes possibilités de faire en sorte que ces dirigeants reviennent à la maison du père. D’autant que, personnellement, je pense qu’ils ont pris cette décision simplement pour montrer aux gens qu’ils ne sont pas des béni-oui-oui et qu’ils sont dans une posture de « bargaining », comme le disent les anglophones, pour pouvoir revenir, mais dans d’autres conditions, pour pouvoir continuer à travailler pour l’intégration régionale africaine.
Il y a un chef d’État putschiste avec lequel Ousmane Sonko a une relation complexe, c’est le capitaine burkinabè Ibrahim Traoré. Après le putsch de septembre 2022 à Ouagadougou, les deux hommes étaient proches. Mais après l’arrestation de l’avocat burkinabé Guy-Hervé Kam et la lettre ouverte d’Ousmane Sonko en faveur de sa libération, les relations Sonko-Traoré se sont dégradées. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre sénégalais va vraiment être invité à Ouagadougou ?
Vous savez, jusqu’à présent, le Burkina Faso et le Sénégal ont eu d’excellentes relations. Je pense que Sonko et le président Traoré ne peuvent agir que dans la continuité de ces relations. Même s’ils ont eu, par le passé, des difficultés entre eux, maintenant, il s’agit de relations d’État à État, et non d’individu à parti politique. Donc, cela change la dynamique. Je pense que le passé est le passé. Ici, maintenant, on est dans le dur… On est dans le sauvetage de la Cédéao et cela est plus important que les relations personnelles que les uns et les autres ont eues par le passé.
On connaît les projets du Pastef pour en finir avec le franc CFA. Et pourtant, lors de leur conférence de presse à Abidjan, Alassane Ouattara et Bassirou Diomaye Faye n’ont pas prononcé une seule fois les mots « franc CFA ». Pourquoi ?
Je pense qu’ils n’ont pas pu ne pas avoir discuté de cette question… Mais peut-être qu’ils se sont entendus pour qu’on ne puisse pas, dans le communiqué final, en parler. Parce que, même du point de vue du Pastef, actuellement, il y a peut-être une certaine évolution… Vous savez, quand on est dans l’opposition et qu’on est à la quête du pouvoir, on peut avoir des postures sur telle ou telle question. Mais à partir du moment où on a les clés de l’État entre les mains, où on est obligé de décider sur telle ou telle question, les positions sont obligées de changer. Je pense que Diomaye l’a lui-même dit, une fois, lors de l’un de ces discours, qu’il va progressivement travailler pour qu’on retrouve notre souveraineté monétaire.
Le mot important étant « progressivement » ?
Tout à fait.
À lire aussiLe président ivoirien Ouattara reçoit le sénégalais Diomaye Faye: «Nous sommes totalement en phase»
Tue, 14 May 2024 - 953 - Suliman Baldo, chercheur soudanais: «Beaucoup de civils seront pris dans des feux croisés à el-Fasher»
Au Soudan, la ville d’el-Fasher, la plus grande du Darfour, est le théâtre depuis le 10 mai 2024 de violents affrontements à l’arme lourde. OCHA, le Bureau des affaires humanitaires de l’ONU, décompte au moins 27 personnes tuées. El-Fasher est la seule ville du Darfour qui n’est pas encore tombée aux mains des Forces de soutien rapide du général Hemedti. Faut-il craindre que ces forces commettent un massacre à caractère ethnique, comme il y a un an à el-Geneina, une autre grande ville du Darfour ? Et pour stopper le général Hemedti, faut-il le menacer de poursuites judiciaires ? Le chercheur soudanais Suliman Baldo est le fondateur du centre de réflexions Sudan Policy and Transparency Tracker. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
RFI : La ville d’el-Fasher est-elle au bord d'un massacre à grande échelle, comme dit l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU ?
Suliman Baldo : Il y a des soucis bien justifiés pour qu'on craigne que ce soit le cas effectivement. Or, si cette offensive a lieu, il y aura certainement des victimes civiles en grand nombre.
Des victimes dans quelle communauté ?
Je ne m’attends pas à ce que le scénario d’el-Geneina, à l'ouest du Darfour, se répète, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y aura un ciblage ethnique contre des communautés particulières au sein de la ville. Cependant, el-Fasher est une ville de peut-être un million et demi d’habitants, la moitié desquels sont des déplacés de guerre, et donc les combats vont avoir lieu dans un milieu urbain dense. Donc il y aura beaucoup de civils qui seront pris dans les feux croisés des combats.
Alors vous rappelez ce qu’il s'était passé il y a un an à el-Geneina, la capitale du Darfour occidental. Là, il s'agissait vraiment d'un nettoyage ethnique ?
C'était certainement un nettoyage ethnique parce que c'était la communauté des Masalit qui était ciblée par les Forces de soutien rapide et les milices arabes alliées aux Forces de soutien rapide. Celles-ci se sont attaquées aux quartiers résidentiels où vivent les Masalit, en tuant des milliers d’entre eux. Et d'ailleurs, il y a un rapport de l'organisation internationale Human Rights Watch qui donne des témoignages de survivants. Là, il y a eu une campagne d'épuration ethnique, dont le but était de récupérer la terre des Masalit, parce que le ciblage était sur base ethnique. Cela relève aussi d’un acte génocidaire, parce qu'ils ont tué des milliers de civils masalit dans ces attaques.
En janvier dernier, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a déclaré qu'il y avait des raisons de croire qu’au Darfour, les deux belligérants commettaient des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire un génocide. Le procureur renvoie donc les deux belligérants dos à dos. Mais les Forces de soutien rapide ne commettent-elles pas des crimes encore plus graves que les Forces armées soudanaises ?
Je suis d'accord avec vous, c'est tout à fait le cas, c'est-à-dire que les Forces armées soudanaises au Darfour – que ça soit à el-Geneina, à el-Fasher ou même dans d'autres chefs lieux, comme Nyala au Sud-Darfour –, toutes les garnisons de l'armée soudanaise dans ces villes étaient encerclées et donc n'étaient pas en mesure de perpétrer des crimes massifs à l'échelle de ceux commis par les Forces de soutien rapide à el-Geneina. Bien sûr, l'armée de l'air soudanaise a lancé des bombardements à répétition dans les villes et donc il y a eu beaucoup de victimes civiles collatérales, mais je ne crois pas que l'armée a eu la possibilité, ou même l'intention, de s'attaquer à des communautés civiles sur une base ethnique, comme c’était le cas pour les Forces de soutien rapide.
Faut-il inculper le général Hemedti pour crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité ?
Certainement, c'est mon évaluation. D'ailleurs, il y a une enquête officielle de la Cour pénale internationale au sujet des tueries qui ont eu lieu entre le mois d'avril et le mois de juin 2023 à el-Geneina, où beaucoup de Masalit ont trouvé refuge et où les Forces de soutien rapide se sont attaquées à eux, en en tuant encore des milliers parmi eux.
Et faut-il inculper aussi le général al-Burhan ?
Il y a de plus en plus d'implication de l'armée soudanaise dans des crimes de guerre. On a vu dernièrement, par exemple, des cas de ciblage sur une base ethnique dans les villes où l'armée est en contrôle, dans les États de l'Est et du Nord du Soudan. Tous les gens de l'Ouest du Soudan sont pris pour cible et menacés d'arrestations arbitraires, de torture et suspectés de jouer un rôle d'espion pour les Forces de soutien rapide. Donc il y a une responsabilité du commandement du général al-Burhan sur les exactions qui visent des civils pris dans les feux croisés de cette guerre qui a lieu aujourd'hui au Soudan.
À lire aussiGuerre au Soudan: une trentaine de morts dans des combats à El Fasher au Darfour
Mon, 13 May 2024 - 952 - Mounir Halim: «La collaboration public-privé est la clé pour une production compétitive des engrais en Afrique»
Les pays membres de l'Union africaine étaient réunis cette semaine, du mardi 7 au jeudi 9 mai à Nairobi au Kenya, pour un sommet extraordinaire sur les engrais et la santé des sols. Un rendez-vous très important alors que les prix des engrais ont triplé, voire quadruplé au cours des dernières années, sous l'effet conjugué de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Cette envolée des prix a rendu l'accès aux engrais plus difficile pour les agriculteurs africains, provoquant un appauvrissement des sols et une baisse des récoltes dans de nombreux pays. À l'issue du sommet de Nairobi, un plan d'action décennal a été présenté, avec 21 mesures pour favoriser la fertilité et la santé des sols. Mounir Halim est le fondateur et directeur d'Afriqom, une agence d'information spécialisée sur le marché des engrais en Afrique.
RFI : Dans la déclaration de Nairobi, les États se sont engagés à tripler la production domestique et la distribution d'engrais d'ici fin 2034 en Afrique, pour améliorer la fertilité des sols. Que pensez-vous de cet objectif affiché ?
Mounir Halim :Alors, sur le point de la production aujourd'hui, je ne vois pas ça comme un problème pour arriver à des consommations dont on a besoin pour le sol, parce qu’on a du produit qui vient de la Russie, du Moyen-Orient, mais surtout des produits africains. On voit déjà le potentiel avec la disponibilité du gaz, du phosphate, même de la potasse, des éléments primaires pour les engrais. Le problème, ce n’est pas la disponibilité des produits. Maintenant, je comprends que certains gouvernements veulent produire des engrais en Afrique. En parallèle, nous avons beaucoup d'entreprises internationales qui veulent investir, mais nous n’arrivons pas à construire des investissements de milliards de dollars. Pour moi, c'est ça la question.
Donc, les matières premières sont disponibles, il y a des investisseurs... Alors, quelle est la clé pour améliorer la fertilité des sols ?
C'est la collaboration entre le secteur public et privé. Parce que les gouvernements africains ne peuvent pas le faire tout seul. On a des acteurs africains ainsi que des acteurs internationaux qui veulent développer l'Afrique. Ils sont prêts, mais ils ont besoin des réglementations qui vont faciliter et protéger leurs investissements. Mais l'intérêt est là. Je vois parfois des gouvernements qui font des régulations super efficaces, par exemple au Nigeria et en Tanzanie. Il faut apprendre de ces exemples et les appliquer dans d'autres pays.
Comment les prix des engrais ont-ils évolués depuis 2020 et est-ce que, désormais, ils se sont stabilisés ?
Je vous donne un exemple donc de l'urée. C’est l'engrais azoté qui est le plus utilisé dans le monde et aussi en Afrique. L'urée, arrivée au port africain en décembre 2020, était autour de 300 dollars la tonne. En mars 2022, on est arrivé à 1 100 dollars par tonne. Aujourd'hui, on est retourné à 350 dollars la tonne.
Et peut-on dire que les chocs de la guerre en Ukraine et du COVID-19 ont été surmontés ?
Malheureusement, non. C'est parce qu'on a découvert, avec ce choc du COVID-19, c'est qu'en Afrique, nous ne sommes pas prêts à gérer ces chocs. Et on l'a vu depuis des dizaines d'années : il n'y avait pas de fluctuations dans les marchés d'engrais. Mais en 2006/2007, nous avions la flambée des prix... Après, nous en sommes revenus et là, on voit que ça arrive de plus en plus. C'est lié à beaucoup d'autres éléments, comme tout ce qui est politique, le changement climatique, la crise financière. Et d'ailleurs, avoir une préparation pour gérer les chocs n’était pas du tout mentionné dans la déclaration, alors qu'on vient de sortir d'un choc, justement. C'est pourquoi cette déclaration, à mon avis, manque de beaucoup d'éléments importants.
L'Afrique compte plusieurs grands producteurs d'engrais, le Nigeria, l'Algérie, le Maroc ou l’Afrique du Sud. Aujourd'hui, est-ce que leurs exportations sont tournées prioritairement vers le continent africain lui-même ?
La réponse est oui et non. Par exemple, le Maroc exporte plus que 20%, parfois 30%, de leur export mondial vers l'Afrique. Maintenant, vous avez mentionné l’Algérie. Ça, c'est un peu décevant : pratiquement, je dirais 0% qui part vers l'Afrique. La même chose pour l'Égypte. Pour l'Afrique de l'Ouest, la grande production est au Nigeria. Il y a deux grands producteurs : Dangote et Indorama. Indorama fait beaucoup de distribution au Nigeria et un peu aussi sur l'Afrique de l'Ouest. Dangote, moins, ils se focalisent plutôt sur le Brésil. Donc, j'aimerais bien voir ces grands producteurs africains avoir une stratégie africaine.
Et est-ce que le prix des engrais africains est suffisamment attractif, aujourd'hui, pour concurrencer les engrais russes par exemple ?
Si je reste sur l'exemple d’urée, c’est sur le coût de production qu’on va comparer le produit russe et le produit nigérian. Les producteurs russes ont un accès à un gaz qui est très compétitif... les Nigérians aussi. Mais les Russes ont besoin d’affréter ce produit. Vous avez un élément de prix additionnel, alors que les Nigérians ne vont pas l'avoir. Donc, on peut produire du produit assez compétitif en Afrique. On a un défi, il faut qu'on persévère, persévère, persévère... parce que le potentiel est là et il est énorme. Et l'Afrique va nourrir sa population, mais surtout le monde. Et pour ça, on a besoin de travailler avec les gouvernements africains pour ramener des réglementations qui vont encourager de plus en plus le développement du secteur agricole en Afrique.
À lire aussiEn Afrique de l'Ouest, la filière engrais peut créer de l'emploi, surtout pour les jeunes
À lire aussiPeut-on pallier le manque d’engrais en Afrique?
Sat, 11 May 2024 - 951 - Présidentielle au Tchad: selon T. Vircoulon, «On ne peut pas connaître la vérité des résultats de la commission électorale»
Au Tchad, le président de transition Mahamat Idriss Déby est élu dès le premier tour, selon les résultats provisoires annoncés hier soir par la Commission électorale. Avec 61 % des voix, il arrive loin devant le Premier ministre Succès Masra, crédité de 18 %, et l'ancien Premier ministre Pahimi Padacké, qui frôle les 17 %. Que penser de ces résultats ? Et que prévoir après l'annonce par le Premier ministre qui affirme que c'est lui qui a gagné ? Thierry Vircoulon est chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Il livre son analyse au micro de Christophe Boisbouvier.
RFI : Êtes-vous surpris par l'annonce de la victoire du président de la transition dès le premier tour ?
Thierry Vircoulon : Oui, on est surtout surpris que l'agence électorale Ange ait pu compiler les résultats des 26 000 bureaux de vote aussi vite, puisque elle-même disait qu’il lui faudrait quand même un certain nombre de jours pour faire cette tâche et qu'elle avait jusqu'au 21 mai pour l'accomplir. Donc 26 000 bureaux de vote compilés avec les résultats analysés et compilés aussi vite, c'est très très surprenant.
Et pourquoi cette accélération, peut-être pour ne pas laisser enfler la polémique ?
Oui, je crois que la raison, c'était de prendre de vitesse Succès Masra, d'éviter qu’il y ait en effet des annonces prématurées sur les résultats électoraux et que ça fasse monter en fait la température à Ndjamena et dans les grandes villes du pays. Et je pense que, en effet, cette soudaine accélération du travail de compilation de l'Agence électorale avait quand même des intentions politiques assez claires.
À quel autre scrutin vous fait penser cette élection ?
Cela fait penser au scrutin de 1996, qui était aussi l'élection de sortie de la première transition et qui a été remportée par le président Idriss Déby. Mais à ce moment-là, cette élection a été remportée au deuxième tour et pas au premier tour, et donc là, on voit quand même la différence. Mais c'est la deuxième transition tchadienne qui se termine avec une victoire électorale d'un membre de la famille Déby.
L'autre fait marquant de la soirée d'hier, c'est que le Premier ministre Succès Masra, trois heures avant l'annonce des résultats officiels, a annoncé que c'est lui qui avait gagné et a appelé les Tchadiens à se mobiliser pour ne pas se laisser voler leur victoire. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Ça fait penser que les jours qui viennent vont être extrêmement tendus puisqu’on a une situation assez classique, si je puis dire, dans les élections africaines, où la commission électorale proclame un vainqueur et puis son challenger conteste les résultats et dit que c'est lui le vainqueur. Ce qui est clair, c'est que, dès hier après-midi, l'armée tchadienne a été déployée à Ndjamena. Et donc les jours qui viennent vont être très militarisés parce que le pouvoir s'attend à une épreuve de force avec les partisans de Succès Masra, puisqu'il a appelé dans son message à ne pas se laisser voler la victoire. Et donc il y a un risque d'épreuve de force dans la rue.
Depuis un mois, beaucoup de Tchadiens disaient que le duel entre le président Mahamat Idriss Déby et le Premier ministre Succès Masra était une mascarade et que les deux hommes avaient conclu, en fait, un accord secret. Est-ce que le scénario d'hier soir ne dément pas cette thèse de la collusion ?
Il y a eu un accord, mais c'était un accord pour le retour de Succès Masra et le fait qu'il puisse être candidat aux élections... Est-ce qu'il y avait un accord sur l'après élection ? Là, en effet, on peut en douter, parce qu’on a vu que, ces dernières semaines, Succès Masra est vraiment entré dans le jeu électoral et a mené une vraie campagne électorale qui a provoqué un vrai engouement populaire autour de sa candidature. Et donc, s'il y a eu un accord, il est clair qu'aujourd'hui il ne tient plus. Mais peut-être n'y en a-t-il pas eu. Mais en tout cas, il s'est posé vraiment comme le challenger du président et maintenant il réclame la victoire, contrairement à ce que vient de dire l'Agence électorale.
Et du coup, est-ce que la cohabitation entre le président et le Premier ministre peut tenir longtemps ?
Non, il est évident qu’avec le discours qu’il vient de faire avant la proclamation des résultats, ce n'est plus possible. Mais il faut quand même rester prudent. Il peut toujours y avoir des arrangements de dernière minute, notamment peut-être pour éviter la confrontation dans la rue dont je parlais tout à l'heure.
Selon les résultats provisoires annoncés hier, le Premier ministre Succès Masra est talonné par une autre personnalité du sud du pays, l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Padacké. Quel est votre commentaire ?
Le problème de cette élection, comme d'ailleurs trop souvent dans les élections africaines maintenant, c'est qu’il n'y a plus d'observateurs. Il n’y a pas d'observateurs internationaux véritablement. Et même pas les observateurs nationaux qui avaient été formés, leurs accréditations ayant été refusées par l'agence électorale. Donc maintenant on se retrouve avec des élections où personne n'est capable de contre vérifier les résultats annoncés par la commission électorale. Par conséquent, on peut dire 16%, 15%, 20%, on a un peu l'impression que, de toute façon, les chiffres n’importent plus puisqu’on ne peut pas connaître leur vérité. Et on ne peut pas connaître leur vérité parce que les organisateurs électoraux ont vraiment tout fait pour qu'il n'y ait pas d'observation impartiale possible.
Fri, 10 May 2024 - 950 - A. Agbénonci: dans le bras de fer Bénin-Niger: «Il faut désigner des intermédiaires, personne ne sera gagnant»
Rien ne va plus entre le Bénin et le Niger. Voilà bientôt six mois que le Niger refuse de rouvrir la frontière entre les deux pays. Et mercredi 8 mai, le président béninois Patrice Talon a confirmé l'information RFI de ce lundi, à savoir la décision du Bénin de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien au niveau de la plateforme de Sémé Kpodji, sur les côtes béninoises. Jusqu'à 2023, Aurélien Agbénonci était le ministre béninois des Affaires étrangères. Aujourd'hui, il travaille auprès du Forum de Crans-Montana, qui fait du conseil stratégique. De passage à Paris, il livre son analyse au micro de Christophe Boisbouvier.
RFI : Après le refus du Niger de rouvrir sa frontière avec le Bénin, celui-ci décide de bloquer l'évacuation du pétrole nigérien, quelle est votre réaction ?
Aurélien Agbenonci : J'ai été un peu surpris d'apprendre que le gouvernement du Bénin avait pris une telle mesure. Je pensais qu'on était dans une démarche d'apaisement et de retour à la sérénité, donc j’ai été très surpris.
À l'origine de cette crise entre les deux pays, il y a le putsch au Niger le 26 juillet dernier et la décision du Bénin de s’associer aux autres pays de la Cédéao. Ils ont alors sanctionné les putschistes de Niamey. Est-ce que c'était, d'après vous, la bonne décision ?
Je m'étais abstenu pendant un an de m’exprimer sur ces questions-là, une sorte de silence que je m’étais imposé volontairement, et je me suis dit qu'après un an, il était peut-être temps que je me fasse entendre pour contribuer à la recherche de solutions.
Je pense que ce n'était pas la bonne décision parce que la Cédéao, qui a recommandé ces sanctions qui sont plutôt radicales, est elle-même dans une crise identitaire. On parle d'une Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, puis on s'est retrouvé dans une situation où la communauté économique est partie directement sur un terrain politique. Et lorsque vous imposez des sanctions politiques - alors que votre rôle est de rester d'abord dans la recherche de convergences économiques pour pouvoir pousser la croissance et favoriser le développement dans cet espace communautaire -, forcément, on arrive à une situation difficile comme celle-là.
Et donc la décision, elle était dure, elle est conforme à un protocole qui existe, le protocole sur la gouvernance de la Cédéao. Et je pense que, très sérieusement, on aurait dû trouver une manière un peu plus simple de régler le problème, à savoir forcer sur le dialogue, trouver des compromis, établir des échéances de retrait des forces qui ont été responsables de ces changements, de ces ruptures dans l'ordre constitutionnel. Ce sont des choses qui ont déjà fonctionné dans le passé, mais je crois qu'on est allés un peu trop fort et, quand on va trop fort, parfois, ça ne marche pas.
À la fin de l'année dernière, le Bénin a assoupli sa position à l'égard du Niger. Le président Talon a annoncé sa volonté de normaliser les relations et de rouvrir la frontière Bénin-Niger, mais le Niger a refusé la main tendue. Qu'en pensez-vous ?
En fait, ce qu’il s'est passé, c'est que le dialogue a été vicié. Il y a eu des suspicions, des accusations de part et d'autre qui, forcément, ont fait disparaître la confiance entre les parties. Ensuite, je crois que le Bénin, peut-être, a sous-estimé l'importance du Niger dans son économie. Et on a vu le résultat plus tard, la situation du port de Cotonou en a souffert.
Et du coup, le Togo en a profité.
Le Togo en a profité. J'ai écouté les autorités des deux pays et j'ai compris qu'en fait, le Togo n'avait pas préparé spécialement une manœuvre contre le Bénin. Le Bénin non plus n'avait pas prévu que les choses prendraient une telle proportion et je pense qu’une saine appréciation de la réalité et du rôle de chacun aurait pu amener à éviter cette situation.
Pour justifier son refus de la normalisation, la junte au pouvoir au Niger a accusé le Bénin d'abriter secrètement une base militaire française dans le nord de votre territoire, est-ce que c'est crédible ?
Il ne m'appartient pas de répondre à cela, puisque je ne suis plus aux affaires depuis maintenant 12 mois, mais je ne pense pas que cette lecture est exacte.
Et c'est en effet catégoriquement démenti par les autorités béninoises.
Je n'ai pas de raison de ne pas les croire.
Ces derniers jours, le ton est monté entre Niamey et Cotonou. C'était à l'occasion de la future inauguration de la plate-forme pétrolière de Sèmè-Kpodji, sur la côte béninoise. Le Niger a alors décidé d'envoyer une délégation au Bénin sans prévenir les autorités béninoises, en demandant simplement aux Chinois de la compagnie pétrolière CNPC de faire passer le message au Bénin. C'est un peu vexant, non ?
Je n'ai pas les détails de ce qu’il s'est passé. Ce que je sais, c'est qu'il faut trouver des mesures d'apaisement. Je crois que le projet de pipeline est un projet important. C'est un beau projet. Je me souviens moi-même avoir été visiter les installations avec l'ancien président Bazoum lorsqu’il visitait le Bénin. Disons que le projet de pipeline mérite mieux que ce qu’il se passe.
La compagnie pétrolière chinoise CNPC a avancé le 12 avril dernier quelque 400 millions de dollars au pouvoir militaire nigérien. Mais cette avance, elle va être très vite consommée par le Niger. Et puis après, si le pétrole ne coule pas, il n'y aura plus d'argent pour le Niger. Est-ce qu'un jour ou l'autre les deux parties ne vont pas devoir revenir à la table, peut-être sous médiation chinoise ?
Je ne sais pas quelle sera la médiation, mais je crois qu'il faut désigner tout de suite des intermédiaires pour leur permettre de se parler. Et, le plus important pour moi, c'est que cette escalade s'arrête. Personne ne sera gagnant dans cette guerre, personne.
À lire aussiLe Bénin interdit aux navires de charger du pétrole nigérien tant que Niamey ne rouvre pas sa frontière
Thu, 09 May 2024 - 949 - RDC: «La plupart du temps, il y a une saine collaboration entre l'Église et l'État»
En République démocratique du Congo (RDC), le torchon brûle entre le pouvoir politique et l'Église catholique. Il y a dix jours, on a appris que le cardinal archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, était menacé de poursuites judiciaires pour « propos séditieux » de nature à décourager les militaires qui combattent dans l'est du pays. Mgr Ambongo passera-t-il un jour en procès ? L'historien congolais Isidore Ndaywel est l'un de ses proches. Il est aussi le coordinateur national du puissant Comité laïc de coordination.
RFI : Des menaces de poursuites judiciaires contre le numéro un de l'Église catholique au Congo [Fridolin Ambongo], est-ce que ce n'est pas une première dans l'histoire de ce pays ?
Isidore Ndaywel : C'est vrai qu'il existe une lettre du procureur général de la Cour de cassation au procureur de la Cour d'appel de Matete, l'instruisant à ouvrir une action pénale à l'endroit du cardinal, mais ceci demeure une lettre d'intention.
Dans une interview au Figaro, le Président Tshisekedi lui reproche d'avoir dit récemment que le Congo armait les miliciens hutu FDLR, et de s'être fait ainsi le « propagandiste du Rwanda ».
Il faut préciser que le cardinal Fridolin Ambongo, son discours est de dire que la conférence épiscopale du Congo, la CENCO, condamne la rébellion, condamne les violences de l'est. Récemment encore, les évêques de la CENCO viennent de le faire pour ce qui s'est passé à Mugunga, près de Goma. Mais le cardinal a voulu dire, je crois, qu’il y a aussi des turpitudes qui relèvent de nous-mêmes. Je pense que c'est là où, effectivement, une telle déclaration n'est pas pour plaire au pouvoir, au président de la République. Donc effectivement, nous sommes en présence d'une situation conflictuelle. Mais il ne faut pas non plus qu'on exagère lorsqu'il y a des couacs à certains moments, surtout qu'il y a eu encore récemment un accord-cadre entre le Saint-Siège et l'État congolais.
En décembre dernier, le cardinal avait qualifié la présidentielle de « gigantesque désordre organisé ». Est-ce que la crispation actuelle entre le pouvoir et l'Église catholique ne date pas de ce moment-là ?
Disons que, globalement, nous savons que l'Église au Congo constitue une force tranquille. Mais une force de gauche qui, à plusieurs moments de notre histoire, rappelle à l'État le bien-fondé d'un certain nombre de principes de gestion. S'agissant des élections, oui, bien sûr. On savait depuis le départ que les élections allaient aboutir à énormément de difficultés, en commençant d'abord par la carte d’électeur qui n'était pas visible pour la plupart des citoyens. Donc voilà, il y a eu des problèmes réels à propos des élections.
Pourquoi dites-vous que l'Église est une force de gauche ? Pourquoi pas une force de droite ?
Je dis que c'est une force de gauche dans la mesure où cette force se trouve au ras du sol, auprès du petit peuple, de la réalité du quotidien.
Et peut-on dire que l'Église est, au Congo, une sorte de contre-pouvoir ?
Absolument, l'Église est une sorte de contre-pouvoir. Mais l'Église s'en tient aux institutions légales du pays. Et sur ce point-là, l'Église reste dans son rang. Nous n'avons pas eu au Congo la situation qu'on a eue au Congo-Brazzaville, où il y a eu un prélat [l’abbé Fulbert Youlou] qui est devenu le chef de l'État, ou en Centrafrique, où nous avons vu le père Barthélémy Boganda devenir un homme politique. Non, le Congo n'a jamais eu cette situation depuis le cardinal Malula, jusqu'à maintenant, avec Fridolin Ambongo.
Depuis la présidentielle de décembre, les opposants Moïse Katumbi et Martin Fayulu sont beaucoup moins audibles. Est-ce que l'Église catholique n'est pas en train d'occuper le terrain de l'opposition face à Félix Tshisekedi et de prendre le leadership de cette opposition ?
L’Église ne fait pas de la politique directement. L'Église s'occupe des problèmes essentiellement de type socio-économique. En ce qui concerne les questions frontales de la politique, normalement, c'est l'opposition et ça ne relève pas de l'Église.
On sait que Monseigneur Fridolin Ambongo fait partie du « C9 », le Conseil des cardinaux les plus proches du pape, depuis quatre ans. Est-ce qu'aujourd'hui ce début de procédure judiciaire contre le cardinal, ce n'est pas le signe que Félix Tshisekedi n'est pas dans un moment d'apaisement avec le Vatican et avec votre Église ?
Je ne pense pas, je voudrais quand même rappeler que, lorsque Fridolin Ambongo a été fait cardinal, le président Tshisekedi a fait le déplacement de Rome.
Donc, vous ne pensez pas que Monseigneur Fridolin Ambongo passera un jour en procès ?
À mon avis, non. Je constate que, depuis qu'il y a eu cette lettre, elle demeure une lettre. On n'a pas été au-delà d'une lettre.
À lire aussiRDC: l'enquête judiciaire qui vise le cardinal Fridolin Ambongo suivie de près au Vatican
Wed, 08 May 2024 - 948 - Niger: «Mahamadou Issoufou est le commanditaire du putsch», selon la fille du président déchu Mohamed Bazoum
Hinda est l’une des cinq enfants du président nigérien Mohamed Bazoum, qui est séquestré depuis neuf mois à Niamey avec son épouse. Ce mardi matin, en exclusivité sur RFI, elle lance un « appel de détresse » en faveur de la libération de ses parents. Et elle accuse l’ancien président Mahamadou Issoufou, d’être non seulement à l’origine du putsch qui a renversé son père en juillet 2023, mais aussi d’être derrière les poursuites judiciaires dont son père est menacé vendredi prochain devant la Cour d'État de Niamey.
RFI : Dans une tribune, vous dites que le cerveau du putsch [du 26 juillet 2023] n'est autre que l'ancien président Mahamadou Issoufou, l'ami de toujours de votre père. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Hinda Bazoum : À son comportement, tout d'abord. Il n'a jamais condamné le putsch. Pire, il s'affiche même aux côtés des putschistes. Il est allé présenter ses vœux pour l'Aïd et saluer [le général] Tiani au palais présidentiel. Quel démocrate fait ça ? Il était l'ami de notre père, mais n'a fourni aucun effort pour lui. Il n'a jamais cherché à le rencontrer ni à exiger sa libération. Il n'a jamais cherché à rentrer en contact avec nous, les enfants. Chose plus curieuse encore, lorsque la communauté internationale souhaitait exiger un retour à l'ordre constitutionnel, au lieu d’abonder dans le même sens, il a plutôt plaidé pour une courte transition, une nouvelle Constitution et de nouvelles élections, sûrement pour pouvoir revenir au pouvoir. Lui qui se voulait grand démocrate est en fait un grand dictateur.
Est-ce que vous pensez que Mahamadou Issoufou a pris le train en marche, qu'il a profité du putsch pour faire ce que vous dites ?
Non, pas du tout. C'est bien lui le commanditaire du putsch. L'idée a mûri dans la tête d'une seule personne, Mahamadou Issoufou. Mon père était sûrement devenu trop gênant pour les gens de son clan. Du temps de mon père, il faut dire que la lutte contre la corruption était bien lancée. Elle avait permis l'arrestation de 40 cadres par la justice, dont les membres du parti PNDS de mon père, ce qui est inédit au Niger et qui prouve que la justice était indépendante. Il était en train de mettre fin à l’affairisme, à la gabegie au sommet de l'État. Et c'est là qu'Issoufou s’est senti en danger à travers les intérêts de ses amis et, certainement, les siens.
Donc il a véritablement dupé votre père dans les derniers jours d'avant le 26 juillet ?
Beaucoup plus, il l'a trahi. Il a trahi tout un peuple, il a trahi ses amis de lutte. C'est comme un cauchemar pour nous.
Hinda Bazoum, vous allez plus loin puisque vous dites aujourd'hui que la menace de levée d'immunité de votre père afin de pouvoir le juger pour haute trahison, c'est une manœuvre de l'ancien président Issoufou lui-même…
Oui, tout à fait, parce que, face à la résistance de mon père, à son refus de démissionner, je pense que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas imaginé au début. La dernière cartouche d'Issoufou serait de lever l'immunité de mon père pour le faire condamner, de sorte à le rendre inéligible pour laisser le champ libre à Issoufou de cette manière. Et ils ont créé de toutes pièces une nouvelle Cour d'État qui se substitue aux tribunaux de la Constitution, à la tête de laquelle est nommé un proche d’Issoufou.
L'audience de la Cour d'État de Niamey est prévue vendredi prochain, qu'est-ce que vous attendez des magistrats de cette Cour ?
J'espère qu'ils feront preuve d'impartialité. C'est un rendez-vous avec l'histoire qui se présente à eux, il faut qu'ils en aient conscience.
Si votre père démissionnait de ses fonctions de président de la République, tout irait mieux pour lui, font savoir les officiers putschistes. Pourquoi refuse-t-il de démissionner ?
Je ne pense pas que tout irait mieux pour lui, non. Et mon père ne démissionne pas parce que c'est un démocrate sincère. Il est courageux et ce combat, il le mène pour le Niger tout entier et pas que pour lui. C'est un homme de principes, mon père, et je peux vous assurer qu'il continuera le combat.
En janvier, Hinda Bazoum, votre frère Salem, qui était séquestré avec vos parents, a été libéré. Est-ce que vous avez cru à ce moment-là que c'était bon signe pour vos parents ?
Oui, bien sûr. C'était déjà un premier soulagement pour nous que notre petit frère sorte de cette prison. On a espéré et rien n'est jamais venu. C'est dur pour nous, vraiment très dur.
C'est le Togo et le président Faure Gnassingbé qui ont aidé par leur médiation à la libération de votre petit frère. Est-ce que ce pays ou d'autres pays de la Cédéao peuvent intercéder en faveur de votre père et de votre mère ?
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous appelons les démocrates sincères et la Cédéao, qui a toujours rendu hommage à la bonne gouvernance de mon père, à nous aider à obtenir la libération de nos parents et à rétablir la démocratie au Niger. Il est du devoir des chefs d'État africains effectivement de défendre la démocratie et d'obtenir la libération de nos parents.
Donc c'est un appel que vous leur lancez ?
C'est un appel que je lance effectivement. Un appel de détresse !
Hinda Bazoum, c'est la première fois que vous vous exprimez de vive voix dans un média international. Je sais que ce n’est pas facile pour vous de prendre la parole. Pourquoi tenez-vous à le faire aujourd'hui ?
Parce que l'heure est grave. Si je sors du silence, c'est parce qu'il y a urgence. J'ai décidé de prendre la parole au nom de mes frères et sœurs pour dénoncer cette injustice et surtout désigner l'unique responsable. Nous nous sentons abandonnés et on espère sincèrement que la communauté internationale n'oubliera pas nos parents.
Avez-vous peur qu'on oublie vos parents ?
Effectivement, c'est une peur, mais nous espérons que mon appel sera entendu et que notre voix sera portée loin pour la libération de nos parents et la démocratie au Niger.
À lire aussiNiger: la fille de l'ancien président Bazoum accuse Mahamadou Issoufou d'être le cerveau du coup d'État
Tue, 07 May 2024 - 947 - Centrafrique: «Sur le terrain, la coopération entre Faca et Minusca est une avancée»
En Centrafrique, voilà tout juste deux ans que la diplomate rwandaise Valentine Rugwabiza dirige les 14 000 casques bleus de la Minusca, l’une des plus importantes missions de l’ONU dans le monde. À son arrivée, les relations de la Minusca avec le pouvoir centrafricain étaient tendues. Aujourd’hui, elle se félicite d’avoir « rétabli une coopération productive ». Mais comment se passe la cohabitation de ses casques bleus avec les paramilitaires russes de Wagner ? Entretien.
RFI : Vous avez rencontré récemment le Chef d'état-major des FACA, les forces armées centrafricaines. Sur le terrain, comment ça se passe ? Vous faites des patrouilles mixtes ?
Valentine Rugwabiza : Nous avons une très bonne collaboration et coopération ensemble et cela, clairement, c'est une des avancées du travail qui a été fait au courant de ces deux années. Notre coopération se traduit justement par un mieux faire et un plus faire, ensemble. Et ce mieux faire, ce plus faire, ce sont des patrouilles mixtes, mais c'est aussi un soutien au déploiement, y compris dans des zones où les forces armées centrafricaines n'ont pas été présentes depuis des décennies. Nous avons eu l’opportunité de le faire à la frontière avec le Soudan et à la frontière au sud-est du pays.
Et vous avez assez d'équipements ? Est-ce qu'il ne faut pas faire plus, au niveau du Conseil de sécurité de l’ONU ?
C'est un défi très clair et je saisis l'opportunité de vos antennes larges. Ceci est un défi que j'ai porté à l'attention du Conseil de sécurité. Dans un pays comme la Centrafrique, nous avons besoin de beaucoup plus de capacités logistiques. Il s'agit d'un immense pays, mais où il n'y a quasiment pas d'axes routiers. Donc clairement, nous sommes aujourd’hui à une phase où, pour stabiliser et consolider les acquis, nous avons besoin que d'autres partenaires investissent dans des projets d'infrastructures. Donc il est très bienvenu que la Centrafrique soit en train de renouer un certain nombre de partenariats bilatéraux.
Il y a aussi d'autres forces de sécurité sur le territoire centrafricain, notamment les quelque 2 000 paramilitaires russes. Il y a quelques semaines, le ministre centrafricain de la Communication, Maxime Balalou, a déclaré que des soldats russes se déployaient dans le sud-est pour faire face à la montée de l'insécurité. Est-ce à dire que vous cohabitez, voire faites des patrouilles mixtes entre la MINUSCA et ces paramilitaires russes ?
Cela je peux vous le dire, absolument pas. Effectivement, nous intervenons sur un terrain où il y a plusieurs acteurs. Cependant, nos mandats sont différents. Notre mode opératoire, c'est un mode opératoire de travail avec les forces centrafricaines, pas avec d'autres personnels de sécurité. Et notre redevabilité est connue. Nous sommes redevables aux membres des Nations unies, au Conseil de sécurité et au siège des Nations unies.
Mais sur le terrain, en province, les casques bleus côtoient les autres forces de sécurité qui sont là. Et comment ça se passe cette cohabitation, notamment avec ces forces de sécurité russes ? J'imagine qu'il y a quand même… ne serait-ce que des échanges d'informations, non ?
Eh bien, ces échanges n'existent pas. C'est pour ça que je n'utiliserai pas le mot « côtoyer », parce que nous opérons de manière différente, de manière parallèle. Si parfois il y a besoin absolument d'avoir un échange d'informations, nous le faisons par la partie centrafricaine et les forces centrafricaines. Je suppose qu'elles jouent leur rôle de coordination avec tous ceux qui sont invités sur leur territoire.
Valentine Rugwabiza, vous êtes une grande diplomate rwandaise et il y a actuellement sur le territoire centrafricain quelque 3 000 soldats rwandais, 2 000 pour la MINUSCA et quelque 1 000 hommes dans le cadre des relations bilatérales entre Kigali et Bangui, certains d'ailleurs pour faire la protection rapprochée du président Touadéra. Est-ce que c'est peut-être aussi votre nationalité qui a permis de rétablir une coopération, comme vous dites, « productive » avec les autorités centrafricaines ?
En réalité, cette coopération productive, elle est basée non pas sur un passeport ou sur une nationalité. Elle est basée sur des actions très concrètes. À la prise de mes fonctions, les autorités centrafricaines, ce qui est normal, et le gouvernement, ont attendu de voir comment j'allais mettre en œuvre mes priorités et si j'avais l'intention de travailler en étroite coopération. Donc, je ne pense pas que ce soit mon passeport qui était considéré, mais plutôt les actions et les choix.
Mais franchement, Madame Rugwabiza, le fait que vous veniez d'un pays qui a une coopération très forte avec la République centrafricaine, ça ne vous facilite pas les choses, quand même ?
Il est clair que je suis personnellement reconnaissante envers mon propre pays pour sa contribution et que cette contribution, qui est très appréciée par la partie centrafricaine, clairement oui, vous donne un quota de confiance au départ, mais ce n'est qu'un quota. Vous devez démontrer ensuite par des actions concrètes si, effectivement, cette confiance octroyée était méritée.
À lire aussiEn Centrafrique, la situation sécuritaire se détériore dans plusieurs localités du pays
Mon, 06 May 2024 - 946 - «Déborder l'anthropologie», une exposition pour «faire émerger des figures peu connues en France»
Jusqu'au 12 mai, le musée du quai Branly met à l’honneur trois femmes afro-américaines : la danseuse Katherine Dunham, la romancière Zora Neale Hurston, et la militante Eslanda Goode Robeson. Trois femmes qui, par leur art et leur conscience politique, ont contribué à donner un éclairage neuf sur les passerelles culturelles entre Afrique et Amérique. Entretien avec Sarah Frioux-Salgas, commissaire de l'exposition intitulée Déborder l'anthropologie.
À écouter aussi«Regarder l'Afrique pour mieux se voir»
Sat, 04 May 2024 - 945 - Haman Mana, journaliste camerounais: «Martinez Zogo était traqué plusieurs jours avant sa mort»
J'aime l'odeur de l'encre au petit matin sur le papier, C'est le titre d'un ouvrage qui vient de sortir aux Éditions du Schabel. C'est un hommage à la presse écrite, où son auteur, le journaliste camerounais Haman Mana, raconte ses 35 années de combat pour la liberté d'expression. Sa solidarité avec le prisonnier Amadou Vamoulké, sa dernière rencontre avec le journaliste supplicié Martinez Zogo. En ligne des États-Unis, où il vit actuellement, et à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Haman Mana témoigne au micro de Christophe Boisbouvier.
RFI : C'est pendant les années de braise [crise politique camerounaise de 1990-1992] que vous débutez dans le journalisme. Pour le journal pro-gouvernemental Cameroon Tribune, vous couvrez la présidentielle de 1992 où, officiellement, Paul Biya arrive premier de justesse devant John Fru Ndi. Comme reporter, vous êtes aux premières loges à la commission nationale de recensement des votes et, aujourd'hui, vous écrivez : « J'ai assisté en direct au fonctionnement de cette moulinette qui se met en marche, à chaque fois, pour reconduire les mêmes aux commandes du Cameroun ».
Haman Mana : Oui, bien sûr. Cette présidentielle a lieu en octobre 1992. Mais, il y a avant, au mois de mars ou avril 1992, des législatives où, clairement, l'opposition les a remportées. L'opposition a gagné parce que le code électoral permettait que, dans chaque circonscription, on fasse immédiatement le décompte et la promulgation des résultats sur place. C'étaient les présidents des tribunaux locaux qui étaient les présidents des commissions électorales. Après avoir perdu les législatives de 1992, le gouvernement s’est donc juré de ne plus jamais rien perdre. Et c'est comme ça que, lors de la présidentielle, le scénario a été mis en place pour ne pas perdre l'élection, où tout le monde est aujourd'hui d'accord pour dire que John Fru Ndi avait gagné.
Cinq ans plus tard, en 1997, nouvelles législatives, avec ce que vous appelez «la mise en place d'une machine de fraude électorale sans précédent ». À ce moment-là - vous venez de prendre la direction du journal Mutations -,vous décidez de prendre la plume ?
Oui, j'avais écrit à l'époque un éditorial qui avait pour titre Ballot or Bullet, ce qui veut dire : « le bulletin de vote ou les balles ». C'est-à-dire que, si on ne peut pas s'exprimer par le bulletin de vote, finalement, c'est une affaire qui va s'achever dans le sang. Bon, en anglais, il y'a la belle allitération Ballot or Bullet. En français, ce n'est pas possible, mais c'est comme ça que je le disais déjà en 1997. D'ailleurs, ça nous a valu l'interdiction du journal Mutations pendant quelque temps, mais à l'époque, c'était déjà cela.
Je relis aujourd'hui votre article de 1997, vous écrivez : « L'alternance est-elle possible au Cameroun par la voix des urnes ? La réponse est - hélas - non. »
Oui, il y a 25 ans. Aujourd'hui, je le réitère. Depuis ces années-là, le contrôle sur les votants, sur les votes et sur les résultats est constant et permanent. C'est pour ne pas avoir de surprise à la fin.
Parmi les personnalités qui sont toujours en prison à l'heure actuelle dans votre pays, il y a votre confrère Amadou Vamoulké. Dans votre livre, vous montrez la Une d'un journal où vous l'interviewez sous le titre Mes vérités à propos de la CRTV - la radiotélévision publique camerounaise, qu’Amadou Vamoulké avait justement dirigée à l'époque. Pensez-vous qu'il est vraiment en prison, comme le dit officiellement la justice, pour «détournement de biens publics » ?
Non, ce n'est pas possible. Si Monsieur Amadou Vamoulké devait être en prison, ça ne serait pas pour détournement de biens publics. Non, ce n'est pas possible. S'il était en prison pour détournement de deniers publics, pourquoi, aujourd'hui, nous en sommes à quelque 80 renvois juridiques ? C’est unique dans les annales de la justice dans le monde. On tourne à la centaine de renvois... Vous imaginez, une centaine de renvois ? Pour un procès en pénal ? C'est intenable pour cet homme qui, d'ailleurs, vient de perdre son frère cadet. Monsieur Amadou Vamoulké a perdu son frère cadet hier et c'est le quatrième frère qu'il perd depuis qu'il est en prison... Ce n'est pas possible !
En janvier 2023, c'est l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, à Yaoundé. Vous révélez que, quatre jours avant son enlèvement, il vous a rendu visite au siège de votre journal Le jour à Yaoundé et vous a confié que des gens de l'entourage de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga le menaçaient de plus en plus. Et il a eu cette phrase, en parlant de ces gens : « Ils sont devenus fous, ils se croient tout puissants. En tout cas, je ne vais pas les lâcher ».
Exactement. Monsieur Martinez Zogo est venu à mon bureau et il m'a dit : « Écoute, tout le monde a peur de Jean-Pierre Amougou Belinga dans ce pays. J'ai l'impression qu'il n’y a que toi et moi, peut-être, qui avons le courage et le toupet de dire autre chose par rapport à Amougou Belinga». Je lui ai dit que je n’avais pas de soucis, et c'est là qu'il a commencé à me parler, à me dire qu’il était visé et que je l’étais également. Ce n'était pas une pratique courante au Cameroun, ça n'était jamais arrivé, le fait qu'on enlève un journaliste, qu'on aille l'exécuter quelque part après l'avoir menacé... Et Martinez Zogo, on voyait qu'il avait peur. C'était un garçon courageux, mais on sentait quand même qu'il avait peur, puisqu'au moment où je suis sorti pour le raccompagner, j'ai vu qu’il avait loué un taxi, qu'il l’avait garé très, très loin. Il était absolument sur ses gardes, donc il était déjà traqué. Plusieurs jours avant, il se sentait traqué. Il fonctionnait déjà avec un taxi en location, il était déjà traqué.
Fri, 03 May 2024
Podcasts similar to Le grand invité Afrique
 Au Cœur de l'Histoire - Des récits pour découvrir et apprendre l'Histoire Europe 1
Au Cœur de l'Histoire - Des récits pour découvrir et apprendre l'Histoire Europe 1 La libre antenne - Olivier Delacroix Europe 1
La libre antenne - Olivier Delacroix Europe 1 Les Récits extraordinaires de Pierre Bellemare Europe 1 Archives
Les Récits extraordinaires de Pierre Bellemare Europe 1 Archives Les pieds sur terre France Culture
Les pieds sur terre France Culture Affaires sensibles France Inter
Affaires sensibles France Inter Le Coin Du Crime La Fabrique Du Coin
Le Coin Du Crime La Fabrique Du Coin CRIMES • Histoires Vraies Minuit
CRIMES • Histoires Vraies Minuit Franck Ferrand raconte... Radio Classique
Franck Ferrand raconte... Radio Classique L'After Foot RMC
L'After Foot RMC Rothen s'enflamme RMC
Rothen s'enflamme RMC Super Moscato Show RMC
Super Moscato Show RMC Faites entrer l'accusé RMC Crime
Faites entrer l'accusé RMC Crime Entrez dans l'Histoire RTL
Entrez dans l'Histoire RTL Les Grosses Têtes - Les archives de Philippe Bouvard RTL
Les Grosses Têtes - Les archives de Philippe Bouvard RTL Les histoires incroyables de Pierre Bellemare RTL
Les histoires incroyables de Pierre Bellemare RTL L'Heure Du Crime RTL
L'Heure Du Crime RTL Parlons-Nous RTL
Parlons-Nous RTL
Other News & Politics Podcasts
 Les Grosses Têtes RTL
Les Grosses Têtes RTL Hondelatte Raconte - Christophe Hondelatte Europe 1
Hondelatte Raconte - Christophe Hondelatte Europe 1 L'œil de Philippe Caverivière RTL
L'œil de Philippe Caverivière RTL C dans l'air France Télévisions
C dans l'air France Télévisions Laurent Gerra RTL
Laurent Gerra RTL Enquêtes criminelles RTL
Enquêtes criminelles RTL Bercoff dans tous ses états Sud Radio
Bercoff dans tous ses états Sud Radio Hondelatte Raconte - Cote B Europe 1
Hondelatte Raconte - Cote B Europe 1 L’heure du crime : les archives de Jacques Pradel RTL
L’heure du crime : les archives de Jacques Pradel RTL Les récits de Stéphane Bern Europe 1
Les récits de Stéphane Bern Europe 1 Global News Podcast BBC World Service
Global News Podcast BBC World Service LEGEND Guillaume Pley
LEGEND Guillaume Pley L'Heure des Pros CNEWS
L'Heure des Pros CNEWS C ce soir France Télévisions
C ce soir France Télévisions RTL Matin RTL
RTL Matin RTL Le grand rendez-vous Europe 1
Le grand rendez-vous Europe 1 TOCSIN PODCAST TOCSIN MÉDIA
TOCSIN PODCAST TOCSIN MÉDIA Gaspard Proust - Les signatures d'Europe 1 Europe 1
Gaspard Proust - Les signatures d'Europe 1 Europe 1 Lenglet-Co and You RTL
Lenglet-Co and You RTL La Belle Histoire de France CNEWS
La Belle Histoire de France CNEWS