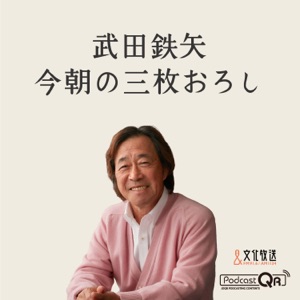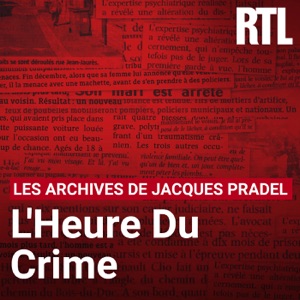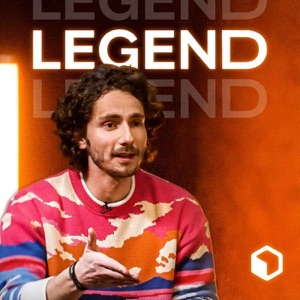Podcasts by Category
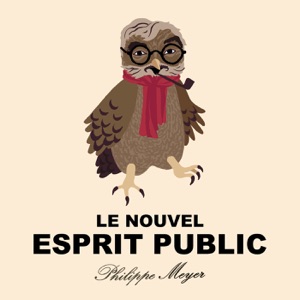
- 605 - Bada : Nouvelle-Calédonie, avec Jean-François Merle
Cette émission est une rediffusion. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 15 décembre 2021. Avec : - Jean-François Merle, conseiller d’Etat honoraire et ancien collaborateur de Michel Rocard. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. - Lucile Schmid, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. - Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. NOUVELLE-CALÉDONIE : UNE PAGE MAL TOURNÉE Le 12 décembre 2021, les habitants de Nouvelle-Calédonie ont été appelés pour la troisième fois à s’exprimer par référendum sur l’indépendance de leur île. Située à 1 400km à l’Est de l’Australie, elle est une collectivité d’Outre-Mer française à statut particulier. Le territoire a conservé des séquelles de sa colonisation, fracturé entre d’un côté au nord et dans les îles Loyauté des populations indigènes kanakes, principale force indépendantiste, et au sud une large majorité de « Caldoches », descendants d’Européens, fournissant le gros des forces loyalistes. L’opposition historique entre ces deux camps a dégénéré et basculé dans le sang au cours des années 80, avant d’aboutir à la négociation, puis aux accords de Matignon-Oudinot en 1988 dont les visées étaient de pacifier les relations en entamant un processus d’émancipation. Dix ans plus tard, l’accord de Nouméa accordait une relative autonomisation à ces îles du Pacifique, en les dotant d’institutions propres et en leur promettant trois referendums sur leur indépendance dans les vingt ans. Si au cours des deux précédentes consultations, en 2018 et 2020, une majorité de Calédoniens a voté en faveur d’un maintien dans la République, l’écart s’est progressivement réduit et le « non » à la question « Voulez- vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? » ne l’a emporté l’an dernier qu’à 53,3% des voix. (56,4% en 2018).Le référendum du 12 décembre s’est traduit par un non à l’indépendance à 96,49% des voix et 3,4% de oui. Ses suites sont frappées d’incertitudes diverses en raison d’un appel au boycott d’une majorité des mouvements indépendantistes, qui souhaitaient un report du scrutin en arguant d’une situation sanitaire ne permettant pas le déroulement optimal de la consultation. Cet appel a été largement suivi puisque le taux de participation s’est établi à 43,90% cette année, contre près de 86% lors de la dernière consultation en 2020. Autant d’éléments qui complexifient les négociations nécessaires à la définition d’un nouveau statut pour le Caillou.L’île est placée au cœur de tensions entre la Chine et ses voisins en Asie, à la fois pour ses ressources, dans la mesure où elle concentre 15% des réserves mondiales de nickel, et son emplacement privilégié en Océanie, alors que l’Empire du Milieu tisse progressivement des liens par ses Nouvelles Routes de la Soie vers l’Europe. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 29 May 2024 - 57min - 604 - L’Ukraine à la peine / Nouvelle-Calédonie : la tourmente
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 24 mai 2024. Avec cette semaine : - Nicolas Baverez, essayiste et avocat. - Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. - Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. L’UKRAINE À LA PEINE La Russie a lancé le 10 mai une offensive surprise contre Kharkiv, deuxième ville du pays, emportant de l'aveu de l'état-major ukrainien des « succès tactiques ». L’Ukraine a été prise de court, ses forces étant affaiblies par le manque d'armements et d'hommes, du fait notamment de la lenteur de l'aide européenne et de l'arrêt quasi-total pendant des mois de celle venant des États-Unis. En visite à Kyiv, le 15 mai, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken a, pour la première fois, laissé entendre que les forces ukrainiennes pourraient frapper le territoire russe avec des armes fournies par les Etats-Unis. Depuis le début du conflit, les alliés de l’Ukraine étaient inflexibles : interdiction d’utiliser leurs missiles, drones ou obus pour bombarder des cibles situées hors du territoire souverain du pays. Seul le sol ukrainien – comprendre la Crimée et la partie du Donbass occupées par les Russes – pouvait être visé. Imposée par peur d’une escalade avec Moscou, cette restriction était respectée par Kyiv, qui dépendait trop des livraisons occidentales pour enfreindre la règle fixée par ses alliés. L’offensive lancée le 10 mai par Moscou dans la région de Kharkiv a changé la donne. Antony Blinken a également annoncé une aide militaire de 2 milliards de dollars pour renforcer les capacités de défense de l'Ukraine. Elle provient de l'enveloppe de 60 Mds de dollars en faveur de l'Ukraine, récemment approuvée par le Congrès américain après des mois de blocage. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rappelé que la défense aérienne constituait « le plus gros problème » de l'Ukraine, et son « plus grand déficit ». Selon lui, l'Ukraine aurait besoin de deux systèmes Patriot supplémentaires pour défendre Kharkiv. Les États-Unis ne sont pas les seuls à se mobiliser en faveur de l’Ukraine : le 13 mai, le chancelier allemand Olaf Scholz et ses homologues des pays nordiques ont appelé à renforcer d'urgence l'aide à l'Ukraine, alors que la France a annoncé la livraison à venir d'un nouveau lot de missiles Aster sol-air à Kyiv. Mardi, l’Union européenne a validé l'utilisation des revenus issus des avoirs russes gelés, soit 3Mds€ cette année dont 90% devraient aller aux forces armées ukrainiennes. Réunis depuis jeudi à Stresa en Italie, les ministres des finances du G7 discutent d'un plan américain visant à accorder à l'Ukraine jusqu'à 50 Mds de dollars de prêt garanti par les futurs bénéfices générés par les actifs russes immobilisés. Selon le commandant suprême des forces alliées en Europe, le général américain Christopher Cavoli, la Russie n'aurait pas les forces suffisantes pour aboutir à une percée majeure dans son offensive en cours en Ukraine. Dimanche, l'état-major ukrainien affirmait que les attaques russes dans la région de Kharkiv avaient été « légèrement ralenties ». Toutefois l'Organisation mondiale de la santé a indiqué mardi que plus de 14.000 personnes ont été déplacées en raison des combats. NOUVELLE-CALÉDONIE : LA TOURMENTE Pillages, incendies, échanges de tirs... La Nouvelle-Calédonie est secouée depuis le 13 mai par des émeutes qui ont déjà fait six victimes et de considérables dégâts qui pèsent sur la vie quotidienne des populations. Elles vont avoir de lourdes conséquences pour l'économie locale déjà traversée par une grave crise du nickel, qui représente plus de 25% des emplois du « Caillou », et près de 20% de son PIB et qui a connu en 2023 une baisse de prix de 45%. Afin de rétablir l’ordre, le président de la République a annoncé l'état d'urgence, entré en vigueur le 15 mai à Nouméa. Il consiste en un couvre-feu nocturne, l'interdiction des rassemblements, du transport d'armes et de la vente d'alcool ainsi que l'interdiction de l’application TikTok. La Nouvelle-Calédonie est devenue un Territoire d'outre-mer en 1946 et les Kanak ont obtenu la nationalité française, puis le droit de vote. Les violences qui ont opposé indépendantistes kanaks et loyalistes caldoches dans les années 1980, ont trouvé un apaisement en 1988 à travers les accords de Matignon négociés par Michel Rocard, accords qui organisaient un rééquilibrage économique et un partage du pouvoir politique. En 1998 l’accord de Nouméa a doté l'archipel d'un statut unique dans la République française reposant sur une autonomie progressive et sur trois référendums. Le premier, en 2018, voit le non à l'indépendance l'emporter à 56,7%, ce que confirme le deuxième, en 2020 (53,26% de non). En 2021 le non l'emporte à 96,5%, mais les indépendantistes contestent la validité du scrutin, marqué par une forte abstention (56,1 %) en pleine épidémie de Covid-19. Jusqu’à présent seuls les électeurs inscrits sur listes avant 1998 et leurs descendants étaient reconnus par le code électoral de Nouvelle-Calédonie pour les élections régionales. En votant un projet d’élargissement du corps électoral aux résidents depuis au moins dix ans, l’Assemblée nationale et le Sénat ont ouvert la voie à une réforme constitutionnelle qui devrait être approuvée par le Congrès. Les indépendantistes la rejettent, estimant qu'elle lèse le poids électoral du peuple autochtone Kanak. Quelque 271.400 habitants, selon le dernier recensement de 2019, vivent dans l'archipel. Parmi eux, 29% de la population est issue de la communauté européenne, dont les Caldoches, descendants des colons blancs. Les Kanak, premiers habitants du pays, sont progressivement devenus minoritaires sur l’archipel avec 41% de la population aujourd’hui, tandis que l’on compte 30 % d’habitants originaires d’îles du Pacifique ou répondant à la catégorie « autres ». Jeudi à Nouméa, le chef de l’État, à défaut de retirer le projet de réforme du corps électoral, s’est engagé à ne pas le « passer en force ». En cas d’accord politique global, il souhaite que le projet soit soumis au vote des Néocalédoniens. Conditionnant la fin de l’état d’urgence à la levée des barrages, il a aussi annoncé la mise en place d’une « mission de médiation et de travail » pour remettre tous les acteurs politiques autour de la table, avec la promesse d’un État « impartial ». Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 26 May 2024 - 58min - 603 - Bada « Si vous l’avez manqué » : Yves Jeuland, documentariste
Avec Yves Jeuland, réalisateur de documentaires : « Paris à tout prix »(sur les municipales de 2001) « Les Gens du Monde » (sur les journalistes du quotidien du soir), « Il est minuit, Paris s’éveille » (sur les cabarets de l’après-guerre), « Le Président » (sur Georges Frèche) «Un Temps de président », (sur François Hollande), « Un Français nommé Gabin », « Bleu blanc rose » (sur les espoirs et les désespoirs du monde homosexuel), « Charlie Chaplin, le génie de la liberté »... ces quelques titres d’un catalogue qui en compte plus de trente donnent une idée de l’éclectisme d’Yves Jeuland , réalisateur à qui chacun reconnaît une exceptionnelle capacité à se fondre dans le paysage humain qu’il filme et une curiosité qui conduit ses spectateurs d’étonnements en découverte et de découverte en compréhension. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 22 May 2024 - 45min - 602 - La France et l’Europe sont-elles prêtes pour la guerre ?
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 25 avril 2024. Avec cette semaine : - Jean-Dominique Merchet, journaliste spécialiste des questions de Défense. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Blick. - Michel Winock, historien et écrivain. LA FRANCE EST-ELLE PRÊTE POUR LA GUERRE ? Si l’armée française était, demain, déployée dans un « engagement majeur » de « haute intensité », comme en Ukraine, elle pourrait tenir un front de 80 kilomètres. Pas plus ! Le front ukrainien s’étend, lui, sur près de 1 000 kilomètres… Armée bonzaï, voire échantillonnaire, l’armée française dispose de presque tous les matériels - elle manque toutefois de drones et surtout de munitions – et ne compte pas suffisamment d’hommes. Nous sommes passés de 160.000 hommes en 1991, avant la fin de la conscription en 1996, à 15.000 en 2013. Désormais, on ne donne plus de chiffres d’effectifs. L’armée française ne fait donc pas masse. Parmi les réponses à cette situation, certains préconisent le retour au service militaire, d'autres un modèle de volontaires, d’une réserve à l’instar des Etats-Unis. Révélé à l’occasion de la guerre d’Ukraine, notre manque criant de munitions se résume à deux chiffres : pour la seule armée française, « les contrats actuels permettent de financer 6.000 coups par an, voire 9.000 coups au maximum ». C’est ce que les Ukrainiens tirent chaque jour… Toutefois, à l’abri de sa géographie, de sa dissuasion nucléaire et de ses alliés, la France peut faire l’impasse sur la perspective d’une guerre « à l’ukrainienne ». Il est impossible de prévoir quelle forme prendrait une future guerre. Aucune guerre ne ressemble à une autre. Il est donc impossible d’être prêt pour la guerre. Nous n’aurions pas de meilleur choix que de nous y adapter le plus vite et le mieux possible. Sur le plan militaire, cela suppose que les armées deviennent des « organisations apprenantes de combat ». Ce n’est pas gagné d’avance, à cause de leur structure très hiérarchisée et du poids des traditions en leur sein. L’impulsion doit donc venir du politique et de la société civile. Se pose dès lors la question de la capacité des Français qui passent pour égoïstes et indiscipliné à faire face collectivement aux exigences encore inconnues de la guerre. L’EUROPE EST-ELLE PRÊTE POUR LA GUERRE ? La Russie consacrera cette année, croit-on, 6 % de son PIB à la défense, tandis que l'Union européenne dépense en moyenne moins que l'objectif fixé par l'OTAN, soit 2 % du PIB. Depuis des décennies, l'Europe n'investit pas suffisamment dans sa sécurité et sa défense. Rompant avec la croyance née à la fin de la Guerre froide dans les fameux « dividendes de la paix », confrontée au plus grand défi en matière de sécurité depuis la Seconde Guerre mondiale, l’Europe sait qu’elle doit intensifier l’effort commencé avec la guerre d’Ukraine. L’industrie européenne de la défense a augmenté ses capacités de production de 50 %, et elle doublera sa production de munitions pour atteindre plus de 2 millions d'obus par an d'ici la fin de l'année prochaine. Lors de la réunion à Bruxelles le 21 mars, des chefs d’États et de gouvernements européens, à l’exception de la Hongrie et de la Slovaquie, tous les pays membres partageaient une obsession : accroître au plus vite l’aide militaire à Kyiv. L’Union européenne vit un moment de bascule, qui l’amène à envisager des initiatives encore inimaginables il y a peu. Même si les Vingt-Sept sont encore loin d’un accord sur le sujet, ils n’excluent plus de s’endetter ensemble pour financer leur industrie de défense et livrer des armes à l’Ukraine, comme ils l’ont fait pour contenir les ravages économiques de la pandémie liée au Covid-19. Les Vingt-Sept ont eu un premier échange sur la stratégie de renforcement des industries européennes de défense, présentée début mars par la Commission. Ils ont enfin demandé à la Banque européenne d’investissement, qui, aujourd’hui, ne peut financer que des équipements à double usage, militaire et civil, d’« adapter sa politique de prêts à l’industrie de la défense ». Les Vingt-Sept demandent donc à la Commission d’explorer « toutes les options » et de leur remettre un rapport sur le sujet en juin. L’exécutif communautaire a les mains libres pour étudier la possibilité d’un nouvel emprunt des Vingt-Sept. « Les États membres ont dépensé 100 milliards de plus pour leur défense », depuis le début de la guerre, rappelle la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La Première ministre estonienne, Kaja Kallas, a lancé l’idée d’un fonds pour la défense de 100 milliards d’euros, financé par une dette commune. L’initiative a fait des émules, notamment à Paris et à Varsovie. Dans une lettre commune envoyée au Vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, le 20 mars, le ministre français des affaires étrangères, Stéphane Séjourné, avec ses homologues letton, lituanien, estonien, portugais et roumain, argumentent : « Face à la pandémie de Covid-19, nous avons agi avec solidarité et mis en place des instruments sans précédent. Face à l’agression de la Russie, nous entrons également dans l’histoire. » L’Allemagne n’est pas à ce stade sur cette ligne. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 19 May 2024 - 57min - 601 - Bada : Alexandre Lacroix, philosophe (4/4)
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une conversation entre Alexandre Lacroix et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 9 février 2024. Dans ce quatrième et dernier épisode, le philosophe Alexandre Lacroix nous livre sa vision de la discipline et de la liberté, deux termes importants dans l’apprentissage et la pratique de la danse. Il est aussi question du processus de création chez les chorégraphes, notamment Mats Ek, et enfin de deux philosophes qui nous aident à comprendre ce curieux mouvement qu’est la danse, Paul Valéry et Henri Bergson. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 15 May 2024 - 20min - 600 - Bernard Pivot, le chagrin et l’amitié
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique en 2018. Bernard Pivot a soutenu notre peau de caste dès la première heure, il l’a écouté et commenté presque jusqu’à la fin. A l’annonce de sa mort, le phénomène qui s’est produit sur les réseaux sociaux mérite d’être appelé un chagrin national. Pour prendre notre part de ce chagrin, j’ai décidé de reporter d’une semaine notre conversation sur la capacité de la France à faire la guerre aujourd’hui. Je vous propose une heure de conversation avec Bernard Pivot, qui remonte à l’époque où en montant sur scène, il revêtait un nouvel avatar. Pour le générique de cette conversation, Bernard avait choisi « The man I love », de Gershwin, dans l’interprétation d’Alexandre Tharaud. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 12 May 2024 - 52min - 599 - Bada : Alexandre Lacroix, philosophe (3/4)
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une conversation entre Alexandre Lacroix et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 9 février 2024. Au cours de ce troisième épisode, Alexandre Lacroix évoque le fonctionnement unique de la vie et de la carrière de danseuse et danseur, particulièrement exigeants. Il est aussi question de la façon dont la danse a été codifiée en France, et de celle d’entrer dans le corps du ballet. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 08 May 2024 - 17min - 598 - Jordan Bardella : de quoi s’agit-il ? / Le rapport Letta sur l’Union Européenne
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 3 mai 2024. Avec cette semaine : - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. - Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. - Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Blick. BARDELLA : DE QUOI S’AGIT-IL ? Avec à sa tête Jordan Bardella, la liste du Rassemblement national aux européennes, caracole en tête des sondages. Elle atteint 32 % dans la dernière enquête Ipsos, fin avril, pour Le Monde et se situe 15 points devant celle de la majorité présidentielle. Les experts électoraux dressent le même constat : à partir d’un socle élevé, le Rassemblement national se renforce dans ses bastions populaires et s’élargit en direction des cadres et des retraités, tandis qu’il confirme son emprise sur les jeunes. Dans un sondage Ifop, publié en mars dans Le Figaro, Jordan Bardella récolte 27 % chez les 18-24 ans et 33 % chez les 25-34 ans. « Déjà, le vote RN est un vote jeune », explique Frédéric Dabi, directeur général de l'Ifop. Il apparaît en rupture avec les stéréotypes classiques des personnels politiques ». Le président du Rassemblement national pèse un million d'abonnés sur TikTok, troisième personnalité la plus suivie sur le réseau social après Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. À 28 ans, le dauphin de Marine Le Pen n’a pas fait d’études poussées, il a fréquenté à peine quelques semaines la faculté de géographie, mais compte déjà douze ans de terrain. De ses origines : sa naissance dans un quartier peu favorisé de Seine-Saint-Denis, le divorce de ses parents, le HLM dans lequel il est élevé par sa mère, agent territoriale, il fait une force : celle de ne pas être coupé du peuple. Il fait même un clin d’œil aux étrangers en évoquant fréquemment ses « racines italiennes ». En 2015, il est élu à 20 ans conseiller régional d’Île-de-France, plus jeune élu régional de France. En 2019, il prend la tête de la liste du RN pour les élections européennes, marquant ainsi son entrée sur la scène politique nationale. Malgré sa jeunesse et son manque d’expérience, il obtient plus de 23 % des voix, ce qui place le RN en tête du scrutin. En novembre 2022, face à Louis Aliot, il devient président du parti, avec plus de 85 % des voix, et après un demi-siècle de gouvernance des Le Pen. Son discours reprend les thèmes classiques du parti : sécurité, immigration, souveraineté nationale, et identité nationale. Au Parlement européen, la tête de liste du Rassemblement national déclare s'appuyer sur son assiduité lors des votes en sessions plénières. Mais ce n'est qu'une infime partie du travail parlementaire. Pour ce qui est du reste, notamment du travail en commission Jordan Bardella brille par ses absences. Pratiquant l’évitement vis-à-vis des médias, il a refusé par trois fois de débattre avec ses adversaires. Le 25 avril, il a quitté une conférence de presse qu’il avait convoquée pour faire pièce à celle d’Emmanuel Macron sans se prêter au jeu des questions-réponses avec les journalistes, au prétexte que le président de la République ne l’avait pas fait. Fort de ses bons sondages depuis l’automne, Jordan Bardella a théorisé la dimension nationale du scrutin européen dans le but d'en faire un marchepied vers l'élection présidentielle. LE RAPPORT ENRICO LETTA SUR L’UNION EUROPÉENNE L’ancien président du Conseil italien Enrico Letta a présenté aux Vingt-Sept, réunis à Bruxelles le 18 avril, son rapport sur le marché intérieur. Pendant huit mois, il a sillonné l’Union européenne, rencontré tous les chefs d’État et de gouvernement européen ainsi que des représentants des entreprises, de la société civile ou des intellectuels. Il préconise d'approfondir le marché unique, notamment dans les secteurs de la finance, des télécoms de l'énergie, et de la défense, secteurs que les États membres avaient souhaité exclure, lorsque Jacques Delors a créé le marché unique, il y a bientôt quarante ans, Or « le fossé se creuse entre l'UE et les Etats-Unis. La prochaine législature doit être celle du rattrapage de notre retard », avertit Enrico Letta qui se fait particulièrement sévère sur la finance, un des facteurs clefs du déclassement européen. Il juge urgent de développer un « marché financier européen plus intégré et plus robuste » et propose une « union de l'épargne et des investissements » afin de retenir en Europe les flux de capitaux qui partent aujourd'hui massivement vers les Etats-Unis. En Europe, l'épargne privée est abondante - estimée à 35.000 milliards d'euros - et largement inexploitée. Mais cette manne est aussi un tuyau percé : 295 milliards d'euros quittent chaque année l'Europe vers les marchés financiers américains, aux fonds d'investissement et de pension plus attractifs... qui rachètent ensuite des entreprises européennes. Comme le résume un haut responsable français, « nous finançons aujourd'hui triplement l'économie américaine : par l'épargne, par les achats de défense et par les importations de gaz ». Le marché des télécoms est également en proie à la fragmentation : plus de 100 opérateurs coexistent aujourd'hui sur le continent. Un opérateur télécoms européen compte en moyenne seulement 5 millions d'abonnés, contre 107 millions aux Etats-Unis et 467 millions en Chine. De même, le secteur de l'énergie souffre d'interconnexions insuffisantes au niveau européen. Il est donc nécessaire de renforcer l'intégration des marchés européens dans le domaine de l’énergie pour réduire les divergences de prix de l'électricité entre les États membres, divergences exacerbées depuis la crise provoquée par l'invasion de l'Ukraine et la fermeture des robinets du gaz russe. Dans le secteur de la défense, l'Europe paie là encore « le prix de la fragmentation » : « 80 % de ce que nous avons dépensé pour soutenir militairement l'Ukraine est allé vers des fournisseurs non européens », alerte Enrico Letta. Non seulement l'Europe est fragmentée, mais elle a, devant elle et de manière urgente, dans les domaines des technologies vertes, du numérique (intelligence artificielle), de la sécurité et de la défense un besoin d'investissements que Mario Draghi a évalué entre 500 et 600 milliards d'euros. Pour compléter le travail d’Enrico Letta, l’ancien président de la BCE remettra en juin un rapport sur la compétitivité de l'Union européenne. Les décisions sont reportées à l’après élections européennes et alimenteront un « programme stratégique pour les cinq prochaines années» qui devrait être adopté en juin. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 05 May 2024 - 57min - 597 - Bada : Alexandre Lacroix, philosophe (2/4)
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une conversation entre Alexandre Lacroix et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 9 février 2024. Épisode 2 : Dans ce deuxième épisode, Philippe Meyer et notre invité traitent du livre publié par Alexandre Lacroix autour de la danseuse étoile Ludmila Pagliero intitulé La Danse. Philosophie du corps en mouvement. L’auteur a suivi le quotidien des danseurs de l’Opéra de Paris et en particulier celui de Ludmila Pagliero pendant plusieurs mois pour en tracer un portrait rare. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 01 May 2024 - 15min - 596 - La relation des Français à l’Union européenne / Le déblocage des milliards américains pour l’Ukraine
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 25 avril 2024. Avec cette semaine : - Nicolas Baverez, essayiste et avocat. - François Bujon de l’Estang, ambassadeur de France. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Blick. LA RELATION DES FRANÇAIS À L’UNION EUROPÉENNE Les sondages effectués par la Commission ou le Parlement européen auprès des citoyens européens montrent un intérêt réel des Français pour l’Europe conforté par une participation en nette hausse des Français aux dernières élections européennes de 2019 (50,12%), contre 40,6% en 2009 et 42,4% en 2014. D’après l’Eurobaromètre de la Commission européenne réalisé en février-mars 2021, 57% des Français se déclarent attachés à l’Union européenne, soit une hausse de 4 points par rapport à l’été 2020. De plus, selon l’Eurobaromètre du Parlement européen du printemps 2021 la grande majorité des Français estiment que la voix de la France compte dans l’UE (75%). L’étude de la Fondation Jean Jaurès et du Cevipof en partenariat avec Ipsos et Le Monde, baptisée « Fractures françaises », publiée en octobre 2022, montre néanmoins, que le niveau de confiance en l’institution européenne varie en fonction de l’affiliation politique de la personne interrogée et de sa catégorie socioprofessionnelle. Sans surprise, les sympathisants des partis ayant un discours et un programme pro-européens sont les plus enclins à se dire confiants en l’UE : ceux du Parti socialiste (68%), d’Europe Ecologie-Les Verts (73%) et de La République en marche (devenu Renaissance, 87%) figurent en tête. De surcroît, l’étude met en exergue une différence de perception en fonction de la catégorie socioprofessionnelle d’appartenance. Les ouvriers se disent beaucoup moins confiants en l’UE (36%) que les cadres (63%), et les professions intermédiaires, les employés et les retraités se situent à un niveau comparable à celui de la population générale. En mars 2023, 71% des Français se sont déclarés en faveur de l'euro (71% dans l'ensemble de l'Union), 69% en faveur d'une politique de défense et de sécurité commune (77% dans l'ensemble de l'Union), 64% déclarent être satisfaits de la réponse apportée par l'Union européenne en soutien à l'Ukraine (69% dans l'ensemble de l'Union) et 64% pensent que les actions de l'Union européenne ont un impact sur leur vie quotidienne (71% dans l'ensemble de l'Union). En revanche, 54% des Français ne sont pas satisfaits de la manière dont l'Union a géré les enjeux de migration et d'asile (50% dans l'ensemble de l'Union), 50% ne sont pas satisfaits du « Green Deal » de l'Union européenne (43% dans l'ensemble de l'Union). Pour l'instant, l'intérêt déclaré des citoyens pour les élections européennes est faible en France : 40% sont intéressés contre 56% dans l'ensemble de l'Union. Un niveau équivalent à celui de la Bulgarie (41%) très éloigné de celui de l’Allemagne (65%). Selon la dernière enquête Eurobaromètre publiée le 17 avril, 52% des Français interrogés se disent pessimistes sur l’avenir de cette Union que leur pays a œuvré à forger. Jeudi, à un mois et demi des élections européennes, Emmanuel Macron a prononcé à Paris un nouveau discours sur l'Europe. LE DÉBLOCAGE DES MILLIARDS AMÉRICAINS POUR L’UKRAINE Après de longues et difficiles tractations, le 20 avril, la Chambre américaine des représentants dans un vote bipartisan a adopté par 310 voix pour - dont 101 républicaines - contre 112, un grand plan d'aide à l' Ukraine, Israël et Taïwan. L’enveloppe de 95 milliards de dollars, dont 61 milliards pour l’Ukraine, était réclamée depuis des mois par le président Joe Biden. Quelques minutes après le vote, le président ukrainien a estimé que l'aide américaine « sauvera des milliers et des milliers de vies ». Le président Joe Biden a salué l'« aide cruciale » à Israël et l'Ukraine, comme étant au « rendez-vous de l'Histoire ». Le Kremlin a dénoncé l'aide américaine qui « tuera encore plus d'Ukrainiens à cause du régime de Kyiv ». Le Congrès américain n'avait pas adopté de grande enveloppe pour son allié depuis décembre 2022, principalement en raison de querelles partisanes. Le plan d’aide à l’Ukraine inclut 14 milliards de dollars pour les systèmes de défense américains, 13 milliards de dollars pour reconstituer aux États-Unis les stocks d’armes déjà données à l’Ukraine, 7 milliards de dollars pour les opérations militaires américaines dans la région et 9,5 milliards de dollars d’aide économique. Il autorise le président Biden à confisquer et à vendre des actifs russes, pour qu'ils servent à financer la reconstruction de l'Ukraine - une idée qui fait également son chemin auprès d'autres pays du G7. Après des mois de tergiversations, le chef républicain de la Chambre, Mike Johnson, a fini par apporter son soutien, sous les huées d'élus trumpistes, hostiles à une telle aide. « Pour le dire franchement : je préfère envoyer des munitions à l'Ukraine qu'envoyer nos garçons se battre », a-t-il plaidé. Deux jours avant le vote, le directeur de la CIA, Bill Burns avait déclaré « sans aide supplémentaire, le risque est réel que les Ukrainiens perdent sur le champ de bataille d’ici à la fin de 2024 ». Depuis le début de l'année et le tarissement des crédits américains, l'armée ukrainienne s'est retrouvée de plus en plus en difficulté. Les forces russes grignotaient mois après mois du terrain. L'Europe ne parvenait pas à compenser les obus et les missiles manquant à l'Ukraine. Le 7 avril, le président Zelensky a, pour la première fois, affirmé que son pays « perdra[it] la guerre » si l’aide promise par les Etats-Unis restait bloquée au Congrès, expliquant que ses troupes pouvaient tirer un obus quand les Russes en envoyaient dix. Même tardif, le vote américain a été salué en Europe. La ministre des affaires étrangères allemande Annalena Baerbock a évoqué « un jour d’optimisme », son homologue italien parle d’un « tournant décisif ». Le président du Conseil européen, Charles Michel, s’est quant à lui réjoui de ce « message clair envoyé au Kremlin ». « Mieux vaut tard que trop tard », a commenté le premier ministre polonais Donald Tusk. Le retard de Washington pour débloquer cette aide a permis à la Russie de reprendre l’initiative sur le terrain. Mardi, le projet de loi a été adopté par le Sénat américain par 79 voix pour et 18 contre. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 28 Apr 2024 - 59min - 595 - Bada : Alexandre Lacroix, philosophe (1/4)
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une conversation entre Alexandre Lacroix et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 9 février 2024. Épisode 1 : Philippe Meyer reçoit le philosophe Alexandre Lacroix. Dans ce premier épisode, notre invité évoque le fonctionnement de Philosophie Magazine et son histoire dont il est directeur de la rédaction depuis sa création en 2006. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 24 Apr 2024 - 12min - 594 - J.O. : aubaine ou problème ? / Poutine, vainqueur du chaos Israël-Iran ?
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 19 avril 2024. Avec cette semaine : - Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. - Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Blick. JO, AUBAINE OU PROBLÈME ? Entre le 26 juillet et le 11 août, 10 millions de spectateurs sont attendus dans l'Hexagone pour assister aux jeux Olympiques, dont une grande partie en Île-de-France, puis du 28 août au 28 septembre pour les jeux paralympiques. Autant de voyageurs prêts à payer le prix fort pour se loger à Paris, représentant une aubaine pour les bailleurs. Ils « peuvent avoir l'équivalent d'une année de revenus locatifs traditionnels en deux mois de location Airbnb », pointe le président de la Confédération nationale du logement. L’un des défis de ces jeux consiste à desservir 40 sites olympiques, avec une affluence pouvant monter jusqu'à 6.000 spectateurs à la minute comme au Stade de France. Des alarmistes aux rassuristes, tous le concèdent : circuler en région parisienne pendant la compétition demandera de l'organisation. La région va déployer les grands moyens, avec une offre de transports en commun en augmentation de 15 % en moyenne par rapport à un été traditionnel, « et jusqu'à 70 % sur les lignes les plus sollicitées », précise Ile-de-France Mobilités. Actuellement, la facture provisoire des Jeux est de 8,8 milliards d'euros : 4,4 milliards d'euro pour le comité d'organisation et 4,4 milliards d'euros pour les infrastructures (dont 1,7 milliard d'euros publics). Toutefois la facture publique est impossible à établir, car tous les coûts ne sont pas connus. Se sont ajoutées récemment notamment les primes de 1.900 euros données aux policiers, qui pourraient représenter 500 millions d'euros. S'il existe un indéniable coup de fouet des jeux sur l'activité, les économistes préviennent que l'impact JO sera limité comparé à la taille de l'économie française. Le cabinet d’études Asterès l'estime à « environ 0,4 % du PIB français ». Les Jeux devraient mobiliser au total 180.000 emplois, selon la dernière estimation du Centre de droit et d'économie du sport. Il s’agira avant tout de contrats de courte durée. Autre défi : la sécurité. Selon le politologue Gilles Kepel « les JO peuvent apparaître comme une cible de choix pour les terroristes ». Notamment la cérémonie d’ouverture sur la Seine. Le Président de la République a donc annoncé envisager des lieux alternatifs comme le Trocadéro voire le Stade de France. Il a assuré en outre qu’il n’avait « aucun doute » sur le fait que la Russie puisse cibler les Jeux, « y compris en termes informationnels ». Le ministre de la Défense a fait savoir que 18.000 militaires seront mobilisables pour les JO, dont 3.000 aviateurs chargés de la surveillance aérienne. Pour l’heure, les réservations en provenance de l’étranger sont en deçà des prévisions. Selon un sondage réalisé par Harris pour Atout France auprès de 1.000 personnes, « 69% des Franciliens prévoient de rester en Ile-de-France » pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Parmi eux, « 33% affirment vouloir profiter de l'évènement. POUTINE, VAINQUEUR DU CHAOS ISRAËL-IRAN ? Depuis le 7 octobre, Moscou a reçu à deux reprises des dirigeants du Hamas avec leurs parrains iraniens. Dans l'immédiat, Moscou continue d'apporter son soutien à « l'axe de la résistance », l'alliance politico-militaire entre l'Iran, la Syrie et les milices armées pro-Iran. Celle-ci remplit deux objectifs : fragiliser la présence américaine au Moyen-Orient et ouvrir un autre front pour détourner les moyens et l'attention de Washington de la guerre en Ukraine. Elle permet aussi d’affaiblir la domination occidentale sur les affaires du monde. Moscou qui n’a pas condamné l’attaque iranienne sur le territoire israélien, voit dans cette crise l’occasion d’enfoncer un coin entre l’Occident et le reste du monde. Après le lancement de drones et de missiles iraniens sur Israël dans la nuit du 13 au 14 avril, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations unies a évoqué une « réponse légitime » de la part de l’Iran et préféré insister sur « l’hypocrisie » occidentale dans le dossier. L’Iran est un allié vital de Moscou dans sa guerre contre l’Ukraine et fournit à la Russie drones et missiles. A la mi-mars, la Russie et l’Iran, avec la Chine, conduisaient des manœuvres militaires conjointes en mer d’Oman. C’est aussi au nom du face-à-face avec l’Occident que Moscou a sacrifié ses bonnes relations avec Israël et une politique régionale marquée jusque-là par un souci d’équilibre. Le politologue Gilles Kepel observe que les relations entre l'Iran et la Russie ont évolué. Autrefois, les Iraniens étaient les alliés obséquieux des Russes. Mais leur position a été renforcée, parce qu'ils ont fourni à Poutine, à un moment crucial, des missiles Shahed qui ont fait des ravages en Ukraine, cassant le moral de la population. « Stratégiquement, Moscou a tout intérêt à l'ouverture de "fronts secondaires", estime Jean-Sylvestre Mongrenier, de l'Institut Thomas More. Ceux-ci conduisent les Etats-Unis et leurs principaux alliés à disperser leur attention et leur énergie politique, mais aussi à réallouer leurs efforts diplomatiques et leurs moyens militaires. » « Grâce à la crise, la Russie a une nouvelle occasion de répandre son narratif anti-occidental, explique, Anna Borshchevskaya, experte au Washington Institute. Pour l'instant, elle est gagnante », juge-telle. La guerre en Ukraine constitue une priorité absolue pour la Russie et les tensions au Proche-Orient sont analysées à l’aune de ce prisme. Des analystes russes cités dans la presse ajoutent la possibilité qu’une escalade provoque une hausse des prix de l’énergie, bénéfique à l’économie russe. Mais avec l'escalade du conflit avec l'Iran, les Américains pourraient juger nécessaire d'allouer en urgence des aides financières à Israël, ce qui impliquerait de verser aussi le paquet d'aide à l'Ukraine. En jeu : 60 milliards de dollars pour Kyiv, une somme qui pourrait permettre aux Ukrainiens de tenir leurs lignes de défense. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 21 Apr 2024 - 1h 01min - 593 - Bada : Jean-Philippe Lafont, chanteur lyrique (4/4)
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une conversation entre Jean-Philippe Lafont et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 23 février 2024. Dans ce dernier épisode de notre série de Badas consacrée au baryton-basse Jean-Philippe Lafont, le chanteur nous introduit non pas à son métier de professeur dans une école mais à celui de professeurs un brin particulier… Il compte parmi ses élèves des personnalités venues de divers horizons, et parmi elles, le président de la République, Emmanuel Macron. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 17 Apr 2024 - 17min - 592 - Revoir les dépenses publiques / Israël-Iran, la prochaine guerre ?
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 12 avril 2024. Avec cette semaine : - François Bujon de l’Estang, ambassadeur de France. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. - Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Blick. REVOIR LES DÉPENSES PUBLIQUES Le 10 avril, le gouvernement a fait évoluer sa prévision du déficit de 4,4% du PIB à à 5,1 % espérés. Selon les prévisions de Bercy, ce déficit doit revenir à 2,9 % en 2027. Il avait déjà sévèrement dérapé à 5,5% au lieu des 4,9% prévus en 2023, en raison principalement de recettes moindres que celles attendues. Au quatrième trimestre 2023, la dette de la France atteignait 3.200 milliards d’euros. Depuis 2017, elle s’est alourdie de près de 1.000 milliards d’euros. Face au mur de la dette, le gouvernement cherche à faire des économies. Après l’annonce de 10 milliards d'euros d’économies en 2024, le ministère des Finances a fixé un objectif de 20 milliards supplémentaires à trouver en 2025 sur l’ensemble des trois postes (Etat, Sécurité sociale, collectivités locales). La Cour des comptes évoque, elle, 50 milliards d'ici à 2027. Ce chantier des économies à réaliser en 2025 est déjà ouvert. Des audits de la dépense ont été pour partie rendus au gouvernement, qui décidera des suites à leur donner d’ici à l’été. Quelques pistes sont déjà dans le débat public, comme notamment la réforme de l’assurance-chômage, les crédits d’impôts, les dispositifs de sortie de crise, les politiques de l’emploi et de la formation professionnelle, la revalorisation automatique des prestations sociales indexées sur les prix, à commencer par les retraites… La piste des affections de longue durée a été écartée. L’économiste Jean Pisani-Ferry estime que, si le péril financier n’a rien d’immédiat, il doit conduire à un réexamen collectif du budget et de son financement, sans exclure ni emprunt, ni impôt, ni réductions. Selon lui, en valeur 2025, ce sont 150 milliards qu’il faut trouver dans les années à venir afin d’assainir les finances publiques et financer les priorités nouvelles. Priorités précisées par l’économiste Olivier Blanchard qui distingue trois composantes dans le déficit : celle liée aux dépenses traditionnelles (allocations-chômage, retraites, paiements des fonctionnaires…), celle liée à la défense contre la Russie et à la lutte contre le réchauffement climatique et, enfin, celles liées au soutien de l’activité en cas de ralentissement. Pour lui, le plan doit clairement être de diminuer les premières, d’augmenter les dépenses liées à la défense et au climat, qui sont vitales à court et long terme, et de soutenir l’économie si nécessaire. Le président de la République, jugeant le débat anxiogène souhaite que l'accent soit mis sur les recettes supplémentaires à engranger plutôt que sur les coupes. Il a rejeté l'idée de présenter des mesures d'économies dans le cadre d'un projet de loi de finances rectificatif qui aurait nécessité un examen parlementaire. Des mesures seront présentées en conseil des ministres le 17 avril, et débattues au Parlement les 29 et 30 avril. Le verdict des agences de notation, qui doivent actualiser la note de crédit française, tombera dans quelques semaines. L’agence Moody’s a d’ores et déjà estimé « improbable » que le gouvernement atteigne son objectif de déficit de 4,4 % du PIB en 2024 et de moins de 3 % en 2027. ISRAËL-IRAN, LA PROCHAINE GUERRE ? Le 1er avril, des frappes attribuées à l’aviation israélienne ont entièrement rasé le consulat iranien à Damas, la capitale syrienne. Elles ont tué 13 personnes, dont plusieurs Gardiens de la révolution et deux commandants de la force Al-Qodsn. Parli eux, le plus haut gradé des gardiens de la révolution Mohammad Reza Zahedi, un général expérimenté de 65 ans en charge des opérations en Syrie et au Liban voisin. Une frappe prenant pour cible une enceinte diplomatique, ou même un bâtiment semi-officiel contigu, représente une escalade qui pourrait avoir des conséquences importantes. Ce faisant, « Israël a franchi une ligne », estime Ali Vaez, analyste de l'International Crisis Group. Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a affirmé que ces frappes « ne resteraient pas sans réponse ». L’Iran se trouve désormais face à un dilemme. Une riposte pourrait provoquer un conflit ouvert avec Israël et un embrasement régional. Un scénario que Téhéran cherche à éviter depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, le 7 octobre 2023, laissant ses alliés au sein de « l’axe de la résistance » – le Hezbollah libanais, les milices irakiennes et les houthistes yéménites – attaquer seuls l’Etat hébreu en soutien du Hamas. Mais ne pas répondre pourrait ternir la réputation du régime au sein de cet axe et réduire à néant son pouvoir de dissuasion face à Israël. Depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes dans ce pays contre des positions du pouvoir syrien, des groupes pro-iraniens – comme le Hezbollah libanais – et des cibles militaires iraniennes, tout en prenant soin de ne pas tuer des ressortissants de la République islamique, afin d’éviter une confrontation plus large. Les États-Unis ont tenu à faire savoir à Téhéran qu’ils « n’étaient pas impliqués » dans le raid de Damas. La Russie et la Chine ont toutes deux dénoncé vigoureusement cette frappe, qualifiée d’ « inacceptable » par Moscou, qui soutient le régime de Bachar el-Assad à Damas. De son côté, l’Union européenne s’est contentée d’appeler à « la retenue ». Afin de ne pas être surprise par des représailles, l'armée israélienne a annoncé avoir renforcé les unités de défense aérienne, mobilisé des renforts de réservistes, suspendu des permissions dans toutes les unités combattantes, et brouillé des signaux GPS afin de perturber d'éventuels vols de missiles iraniens, ou du Hezbollah. L'Iran dispose de missiles d'une portée de 2.000 km susceptibles d’atteindre des cibles stratégiques comme le ministère de la Défense à Tel-Aviv, le quartier des ministères à Jérusalem, mais aussi des raffineries, des centrales électriques, des hôpitaux … Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 14 Apr 2024 - 1h 00min - 591 - Bada : Les questions du public (le modèle scolaire dans tous ses états)
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnementUne émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à l’École alsacienne le 7 avril 2024.Avec cette semaine : - Nicolas Baverez, essayiste et avocat. - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - Pierre de Panafieu, directeur de l’École alsacienne. - Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. - Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Blick. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 10 Apr 2024 - 41min - 590 - Le modèle scolaire dans tous ses états / La Turquie après les élections perdues par Erdogan
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à l’École alsacienne le 7 avril 2024. Avec cette semaine : - Nicolas Baverez, essayiste et avocat. - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. - Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Blick. LE MODÈLE SCOLAIRE DANS TOUS SES ÉTATS En décembre 2023, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, défendait son « choc des savoirs » comme réponse aux mauvais résultats du classement Pisa, qui évalue les élèves des pays de l'OCDE. Outre le renforcement du redoublement ou le brevet comme examen d'entrée au lycée, voire le port de l'uniforme, il avait promis des groupes à effectifs réduits en français et en mathématiques pour les élèves de sixième et de cinquième et la répartition des élèves en trois sections en fonction de leur niveau, et ce, durant toute l'année scolaire. L'actuelle ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet préfère l’appellation de « groupes de besoins » et insiste davantage sur les « compétences » à acquérir que sur le « niveau » des élèves. Le ministère assure que 2.330 postes seront débloqués, dont 830 créations, pour la mise en place de cette réforme. Classes toujours plus surchargées, école inclusive sans moyens, manque de formation et de soutien, rémunérations à la traîne : l'enquête dénommé « J'alerte », menée depuis décembre 2023 auprès des professeurs du premier degré par le syndicat FSU-SNUipp montre une institution « au bord de l'effondrement ». Plus de 4.200 personnes ont répondu. « L'inclusion sans moyens » est dénoncée par près des trois quarts (71 %) des répondants. Les rémunérations et le temps de travail qui déborde préoccupent un sur deux, tandis que 46 % pointent la surcharge constante des classes. Les autres enseignements de l'enquête portent notamment sur la formation, jugée insuffisante et « subie plutôt que choisie ». Le 2 avril, après six mois de travail, Paul Vannier, député La France insoumise, et Christopher Weissberg, député Renaissance, ont présenté leur rapport d’information sur le financement de l’enseignement privé sous contrat devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale. Leurs conclusions dressent un constat sévère concernant un système peu transparent, mal contrôlé, et dans lequel les « contreparties exigées des établissements privés sont loin d’être à la hauteur des financements qu’ils perçoivent au titre de leur association au service public de l’éducation ». Quarante ans après l’abandon du projet de création d’un grand service public et laïque d’enseignement par le ministre de l’éducation Alain Savary, en 1984, les deux rapporteurs estiment que le cycle de l’évitement du débat par crainte de raviver une « guerre scolaire » touche à sa fin. Les députés déplorent l’opacité des fonds publics alloués chaque année par l’État et les collectivités territoriales aux 7.500 établissements privés sous contrat, à 96 % catholiques. Aucune administration n’a été en mesure de fournir un montant consolidé de cette dépense de plus de 10 milliards d’euros et, selon les corapporteurs, « sous-estimée ». Le rapport remet en cause le modèle français tel qu’il s’est construit depuis la loi Debré de 1959, caractérisé par un financement public important (75 % des ressources du privé sous contrat) associé à de faibles contreparties. LA TURQUIE APRÈS LES ÉLECTIONS PERDUES PAR ERDOGAN En Turquie, moins d’un an après sa défaite à la présidentielle de 2023, le parti kémaliste d’opposition, le Parti républicain du peuple (CHP) a remporté les plus grandes villes du pays lors des municipales du 31 mars. A Istanbul, le maire Ekrem Imamoglu, a été réélu avec 51,14 % des voix. A 52 ans, il fait désormais figure de solide présidentiable en 2028, mais demeure dans le viseur du pouvoir qui l'a fait condamner fin 2022 à deux ans et sept mois de prison pour « insulte » aux membres du Haut comité électoral turc. L'édile a fait appel mais cette peine continue de planer sur son avenir politique. Elle l'avait écarté de la course à la présidence en mai 2023. Ces élections municipales constituent le plus gros revers subi par Recep Tayyip Erdogan 74 ans et son parti l’AKPi (i pour islamiste) depuis son arrivée au pouvoir en 2002. À l’échelle nationale, l’AKPi est tombée à 35,2 % des voix contre 37,7 % pour le CHP, perdant ainsi son statut de premier parti du pays. Autre percée notable : celle d’un autre parti islamiste Yeniden Refah, qui présentait pour la première fois des candidats. Avec près de 9 % des voix et une soixantaine de municipalités, la nouvelle mouvance a attiré les déçus de l’AKP, qui lui reprochent de s’être écarté de l’islam et de maintenir des liens économiques avec Israël. De son côté, le parti pro-kurde DEM se maintient à Diyarbakir et dans le Sud-Est à majorité kurde. Si la personnalisation à outrance du pouvoir et sa posture sur la scène internationale ont fonctionné en faveur d’Erdogan lors de la présidentielle de 2023, elle a montré ses limites aux municipales où les enjeux locaux - services, transports, parcs - priment. La très mauvaise situation économique du pays et l’inflation, qui a atteint 80 % fin 2022 et se maintenait encore à 67 % en février expliquent en bonne partie le verdict des électeurs. L’état des finances publiques et la corruption locale ne permettant plus à l’AKP de distribuer autant ses largesses à ses électeurs, formés par les classes moyennes conservatrices, qui se sont largement détournées de ce scrutin. A cela est venue s’ajouter l’inévitable usure d’un pouvoir omniprésent depuis 22 ans. Ces facteurs ont sans doute incité les électeurs mécontents de l’AKP à rester chez eux, comme le laisse deviner la baisse de la participation : passé de 87% l'an dernier à 76% cette année. Au soir des résultats, Recep Tayyip Erdogan a concédé qu’ils constituaient un « tournant » pour son camp et promis de « respecter la décision de la Nation ». Bien qu’affecté par ces élections, il garde la main sur les principaux leviers du pays en vertu d’une Constitution taillée sur mesure et d’un pouvoir qui s’est renforcé depuis le putsch raté, sur fond de purges et de contrôle renforcé des médias. Alors que les Turcs sont allés presque chaque année aux urnes ces derniers temps, aucune élection n’est prévue désormais avant les présidentielles de 2028. Erdogan devrait d’ici là donner la priorité à l’amélioration de la situation économique. Son idée de réforme constitutionnelle, qui aurait pu lui ouvrir la voie à un troisième mandat, semble pour l’heure reportée. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 07 Apr 2024 - 1h 11min - 589 - Bada : Jean-Philippe Lafont, chanteur lyrique (3/4)
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une conversation entre Jean-Philippe Lafont et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 23 février 2024. Troisième épisode de notre série de Badas consacrée au chanteur lyrique Jean-Philippe Lafont : après avoir évoqué ses rôles et ses débuts, le baryton-basse évoque son métier d’enseignant. Celui qui est entré sur scène sans formation est désormais professeur à l’École Normale de Musique de Paris et nous raconte … Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 03 Apr 2024 - 22min - 588 - Thématique : Ego-Histoire, avec Michel Winock
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le Avec cette semaine : - Michel Winock, historien et écrivain. - Nicolas Baverez, essayiste et avocat. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. MICHEL WINOCK, EGO-HISTOIRE Michel Winock, vous êtes historien. Spécialiste de l’histoire de la République française ainsi que des mouvements intellectuels et politiques, vous avez publié, entre autres, Siècle des intellectuels en 1997 pour lequel vous avez obtenu le Prix Médicis ou encore, en 2010, Madame de Staël, récompensé par le par le Prix Goncourt de la biographie. Vous avez été membre de la revue « Esprit », directeur littéraire au Seuil et vous avez fondé, avec Michel Chodkievicz, la revue « L’Histoire ». Nous vous devons bon nombre d’ouvrages biographiques, de Flaubert à De Gaulle. Vous publiez aujourd’hui aux éditions Bouquins Ego-histoire. Qui s’inscrit dans la lignée du genre théorisé par Pierre Nora en 1987 dans ses Essais d’ego-histoire qu’il présente comme un « exercice (qui ) consiste à éclairer sa propre histoire comme on ferait l'histoire d'un autre. (À)expliciter, en historien, le lien entre l'histoire qu'on a faite et l'histoire qui vous a fait. » Cinq livres sont ici rassemblés. Tout d’abord, Jeanne et les siens et Jours anciens, deux livres sur votre enfance. La république se meurt évoque la période de votre adolescence progressivement habitée par l’engagement politique et intellectuel.Chronique des années soixante rassemble les 40 articles que vous aviez écrits pour Le Monde sur ce sujet durant l’été 1986. Enfin, Parlez-moi de la France est, dites-vous, « un ouvrage né d’une question qui me fut posée au début des années 1990 par mes étudiants russes à Moscou et à Saint-Pétersbourg : « Pouvez-vous nous résumer la France ? »Loin de reprendre la formule de Lavisse répondant à l’Impératrice Eugénie qui lui posait la même question « Madame, ça ne s’est jamais très bien passé », vous vous appliquez à décrire ce qu’est et ce que n’est pas notre pays. Pour l’historien Henri Marrou « l’histoire est inséparable de l’historien ». Votre livre en est l’illustration : on ne pourrait séparer le fait du témoin. Ces récits sont d’autant plus précieux que votre plume est autant celle d’un écrivain que celle d’un historien. Dans les deux livres qui ouvrent Ego-histoire, Jeanne et les siens et Jours anciens., nous sommes replongés dans une époque qui parait aujourd’hui plus que lointaine : celle à laquelle, lors de sa communion solennelle, l’école accordait un congé pour faire sa retraite. L’usage voulait que l’on offre des images à ses professeurs ; tout cela dans l’école laïque. Puisqu’un des rôles majeurs de la connaissance historique est d’éclairer le présent et éventuellement le futur, quelles leçons en tirez-vous ? Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 31 Mar 2024 - 1h 05min - 587 - Bada : Jean-Philippe Lafont, chanteur lyrique (2/4)
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une conversation entre Jean-Philippe Lafont et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 23 février 2024. Dans ce deuxième épisode du Bada consacré au baryton-basse Jean-Philippe Lafont, Philippe Meyer et lui évoquent les choix du chanteur quant aux différents rôles qu’on lui a proposé au cours de sa carrière. Celui que Philippe Meyer n’hésite pas à qualifier — dans un sens largement positif — de « flâneur professionnel » a en effet baguenaudé de répertoire en répertoire. Mais d’où vient cette agilité, et que pense l’intéressé de ce parcours si riche ? Aussi, Lafont narre sa rencontre avec l'artiste qui a fait de lui le chanteur qu’il est devenu... Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 27 Mar 2024 - 23min - 586 - La fin de vie / Le triangle de Weimar peut-il relayer le couple franco-allemand ?
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 22 mars 2024. Avec cette semaine : - Nicolas Baverez, essayiste et avocat. - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - Matthias Fekl, avocat et ancien ministre de l’Intérieur. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. LA FIN DE VIE Après que la convention citoyenne organisée par le Conseil économique, social et environnemental avait remis ses conclusions le 3 avril 2023, le chef de l’État avait promis de bâtir un « modèle français » de la fin de vie, en annonçant un projet de loi plusieurs fois reporté. Dans un entretien à « Libération » et à « la Croix », publié le 10 mars, le Président a annoncé pour avril un texte qui défend une démarche de « fraternité » et de « rassemblement ». Le projet prévoit la possibilité de demander une « aide à mourir » dans des conditions encadrées : cet accompagnement sera réservé aux personnes majeures, comme la Convention citoyenne l'avait recommandé. Les personnes devront être capables d'un discernement plein et entier, excluant les patients atteints de maladies psychiatriques ou de maladies neurodégénératives qui altèrent le discernement, comme Alzheimer. Elles devront présenter une maladie incurable et un pronostic vital engagé à court ou à moyen terme. Le dernier critère est celui de souffrances - physiques ou psychologiques réfractaires, c'est-à-dire que l'on ne peut pas soulager. Le projet de loi indique que l’accord donné à l’« aide à mourir »relève d’un seul professionnel, celui auquel le malade adresse sa demande, qui peut être son médecin traitant, un spécialiste à l’hôpital, un praticien en ville ou en Ehpad. Ce médecin sollicite obligatoirement l’« avis » d’un autre « médecin, qui ne connaît pas la personne, spécialiste de la pathologie » et d’un « professionnel paramédical qui intervient auprès d’elle ». Il peut aussi se tourner vers un infirmier, aide-soignant, ou encore un psychologue, qui a l’habitude d’être au chevet du patient. In fine, c’est le médecin qui mène la procédure qui tranche. Il a quinze jours maximum après la demande pour se prononcer. En cas de refus du praticien d’autoriser l’« aide à mourir », le patient peut saisir le tribunal administratif. En cas de réponse favorable, la prescription est valable trois mois, période durant laquelle le patient pourra se rétracter à tout moment. Le projet de loi vise également à améliorer la qualité de vie des grands malades. Il s’agit, selon l’exposé de motifs, de forger « pour les dix années à venir, un modèle rénové et renforcé de prise en charge de la douleur chronique ou aiguë et de l’accompagnement de la fin de vie ». Le texte de loi devrait être transmis au conseil des ministres le 10 avril. Il sera dans la foulée soumis à une « commission spéciale » qui se réunira à l’Assemblée nationale. La première lecture en séance publique est prévue le 27 mai. Selon un sondage Ifop de juin 2023, 90% des Français estiment que la loi française devrait autoriser l'euthanasie. 85% approuvent l'autorisation du suicide assisté. Les représentants religieux, eux, font régulièrement savoir leur ferme opposition. « Rupture anthropologique » d'un côté, « avancée sociétale » de l'autre, le clivage ne s'éteindra pas aux portes de l'Assemblée nationale. LE TRIANGLE DE WEIMAR PEUT-IL RELAYER LE COUPLE FRANCO-ALLEMAND ? Régulièrement à la peine avant 2022 (malgré la signature en 2019 du Traité d’Aix-la-Chapelle, dont la mise en œuvre fut perturbée par la pandémie de Covid), le « moteur » franco-allemand semble aujourd’hui grippé. Le chancelier Scholz ne voit pas de salut de l’Europe hors de son ancrage avec les Etats-Unis, tandis que le président Macron prône la souveraineté européenne. Les deux dirigeants étaient du même côté, celui des sceptiques et de l'apaisement avec la Russie, au début de la guerre. Mais, depuis l'été 2023, la position d'Emmanuel Macron a radicalement changé pour se rapprocher de celle des pays de l'est de l'Europe et du Royaume-Uni. Les désaccords et l'inimitié entre les deux hommes ont augmenté après l’annonce du chef de l’État français de la possibilité d’envoyer des troupes en Ukraine. Afin de débloquer la situation, le chancelier allemand a réactivé à Berlin le 15 mars le Triangle de Weimar, cette entente cordiale entre la Pologne, l'Allemagne et la France créée en 1991 pour soutenir le pays, alors dirigé par Lech Walesa, dans son adhésion à l'Otan. Un canal qui a connu de nombreuses pauses, surtout ces huit dernières années, lorsque le parti souverainiste ultra-conservateur Droit et justice (PiS) se trouvait au pouvoir avec une position très atlantiste et en privilégiant une relation bilatérale avec les Etats-Unis. Depuis décembre 2023 et l'arrivée aux affaires de Donald Tusk, les Européens attendent beaucoup du nouveau gouvernement polonais en termes de réengagement. A l’issue de ce sommet, le chancelier Olaf Scholz, le président Emmanuel Macron, et le Premier ministre Donald Tusk ont promis de livrer davantage d'armes à Kyiv, notamment de l'artillerie de longue portée. Cette coalition « sur les frappes en profondeur » avait déjà été présentée le 26 février à l'Élysée lors de la conférence de soutien à l'Ukraine, mais cette fois, l'Allemagne l'endosse ouvertement. L’augmentation des livraisons d'équipements militaires sera effectuée via des achats sur le marché mondial ainsi que par la production d'armes sur le territoire de l'Ukraine, en coopération avec des partenaires. Le chancelier allemand a aussi indiqué que les pays européens allaient se servir des recettes générées par les actifs russes gelés pour financer des achats d'armes. Selon les estimations, l'Europe aurait gelé près de 300 milliards d'euros d'actifs de la banque centrale russe et plusieurs dizaines de milliards d'euros de biens divers appartenant à des personnes sanctionnées. Olaf Scholz s'est également félicité de la nouvelle aide militaire de 5 milliards d'euros annoncée la semaine dernière par l'Europe, à l'issue de plusieurs mois de négociations. Donald Tusk a souligné qu'il était important que Paris, Berlin et Varsovie parlent d'une même voix et a annoncé la tenue d'une réunion du Triangle de Weimar cet été. De retour de Washington, le Premier ministre polonais a rappelé que l’Europe devrait surtout penser à renforcer sa Défense dans la perspective d’une victoire électorale de Trump en novembre. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 24 Mar 2024 - 58min - 585 - Bada : Jean-Philippe Lafont, chanteur lyrique (1/4)
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une conversation entre Jean-Philippe Lafont et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 23 février 2024. Pour ce nouveau Bada, Philippe Meyer reçoit le baryton-basse Jean-Philippe Lafont. Dans ce premier épisode, ils évoquent les débuts du chanteur : celui-ci évoque son enfance sans avoir de parents particulièrement enclins à la chanson : ainsi Lafont a du se tracer un itinéraire singulier. Chanteur lyrique mais pas que : celui que l’on connaît grâce à ses nombreux rôles salués par la critique et son accent toulousain est féru de sport, particulièrement de gymnastique, premier sport qu’il a pratiqué. L’invité de Philippe Meyer aborde aussi ceux qui ont constitué pour lui un exemple, la Callas par exemple. Enfin, Lafont évoque les œuvres qui le touchent le plus comme Pelléas et Mélisande de Debussy, ses chefs d’orchestre de prédilection… Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 20 Mar 2024 - 24min - 584 - Thématique : l’Intelligence Artificielle, avec Raphaël Doan
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 2 février 2024. Avec cette semaine : - Raphaël Doan, historien, écrivain, auteur de Si Rome n’avait pas chuté. - Matthias Fekl, avocat et ancien ministre de l’Intérieur. - Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Blick. - Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE L’intelligence artificielle « est un outil particulièrement puissant pour inventer des uchronies et les développer jusqu'au moindre détail, car elle est capable d'halluciner des choses qui ne se sont jamais produites tout en s'inspirant de données réelles. Cela lui permet de générer des histoires uniques et fascinantes qui sont ancrées dans la réalité, mais qui explorent aussi des possibilités nouvelles et imaginaires. L'une de ses grandes forces, dans un tel projet, est sa capacité à générer des images immersives et réalistes. » Le texte que je viens de lire, première préface de votre dernier ouvrage, Si Rome n’avait pas chuté, a été généré par l’intelligence artificielle. Pour réaliser ce livre, vous avez dirigé plusieurs IA afin qu’elles écrivent et illustrent une uchronie sur un Empire romain bénéficiant d'une révolution industrielle avant l'heure, avec la découverte d’une machine à vapeur au 1er siècle. Si, comme vous le reconnaissez, les textes manquent de style, ils ne sont ni meilleurs ni pires que la moyenne des productions des étudiants de nos facultés. Les illustrations ont davantage d’allure. Dans un site que vous aviez créé, « AI or Art », vous invitiez les utilisateurs à deviner si une série d'images avait été réalisée par un humain ou par un ordinateur. Résultat : « beaucoup de candidats parvenaient à peine à dépasser le score qu'ils auraient atteint en devinant parfaitement au hasard. » Votre livre repose sur une conviction : l’IA générative n’est pas un simple gadget ; la coopération avec elle « recèle de véritables trésors. » Vous êtes convaincu que, bientôt, « la génération de contenu par IA sera omniprésente dans la production intellectuelle, artistique, scientifique, et dans nos vies quotidiennes. » S’il semble difficile de s’y opposer, vous êtes conscient des risques et des menaces qui l’accompagnent. La création artistique ne sera plus le monopole de l’être humain. Les conséquences pour l’industrie culturelle seront profondes. En automatisant et en produisant en masse des compétences intellectuelles, l’IA générative va également provoquer une « série de mutations contraintes » dans beaucoup d’autres secteurs. De nouveaux métiers vont apparaître. Mais contrairement aux précédentes révolutions industrielles, « la rapidité de la transition la rendra probablement plus brutale du point de vue social et économique. » D’autres risques relèvent de l’utilisation malveillante de ces outils ou encore des inégalités de revenu qu’ils pourraient créer. Par ailleurs, avec l’IA générative, l’image ne sera plus synonyme de vérité. Pire, sa capacité à créer des contenus ultra-personnalisés risque de démultiplier un phénomène que nous observons déjà : le repli sur soi. Ainsi pourrait-elle nous condamner à ne jamais sortir de la prison que chacun de nous est pour lui-même. Ce risque est d’autant plus inquiétant que l’IA peut être utilisée pour créer des contenus politiques et idéologiques. Vous êtes agrégé de lettres classiques, vous avez exploré certains aspects de l’histoire de Rome dans trois livres avant celui qui nous réunit. L’intelligence artificielle a-t-elle, et en quoi, modifié, contredit, complété, ébranlé votre connaissance du monde romain ? Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 17 Mar 2024 - 59min - 583 - Bada : Les questions du public (propositions de Macron sur l’Ukraine)
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à l’École alsacienne le 10 mars 2024. Avec cette semaine : - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - François Bujon de l’Estang, ambassadeur de France. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 13 Mar 2024 - 34min - 582 - Les pays européens, l’Ukraine, les propositions de Macron
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à l’École alsacienne le 10 mars 2024. Avec cette semaine : - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - François Bujon de l’Estang, ambassadeur de France. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. LES PAYS EUROPÉENS, L’UKRAINE, LES PROPOSITIONS DE MACRON À l'issue d'une conférence internationale de soutien à l'Ukraine réunissant une vingtaine d’homologues à l’Élysée, le 26 février, Emmanuel Macron a créé la surprise : interrogé sur la possibilité d'envoyer des troupes occidentales sur le sol ukrainien le Président français n'a pas écarté cette option : « Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre », a affirmé le chef de l'État, disant « assumer » une « ambiguïté stratégique ». Plusieurs pays occidentaux alliés de l'Ukraine ont aussitôt pris leurs distances. Le chancelier allemand Olaf Scholz a assuré que l'Otan ne déploierait pas de combattants au sol en Ukraine, alors qu'un responsable de la Maison Blanche assurait que les Etats-Unis ne prévoyaient pas non plus d'en envoyer. La Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Suède, l’Italie et l’Espagne ont opposé une fin de non-recevoir à la suggestion française. Plus ambigu, le Royaume-Uni a affirmé « ne pas prévoir de déploiement à grande échelle » de troupes en Ukraine en plus du « petit nombre » de personnes déjà sur place « pour soutenir les forces armées ukrainiennes, notamment pour la formation médicale. » Plutôt que d’envoyer des troupes combattre aux côtés des soldats ukrainiens, l’Élysée présente l’idée d’une prise en charge sur le terrain d’activités, comme le déminage, la formation ou la surveillance des frontières. Sur la scène européenne, les rares voix à soutenir la démarche sont venues des Pays baltes, en première ligne face à la Russie. Avant le déclenchement de cette polémique, les chefs d’États et de gouvernement réunis à Paris avaient pourtant affiché leur unité en approuvant cinq actions concernant : la défense cyber, la coproduction d'armements en Ukraine (comme va le faire l'Allemand Rheinmetall dans les obus), la défense des pays tiers menacés, en particulier la Moldavie, le déminage et l'aide à l'Ukraine pour le contrôle de sa frontière avec la Biélorussie avec des forces non-militaires. Emmanuel Macron a reconnu que l'engagement de l'UE à fournir un million d'obus avait été « imprudent », les Européens n'ayant pu fournir que 30% du total, faute de stocks et de capacités industrielles. Deux ans après le début de l'offensive russe en Ukraine et la sérieuse dégradation des relations entre Moscou et le Vieux continent, de nombreux pays européens ont décidé d'augmenter drastiquement leurs budgets accordés à la Défense. Les pays voisins de la Russie consacrent beaucoup plus de moyens à leurs armées proportionnellement à leurs ressources. Ainsi, en 2022, les dépenses militaires de l'Europe ont atteint 314 milliards d'euros, une progression record depuis plus de trois décennies, selon les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), soit une hausse de 30% par rapport à 2012. Ce chiffre devrait encore grimper en 2023 et 2024 au vu des annonces de chefs d'États européens allant dans ce sens. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 10 Mar 2024 - 1h 04min - 581 - Bada : Jacques Trentesaux, journaliste et fondateur de Mediacités (3/3)
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une conversation entre Jacques Trentesaux et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 22 décembre 2023. Dans ce troisième et dernier épisode, Jacques Trentesaux aborde l'état de la presse indépendante en France, marqué par la concentration des médias entre les mains de milliardaires et les défis posés par cette concentration pour la diversité des voix et la liberté de la presse. Il évoque les aides à la presse, les effets des algorithmes des réseaux sociaux sur la diffusion de l'information, et appelle à un soutien accru pour les médias indépendants afin de préserver un paysage médiatique diversifié. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 06 Mar 2024 - 16min - 580 - Thématique : agriculture et environnement, avec Quentin Sannié
Vous aimez notre émission ? Soutenez-la ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 19 janvier 2024. Avec cette semaine : - Quentin Sannié, entrepreneur et fondateur de l’agence de notation des sols Genesis. - David Djaïz, entrepreneur, essayiste et ancien secrétaire général du Conseil National de la Refondation. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT Quentin Sannié, vous êtes entrepreneur et chef d’entreprise. Après avoir co-fondé et dirigé le leader mondial du son haut de gamme, Devialet, vous vous êtes lancé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale en 2018, avec la création de Genesis – la première agence de notation des terres agricoles. Votre start-up innovante est née du constat suivant : il subsiste une lacune significative dans la mesure de l'impact environnemental des pratiques agricoles et les acteurs du secteur demeurent souvent aveugles aux conséquences sur l’environnement de leurs décisions. D’où votre idée de noter la santé des sols pour mieux corriger les techniques de ceux qui les travaillent. Selon vous, « En collectant des pratiques et en établissant des corrélations scientifiques entre les techniques agricoles, le climat et la santé des sols, on peut voir quels leviers d'action ont un vrai impact positif ». Aujourd’hui, 60 à 70 % de nos sols en Europe sont abîmés ou très abîmés, estime l’Union Européenne. Leur bonne santé est pourtant décisive pour la fertilité, la productivité agricole, le stockage du CO2, la rétention et la filtration de l’eau. « Nous devons soulever le capot de nos sols et des pratiques agricoles liées, pour comprendre comment les faire évoluer durablement vers des modes régénératifs », écrivez-vous. Cette absence de mesure risque de mettre en péril notre souveraineté alimentaire. Les pratiques régénératrices doivent, en effet, être déclinées selon les types de cultures, de productions, de sols et de climats. Cette lacune ne concerne pas seulement l’évaluation ; le sol est en effet le grand absent de la politique environnementale alors qu’il pour vous le véritable éléphant dans la pièce en matière d'environnement. L’exploitation des sols représente 20 à 25 % des émissions de gaz à effet de serre ; ils sont à la source de notre alimentation, renferment 1/4 de la biodiversité mondiale, et, en stockant plus de carbone que les forêts, constituent un enjeu essentiel de la lutte contre le changement climatique. Pourtant le sol demeure le seul milieu naturel à ne pas être couvert par une politique nationale dédiée à sa protection. Les multiples alertes que vous avez lancées avec la communauté scientifique semblent néanmoins être arrivées jusqu’aux oreilles des parlementaires. Menée par le député (Modem) du Loiret Richard Ramos, une proposition de loi visant « à instaurer un diagnostic de la santé des sols, des terrains agricoles, naturels et forestiers » a été déposée à l’Assemblée Nationale le 12 octobre 2023. De même, quelques jours plus tard, une proposition de loi visant à « préserver des sols vivants » a été déposée par la sénatrice PS Nicole Bonnefoy. L’objectif est d’apporter une réponse globale avec la création d'une stratégie nationale pour la protection et la résilience des sols, sous la houlette d'un haut-commissaire dédié. Mais avant de nous pencher sur l’articulation des sols avec l’agriculture et la transition écologique, racontez-nous comment votre projet est né. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 03 Mar 2024 - 59min - 579 - Bada : Jacques Trentesaux, journaliste et fondateur de Mediacités (2/3)
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une conversation entre Jacques Trentesaux et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 22 décembre 2023. Dans ce deuxième épisode, Jacques Trentesaux nous raconte l'aventure journalistique qu’il a lancée en 2016 : Médiacités. À travers l’exemple de ce média d’investigation au niveau régional, Il aborde les défis rencontrés dans ce travail essentiel pour la démocratie - difficultés financières, censure et exclusion, manque de soutien du service public. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 28 Feb 2024 - 24min - 578 - Dette : comment faire des économies ? / À quoi ressemble la Russie de Poutine ?
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 23 février 2024. Avec cette semaine : - Nicolas Baverez, essayiste et avocat. - Matthias Fekl, avocat et ancien ministre de l’Intérieur. - Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef du quotidien La Croix. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. DETTE : COMMENT FAIRE DES ÉCONOMIES ? Depuis plusieurs mois plus aucun expert ne croyait à l'hypothèse de croissance de la France, fixée à 1,4 % pour 2024. La Commission européenne et la Banque de France n'attendent que 0,9 %, l'OCDE 0,6 %. Finalement, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire a annoncé dimanche qu'il l'abaissait à 1 %, avec à la clef, des recettes fiscales en moins pour l'État et l'obligation d'annoncer un plan d'économies en urgence de 10 milliards d'euros pour tenir l'objectif d'un déficit public ramené de 4,9 % à 4,4 % du PIB. Des économies visant à maîtriser la trajectoire de notre dette, qui atteint désormais 3.088 milliards d'euros et 111,9 % du PIB. Les 10 milliards d’euros seront économisés « exclusivement sur le budget de l’État », a précisé Bruno Le Maire, qui dit emprunter là « la voie du courage » plutôt que celle de la « facilité » consistant à augmenter les impôts. Des économies d’autant plus urgentes selon Bercy que les dépenses se sont multipliées depuis janvier, comme les 400 millions d’euros dégagés pour les agriculteurs, les primes pouvant aller jusqu’à 1.900 euros pour les policiers et gendarmes à l’occasion des Jeux olympiques, ou les 3 milliards d’euros promis à l’Ukraine. Les collectivités locales et la sphère sociale (retraites, chômage, assurance maladie, prestations sociales, etc.) sont à ce stade épargnées. Toutefois un nouveau tour de vis sur l’assurance chômage interviendra dès cette année, et un doublement des franchises médicales sera instauré. La moitié des 10 milliards d’euros annoncés proviendront d’annulations de crédits dans les budgets des ministères sur la gestion de leur immobilier, leurs recrutements, leurs dépenses énergétiques ou leurs achats. Sept cents millions d’euros seront gagnés sur les dépenses de personnel et 750 millions sur les achats. Les 5 autres milliards seront prélevés sur différentes politiques publiques, à commencer par le budget des opérateurs de l’État, ces agences spécialisées dont les crédits seront réduits d’un milliard d’euros. Bruno Le Maire a notamment cité France compétences (chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage), le Centre national d’études spatiales, l’agence nationale de la cohésion des territoires, ou encore Business France, qui aide les entreprises françaises à s’internationaliser. Un milliard d’euros seront retranchés du budget de l’aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov’, qui sera ramenée de 5 à 4 milliards d’euros cette année, tout en continuant à augmenter par rapport à l’année précédente. Enfin, 800 millions d’euros seront ponctionnés dans les crédits de l’aide publique au développement, avec notamment une contribution réduite à l’ONU. Si l’économie se dégradait davantage, un budget rectificatif pourrait s’imposer, a prévenu le ministre. Mais le contexte politique rend l’exercice très périlleux en l’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale. Le prochain projet de loi de finances attendu à l'automne doit dégager 12 milliards d'euros supplémentaires. Des revues de dépenses sont engagées et seront l'occasion de regarder du côté de la Sécurité sociale, en particulier les affections longue durée telles que le diabète ou les cancers, actuellement prises en charge à 100 % par l'assurance maladie. A QUOI RESSEMBLE LA RUSSIE DE POUTINE ? En dépit des sanctions occidentales, l’économie russe connait une croissance 2,6% meilleure que celle de la zone euro, selon les estimations du Fonds monétaire international publiées fin janvier. L'activité économique du pays est désormais largement tirée par un secteur, devenu prioritaire : la Défense. Moscou a acté une envolée de près de 70% des dépenses militaires en 2024, soit 6% du PIB. Moscou parie aussi sur ses revenus pétroliers et les échanges commerciaux avec son voisin chinois, pour soutenir son économie. Toutefois, la Russie doit faire face à une inflation de 7,4% et un taux de chômage à 3%, qui traduit des pénuries de main d'œuvre persistantes. À long terme, l'exode à l'étranger de 800.000 à un million de Russes, selon les estimations, à la suite du lancement de l'offensive en Ukraine et après la mobilisation partielle de septembre 2022, va continuer à peser sur de nombreux secteurs (banques, énergie, télécommunications...), amputés des travailleurs qualifiés dont ils ont besoin. Récemment, la Douma s'était alarmée du fait qu'en 2046, la Russie aura perdu 7,5% de ses habitants, selon les prévisions officielles. Elle a aussi rappelé que le taux de natalité était évalué à 1,42 enfant par femme fin 2022. Ce chiffre était de 1,5 en 2020, la moyenne dans l'Union européenne. Selon l’agence statistique Rosstat, la Russie comptait, au 1er janvier dernier, 146.447.424 habitants (Crimée annexée comprise). Soit moins qu’en 1999. Des jeunes parmi les mieux formés, et donc armés pour travailler à l’étranger, ont quitté le pays pour ne pas être mobilisés. Selon le renseignement américain 120.000 soldats russes auraient été tués depuis le début de la guerre en Ukraine pour un total hors de combat d'environ 320.000 blessés. Soit deux fois plus que les pertes ukrainiennes, mais avec une population quatre fois plus élevée. La conquête le 16 février dernier par les soldats russes de la ville d’Avdiïvka, dans la région de Donetsk et le retrait des forces ukrainiennes, constitue une victoire symbolique pour Moscou. Avdiivka est la première conquête substantielle russe depuis la prise de Bakhmout, en mai 2023. À l'approche de l'élection présidentielle en Russie, Moscou n'a pas manqué d'exprimer son autosatisfaction : Vladimir Poutine a salué une « importante victoire ». Elle aurait coûté 47.178 hommes à l'armée russe d'après l'état-major ukrainien. Avdiivka tombée, la Russie devrait mettre à l'épreuve la seconde ligne de fortifications établie par l'armée ukrainienne ces derniers mois. En politique intérieure, la mort en détention de l’opposant Alexeï Navalny, annoncée le 16 février, signale selon Renaud Girard dans le Figaro : « un retour de la Russie aux pratiques staliniennes. Sous Brejnev, on enfermait les dissidents, mais on ne les tuait pas », remarque-t-il. Le scrutin présidentiel des 15-17 mars prochains, où même le plus modéré des opposants, Boris Nadejdine, n'a pas été autorisé à se présenter, ne devrait pas représenter une compétition politique significative. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 25 Feb 2024 - 59min - 577 - Bada : Jacques Trentesaux, journaliste et fondateur de Mediacités (1/3)
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une conversation entre Jacques Trentesaux et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 22 décembre 2023. Pour ce nouveau Bada du Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer a eu la joie de recevoir Jacques Trentesaux, journaliste, co-fondateur de Mediacités. Dans ce premier épisode, Jacques Trentesaux se penche, à la lumière de son parcours, sur la profession de journaliste. Il mentionne l’importance de la formation et du milieu social. Il souligne les difficultés rencontrées aujourd’hui dans le reportage et l'enquête journalistiques, tout en déplorant un système médiatique qui privilégie la nouveauté au détriment d'une investigation approfondie. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 21 Feb 2024 - 21min - 576 - Écologie, « la Révolution obligée »
Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 9 février 2024. Avec cette semaine : - David Djaïz, entrepreneur, essayiste et ancien secrétaire général du Conseil National de la Refondation. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. PREMIÈRE PARTIE : DIAGNOSTIC En 2022, 82 % de l’énergie consommée dans le monde était d’origine fossile. Cette proportion reste inchangée depuis quarante ans. De ce chiffre accablant, David Djaïz et Xavier Desjardins tirent un constat provocateur : « la transformation écologique n’a pas commencé. » Malgré la reconnaissance de la crise climatique et les efforts engagés pour combattre ses effets sur l’environnement, la croissance démographique, la hausse de la consommation énergétique et les hésitations politiques maintiennent notre dépendance aux énergies fossiles. « Pire, les timides mesures écologiques déjà engagées rencontrent souvent de virulentes oppositions partout en Europe ». Le défi climatique se caractérise par une double contrainte de temps et d’objectif. Nous devons, en effet, atteindre la neutralité carbone autour de 2050. D’où le titre de votre essai : La Révolution obligée, au double sens du terme, à la fois inévitable et fortement dirigée. « Malheureusement, nous n’avons pas trente ans, pas même dix pour penser et expérimenter le comment agir. Aussi renvoyez-vous à un penseur du gouvernement dans l’urgence, Machiavel, qui nous apprend que « lorsque la tempête approche, une pensée politique valide ne se développe pas in abstracto, mais se forge en situation, sous les contraintes concrètes de l’action. » Ces contraintes sont nombreuses. D’abord, comme la révolution industrielle, la transformation écologique exige un changement de ressources énergétiques, le déploiement d’innovations technologiques et institutionnelles, une forte augmentation de l’investissement dans de nouvelles industries et la relégation de certains équipements. Mais elle doit se produire à une vitesse bien plus rapide et sans les mêmes promesses de gains économiques. C’est pourquoi « tout le monde se renvoie la balle » ; chacun estime que les autres doivent porter la majeure partie des efforts. Ainsi la transformation écologique est-elle la source d’une compétition entre les territoires, les secteurs, les classes sociales et les générations. De plus, les problèmes écologiques entrent parfois en contradiction. Par exemple, certaines mesures en faveur de la décarbonation peuvent nuire à la biodiversité ou au cycle de l’eau. Enfin, régler l’urgence climatique ne peut être accompli indépendamment des huit autres processus écologiques qui caractérisent le système Terre. Malgré ces obstacles, « le coût de l’inaction climatique est infiniment supérieur à celui de l’action. » C’est ce qu’ont compris la Chine et les États-Unis, engagés dans des transformations intégrées à leurs stratégies nationales. La Chine, avec son concept de « civilisation écologique », mène une politique d'autoritarisme vert, tandis que les États-Unis, à travers l'Inflation Reduction Act, investissent massivement dans les énergies renouvelables et les technologies vertes. L’Europe a, quant à elle, adopté un ensemble de normes, d’instruments de marché et de soutiens à l’innovation afin de devenir le premier continent « climatiquement neutre » en 2050. Mais son Pacte Vertfait face à des défis de financement et de soutien social. Vous le jugez trop réglementaire et inadapté aux enjeux politiques, économiques et sociaux de la transition écologique. DEUXIÈME PARTIE : NOUVEAU PACTE VERT « Si l’on veut sauver la transition écologique, il faut imaginer un autre Pacte vert, une nouvelle méthode de conduite du changement écologique. Celle-ci doit s’inspirer de l’expérience chinoise ou américaine, non pas pour les imiter, mais pour comprendre combien la « civilisation écologique » chinoise comme l’IRA américain sont articulés à un imaginaire national, à un modèle de gouvernance, à une économie politique ou encore à une pratique des relations internationales. » Le nouveau Pacte vert doit s’appuyer sur les forces de l’Europe : l’État-providence ; la diversité des territoires et des modes de vie ; la vivacité de la société civile dans un cadre démocratique et pluraliste. Seul un modèle conforme au projet politique européen permettra de recueillir l’adhésion de la société. Aussi proposez-vous un nouveau contrat social qui repose sur trois piliers : un nouvel imaginaire de la solidarité ; un nouveau pacte de production et de consommation ; un nouveau mode de gouvernance. L'incertitude quant à la répartition exacte des gains et des pertes nécessite, d’après vous, l'adoption d'une nouvelle solidarité, dans le cadre d'un contrat social refondé à partir du « voile d'ignorance » du philosophe libéral John Rawls et l’acceptation collective des coûts. L'État-providence élargi que vous envisagez transcenderait les frontières nationales et inclurait l'eau, l'air, le sol, les animaux, et les végétaux. Ainsi pourrions-nous « réencastrer » nos sociétés dans les limites planétaires, tout en reconnaissant les droits des éléments non humains. Durkheim avait théorisé le passage d’une solidarité mécanique à une solidarité organique. Une solidarité écologique,pourrait renouveler la confiance dans les institutions et mobiliser les citoyens. Votre nouveau pacte de production et de consommation postule la nécessité d'une politique industrielle européenne, qui lui assure son autonomie tout en soutenant l'innovation, la production d'énergie propre et la consommation durable. Pour accompagner cette transformation, vous proposez la création d'un pass climat qui unifierait les aides existantes en faveur de la transition écologique, offrant une flexibilité et un soutien financier adaptés aux besoins et revenus de chaque citoyen européen. Financé au niveau européen, ce pass climat permettrait d’engager tous les citoyens dans l'action écologique et rendrait tangible la solidarité européenne dans la lutte contre le changement climatique. Vous proposez enfin un nouveau mode de gouvernance fondé sur le contrat. La négociation sectorielle et territoriale adapterait les exigences écologiques aux spécificités locales et permettrait ainsi une transformation plus juste et plus efficace. Vous appelez également à une nouvelle décentralisation et à l'utilisation de nouveaux outils de mesure et de suivi. Cette nouvelle architecture de la transition, fondée sur le consensus régional et la contribution active des collectivités, vise à renforcer la capacité de l'Europe à réaliser une transformation écologique harmonieuse. Vous voyez ce nouveau Pacte Vert comme une opportunité de réenchanter l'Europe et de renforcer la démocratie face aux défis écologiques. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 18 Feb 2024 - 1h 01min - 575 - Bada : les questions du public (remaniement et Ukraine)
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à l’Ecole alsacienne le 11 février 2024. Avec cette semaine : - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - David Djaïz, entrepreneur, essayiste et ancien secrétaire général du Conseil National de la Refondation. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. - Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 14 Feb 2024 - 39min - 574 - Remaniement ministériel / Si les Etats-Unis lâchent l’Ukraine, que fera l’Europe ?
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à l’Ecole alsacienne le 11 février 2024. Avec cette semaine : - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - David Djaïz, entrepreneur, essayiste et ancien secrétaire général du Conseil National de la Refondation. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. - Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. REMANIEMENT MINISTÉRIEL Attendue depuis plus de trois semaines, l’achèvement de la composition du gouvernement de Gabriel Attal a été retardé par le refus de François Bayrou d'entrer dans l'équipe. Le dirigeant centriste a invoqué mercredi un désaccord de fond avec les deux têtes de l'exécutif, alors que son nom circulait notamment pour le portefeuille de l'Éducation nationale depuis sa relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. La liste rendue publique jeudi soir par un simple communiqué de l'Élysée, comprend en plus des 15 ministres de départ, 2 ministres de plein exercice, 13 ministres délégués et 5 secrétaires d'État. Le chef de l’État souhaitait une équipe resserrée de 30 ministres, au lieu des 41 de l'équipe Borne. Au terme du plus long remaniement de l'histoire de la Ve République, le gouvernement est composé de 35 ministres et secrétaires d'État. Promue il y a moins d'un mois à la tête d'un ministère cumulant Éducation, Sports et JO dans le gouvernement de Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castéra paye des polémiques à répétition en perdant le ministère de l'Éducation nationale, mais conserve celui des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. « Emmené » par Gabriel Attal à Matignon, le dossier éducation sera désormais partagé avec l’ancienne garde des Sceaux Nicole Belloubet. En dépit de la crise ouverte par François Bayrou, le Modem conserve quatre postes. Le parti d'Edouard Philippe passe de 3 à 2 portefeuilles. La plupart des entrants sont des revenants. A Bercy, Olivia Grégoire (Entreprises, Tourisme et Consommation), Thomas Cazenave (Comptes publics) et Roland Lescure (Industrie, et désormais Energie) restent auprès de Bruno Le Maire. Quelques périmètres sont fusionnés pour réduire la taille du gouvernement. Aucun ministre du gouvernement Attal 1 ne vivait plus au sud qu'Angers, ville de Christophe Béchu (Transition écologique). Une Nantaise, une Bourguignonne, une Savoyarde une Héraultaise, Une Marseillaise, font leur entrée. La parité, en revanche, est respectée, même si on peut observer que 8 ministres de plein exercice sur 13 sont des hommes, tandis que 4 secrétaires d'État sur 5 sont des femmes. SI LES ÉTATS-UNIS LACHENT L’UKRAINE, QUE FERA L’EUROPE ? Depuis le début de l'invasion russe il y a près de deux ans, les États-Unis ont alloué plus de 75 milliards de dollars à l'Ukraine, dont 44 milliards d'aide militaire, selon le Kiel Institute. Mais, il y a plusieurs mois, l'administration Biden a prévenu qu'elle n'était plus en mesure de continuer à soutenir militairement l'Ukraine sans l'aval du Congrès, et donc, sans compromis bipartisan. Le 12 décembre, à la Maison-Blanche, aux côtés de son homologue ukrainien, le président américain qui déclarait que l’appui des États-Unis à l’Ukraine se poursuivrait « aussi longtemps que nécessaire » (« as long as it takes »), a nuancé son propos en déclarant que l’aide militaire à Kyiv continuera « aussi longtemps que possible » (« as long as we can »). Certains élus Républicains ont cherché à utiliser cette question pour atteindre un autre objectif : des mesures plus strictes en matière d'immigration et d'asile. Volodymyr Zelensky s’est vainement rendu à deux reprises à Washington pour tenter de convaincre le Congrès de ne pas abandonner l'Ukraine, en dépit des avancées jugées trop modestes de sa contre-offensive : le 6 décembre, les élus Républicains ont bloqué une enveloppe de 106 milliards de dollars comprenant des fonds pour l'Ukraine mais aussi pour Israël, Joe Biden ayant décidé de lier les deux dans un plaidoyer pour la défense de la « démocratie » et de la « sécurité nationale » des États-Unis. Sur les quelque 118 milliards de dollars prévus par ce texte, plus de la moitié est destinée à l'Ukraine, dont 48 milliards de soutien militaire. Mercredi, les sénateurs ont rejeté un texte visant à débloquer de nouveaux fonds pour ces deux pays en guerre, tout en réformant le système migratoire des Etats-Unis. Jeudi, le Sénat a finalement accepté d'examiner un texte sans le volet migratoire. Il pourrait se prononcer prochainement lors d'un vote final puis l'envoyer à la Chambre des représentants, où les Républicains sont majoritaires. A Bruxelles, en revanche, le 1er février, les Européens sont parvenus à contourner l'opposition de Viktor Orbán pour voter un soutien de 50 milliards d'euros à Kyiv. Un nouveau paquet de sanctions contre Moscou est également en préparation. Les États membres ont validé le plan de la Commission pour identifier et mettre sous séquestre les revenus des actifs de la Banque centrale russe immobilisés en Europe (environ 200 milliards d'euros). A terme, les revenus de ces actifs devraient être taxés et les fonds récoltés transférés à Kyiv. Des transferts estimés entre 3 et 5 milliards d'euros par an. L'accord est selon le New York Times « particulièrement important, tant pour l'Ukraine que pour l'Union européenne ». L'enveloppe d'aide - 33 milliards de prêts et 17 milliards de dons sur quatre ans contribuera à maintenir l'économie ukrainienne à flot pour les quatre prochaines années. Le montant total de l’aide des Européens à l’Ukraine dépasse désormais celui de l’aide américaine. L’annonce de ce soutien européen a été immédiatement saluée par Kyiv, comme une « victoire commune » sur la Russie. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 11 Feb 2024 - 1h 04min - 573 - Bada : Marion Godfroy Tayart de Borms, historienne de la gastronomie (4/4)
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Marion Godfroy Tayart de Borms et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 27 novembre 2023. Dans ce quatrième et dernier épisode, Marion F. Godfroy-Tayart de Borms aborde l'importance de la formation en histoire pour les métiers de la gastronomie. Elle souligne la nécessité de connaître l'histoire pour s'inspirer du passé, s'en affranchir et s'inscrire dans l'histoire d'une profession en constante évolution. Elle revient également sur l'évolution des techniques, comme la cuisine à induction, ainsi que l'influence de la télévision et des médias sur la gastronomie. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 07 Feb 2024 - 19min - 572 - Thématique : le procès Pétain, avec Julian Jackson
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 2 février 2024. Avec cette semaine : - Julian Jackson, historien britannique, spécialiste de l’histoire de France du XXème siècle. - Nicolas Baverez, essayiste et avocat. - Michel Winock, historien et écrivain. LE PROCÈS PÉTAIN Julian Jackson vous êtes historien, spécialiste du XXe siècle de l’histoire de France. Après un ouvrage sur l’occupation et une biographie de Charles de Gaulle que nous avions saluée ici même, vous publiez France on Trial : The Case of Marshal Pétain,publié au Seuil fin janvier dans une traduction titrée Le Procès Pétain et sous-titrée Vichy face à ses juges. « On peut revisiter le procès de Pétain sans vouloir le refaire, écrivez-vous dans votre introduction. L’exercice permet d’observer les Français de 1945 en train de débattre à chaud de leur histoire. » Comme le suggère le sous-titre de votre livre, ce n’est pas seulement le Maréchal qui est jugé. « Nous serions des hypocrites, écrit Mauriac, si, avant de mêler nos voix à toutes celles qui l’accusent, chacun de nous ne se demandait : qu’ai-je dit, qu’ai-je écrit ou pensé au moment de Munich ? De quel cœur ai-je accueilli l’armistice ? [...] Ne reculons pas devant cette pensée qu’une part de nous‐même fut peut‐être complice, à certaines heures, du vieillard foudroyé. » C’est, au fond, ce qui rend ce procès unique : les Français jugeaient le héros de la Grande Guerre qu’ils avaient presque accueilli avec soulagement (le « lâche soulagement » qu’éprouvait Blum au moment de Munich ?) : « Si un référendum s’était tenu en juin 1940 pour confirmer l’arrivée de Pétain à la présidence du Conseil, je pense que 95 % des Français auraient voté en sa faveur », écrivez-vous. Lorsqu’elle se réunit dans une certaine précipitation la Haute Cour de justice, composée de trois magistrats professionnels et de 24 jurés (12 résistants et 12 parlementaires), se réunit pour juger de la conduite du chef de Vichy, elle peine à déterminer de quoi Pétain doit répondre. Pour de Gaulle, le crime était l’armistice ; Raymond Aron ne condamnait Pétain qu’à partir de novembre 1942, lorsqu’il était resté en France alors que les Allemands bafouaient l’armistice et franchissaient la ligne de démarcation ; Simone Weil, quant à elle, considérait l’armistice comme un acte de lâcheté collective qui ne pouvait être imputé à Pétain seul. Les débats qui se déroulent pendant les trois semaines du procès ne règlent pas cette question. Vous décrivez toutes les étapes du procès, de l'interrogation du prisonnier jusqu'au délibéré qui condamne Pétain à mort, à l'indignité nationale, et à la confiscation de ses biens, condamnation tempérée par une demande de non-exécution pour « tenir compte du grand âge de l'accusé ». Le général de Gaulle, exaucera ce vœu. La Haute cour savait qu’il ne pouvait en aller autrement. Au lendemain du procès, Mauriac écrit : « Un procès comme celui‐là n’est jamais clos et ne finira jamais d’être plaidé. » Dans la troisième partie de votre livre intitulée « ce passé qui ne passe vraiment pas », vous montrez qu’il avait raison, et vous concluez : « Si le dossier Pétain est clos, le pétainisme n’est pas mort. » Il me semble que c’est en constatant cette permanence du pétainisme, sa présence dans le débat public en 2022 plus de soixante dis-ans après la mort du Maréchal et plus de quatre-vingts ans après son accession au pouvoir que vous avez en quelque sorte remonté le courant à la recherche des raisons et du contenu de cette permanence jusqu’à en arriver à ce procès ni fait ni à faire. Est-ce bien votre démarche ? Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 04 Feb 2024 - 59min - 571 - Bada : Marion Godfroy Tayart de Borms, historienne de la gastronomie (3/4)
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Marion Godfroy Tayart de Borms et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 27 novembre 2023. Dans ce troisième épisode, Marion F. Godfroy-Tayart de Borms raconte l'histoire du célèbre Fouquet's, depuis son ouverture en 1898. Elle décrit comment ce lieu est devenu un symbole de pouvoir et de sociabilité dans le Paris de l'époque. Elle évoque notamment le rôle du Fouquet's dans l'histoire du cinéma français et sa transformation en un lieu emblématique de cette industrie. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 31 Jan 2024 - 13min - 570 - Le Conseil Constitutionnel et la loi immigration / Les révoltes paysannes en Europe
Vous aimez notre peau de caste ? Soutenez-nous ! https://www.lenouvelespritpublic.fr/abonnement Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 26 janvier 2024. Avec cette semaine : - Michel Eltchaninoff, rédacteur en chef du mensuel Philosophie Magazine. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET LA LOI IMMIGRATION Le projet de loi sur l’immigration adopté dans un climat de tension par le Parlement le 19 décembre, restreignait le regroupement familial, l’accès des non-Européens à certaines prestations sociales et mettait fin à l’automaticité du droit du sol … Fin décembre, la loi a fait l’objet de quatre saisines du Conseil constitutionnel : celle du président de la République, celle de la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et deux saisines de députés et sénateurs de gauche. De l’aveu même du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui a porté ce texte, plusieurs dispositions étaient « manifestement et clairement contraires à la Constitution » et certains au sein de l’exécutif espéraient une censure partielle. Le 8 janvier, Emmanuel Macron, lors de la présentation de ses vœux au Conseil constitutionnel, s’était fait sermonner par Laurent Fabius, qui déclarait que la juridiction qu’il préside n'est « ni une chambre d'écho des tendances de l'opinion, ni une chambre d'appel des choix du Parlement », qui soulignait « une certaine confusion chez certains entre le droit et la politique » avant de rappeler au chef de l’Etat les bases d’un « Etat de droit », et notamment cette règle : on ne peut pas voter une loi dont on sait que certaines dispositions sont contraires à la loi fondamentale. L'occasion de citer son prédécesseur Robert Badinter : « Une loi inconstitutionnelle est nécessairement mauvaise, mais une loi mauvaise n'est pas nécessairement inconstitutionnelle ». Dans sa décision rendue jeudi, le Conseil constitutionnel a censuré plus du tiers du texte, dont le durcissement de l’accès aux prestations sociales. Des 86 articles de la loi, 32 ont été censurés en tant que cavalier législatif, en raison de l'absence de lien entre leur objet et celui de la loi. C'est le cas des articles liés au regroupement familial, la mise en place d'une caution pour les étudiants étrangers, la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé ou encore la restriction des prestations sociales (allocations familiales, aide personnalisée au logement…).. Toutes ces mesures avaient été portées par Les Républicains (LR) dans le cadre de l'accord passé avec la majorité pour faire voter la loi. Après la censure du Conseil Constitutionnel, Gérald Darmanin se félicite de la validation de « l’intégralité du texte du gouvernement », LR réclame un « projet de loi immigration 2 » pour y inclure les mesures rejetées, le RN demande un référendum. LES RÉVOLTES PAYSANNES EN EUROPE L'Europe est depuis plusieurs semaines agitée par les révoltes des agriculteurs contre de multiples politiques, bruxelloises et nationales, climatiques ou économiques. Une vague de colère se répand chez les agriculteurs allemands, roumains, espagnols, français ou néerlandais, pour des raisons propres à chaque pays, mais qui se rejoignent dans leur dénonciation unanime de mesures trop contraignantes et trop chères. Souvent revient la question des enjeux climatiques, faisant resurgir un conflit redondant entre le monde agricole et environnemental. La première mèche a été allumée aux Pays-Bas. Les agriculteurs néerlandais se sont engagés dans une révolte nationale contre un plan du gouvernement qui visait à réduire le nombre de vaches de 30 % d'ici 2030, afin de faire baisser les émissions d'azote du pays. Cette colère a résonné en Irlande, où les producteurs laitiers ont manifesté leur mécontentement eux aussi contre des restrictions imposées à l'azote. Même causes, mêmes effets en Belgique. En Allemagne, en revanche, les agriculteurs se mobilisent contre une réforme de la fiscalité qui prévoit en 2026 de supprimer une exonération sur le diesel agricole. Partout, les inquiétudes des agriculteurs se cristallisent autour des répercussions financières de mesures qui mêlent économies budgétaires et décisions écologiques. Mais les politiques climatiques ne sont pas les seules à déstabiliser le monde agricole. En Roumanie et en Pologne, la guerre en Ukraine remet en question les modèles économiques des exploitants locaux. L'ouverture à l'importation des céréales ukrainiennes pour soutenir l'économie de leur voisin en guerre a mis en difficulté leurs producteurs nationaux. Résultat : des centaines de tracteurs et camions de marchandises ont paralysé les routes polonaises et roumaines, et même des voies de passage avec l'Ukraine. Les agriculteurs européens dénoncent tous le Pacte vert européen ou Green Deal qui prône la transition écologique des Etats membres de l'UE, fixe des objectifs de réduction d'usage des pesticides, de développement de l'agriculture biologique et de protection de la biodiversité, mais qui intervient dans un contexte déjà tendu pour les agriculteurs, bousculés par des événements climatiques extrêmes, la flambée de leurs coûts de production et les conséquences commerciales de la guerre en Ukraine. En France, selon un sondage Elabe/BFM 70% des Français pensent que la mobilisation va déclencher « un mouvement social de grande ampleur dans les prochaines semaines ». 89% soutiennent le mouvement (plus que pour les Gilets Jaunes) et 70% approuvent le blocage des routes et refusent toute intervention des forces de l’ordre. Le malaise paysan pourrait vite trouver une traduction dans les urnes : selon le dernier sondage Elabe, 51 % des agriculteurs placent la question du pouvoir d'achat et de la lutte contre l'inflation en tête des enjeux des élections européennes, et 29 % se disent prêts à voter pour la liste Bardella. A quelques semaines du lancement du Salon international de l'agriculture, qui se tiendra du 24 février au 3 mars à Paris, l'exécutif tente une modération. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 28 Jan 2024 - 1h 00min - 569 - Bada : Marion Godfroy Tayart de Borms, historienne de la gastronomie (2/4)
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Marion Godfroy Tayart de Borms et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 27 novembre 2023. Dans ce deuxième épisode, Marion F. Godfroy-Tayart de Borms se concentre sur l'époque de Napoléon et la façon dont la gastronomie reflète le pouvoir et le raffinement. Elle évoque les figures de Napoléon et de Talleyrand, mettant en lumière leur compréhension de l'importance de la table et de l'étiquette impériale. L'histoire de Carême, le premier chef à mettre en avant sa signature et son image, est également abordée, ainsi que l'évolution de la gastronomie dans la société, notamment l'accessibilité limitée de la classe moyenne à certaines techniques culinaires. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 24 Jan 2024 - 19min - 568 - Après la conférence de presse de Macron, quoi de neuf ? / Élections à Taïwan
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 19 janvier 2024. Avec cette semaine : - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. - Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Blick. - Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. APRÈS LA CONFÉRENCE DE PRESSE DE MACRON, QUOI DE NEUF ? Mardi soir, le président de la République a fixé le cap, pour « rendre la France plus forte et plus juste » et tracé trois lignes directrices : « Audace, action et efficacité ». Le chef de l’État s'est concentré sur les réformes de l'Éducation nationale : l'uniforme sera testé dès l'an prochain, dans une centaine d'établissements volontaires en primaire, au collège et au lycée, mais pas en maternelle. Les établissements devront organiser des cérémonies de remise des diplômes, notamment du brevet des collèges. La Marseillaise, sera enseignété aux enfants en primaire. C’était déjà une obligation depuis 2005, mais tombée en désuétude. Les heures d’instruction civique seront doublées. Ce « réarmement civique » se couple à un « réarmement démographique », visant à pallier la chute de la natalité. Le congé parental sera transformé en un « congé de naissance », mieux rémunéré, ouvert aux deux parents et limité à six mois. Parmi les mesures annoncées, une commission d'experts doit notamment déterminer d'ici au mois de mars « le bon usage des écrans pour nos enfants dans les familles à la maison », comme à l'école. L'ordre qui doit rendre « la France plus forte », s'applique notamment à la lutte contre l'islamisme et au trafic de drogue, qui vise désormais les petites villes et les villages. Pour y remédier, le rythme des opérations dites « place nette » frappant les narcotrafiquants sera accéléré : « dix opérations de ce type seront conduites chaque semaine ». Dans la fonction publique, la rémunération au mérite sera renforcée. Pour les classes moyennes, une baisse de 2 milliards d'euros d'impôts, longtemps évoquée est désormais actée pour 2025. Emmanuel Macron a annoncé, pour continuer de lever les blocages et les freins à l'innovation, une loi Macron 2 pour la croissance, pour « lutter contre les rentes », et pour la simplification. Il souhaite lancer un acte II de la réforme du marché du travail lancé en 2017 pour atteindre le plein-emploi en 2027. A la clé, des mesures logement et transports. Enfin, pour lutter contre les déserts médicaux, qui sont l'une des premières préoccupations des Français, le chef de l'État a demandé la régularisation des médecins étrangers. Selon lui, contraindre les médecins à s’installer dans les régions en manque n'est pas la bonne solution. Il privilégie une réorganisation du système de santé. Sur les médicaments, la franchise va doubler. ÉLECTIONS À TAÏWAN Le 13 janvier, Lai Ching-te du Parti démocrate progressiste (DPP) d'inspiration indépendantiste a été élu à la présidence de Taïwan avec 40,1 % des voix. Il s'agit de la troisième victoire consécutive du DPP à la présidentielle, du jamais vu dans la jeune démocratie taïwanaise. Lai Ching-te a profité d'une forte participation de plus de 70 % et de la division de l'opposition, marquée par l'émergence d'un troisième parti populiste, le Parti du Peuple de Taïwan, qui a récolté 26 % des voix en misant sur les enjeux économiques. Le nouveau président perd toutefois sa majorité parlementaire en n’obtenant que 51 sièges à la chambre basse, contre 52 pour le Kouomintang favorable à un rapprochement avec la Chine et 8 sièges pour le Parti du Peuple de Taïwan. Cela risque de compliquer le vote de certaines lois sur la défense, le budget et les échanges avec le continent chinois. Selon le suivi de l’Université Chengchi, si plus de 90 % des habitants de l’île sont des descendants de Chinois, plus de 62 % s’identifient uniquement comme taïwanais, contre 17 % en 1992 ; et 30,5 % se voient comme taïwanais et chinois, contre 46 % il y a trois décennies. Lai Ching-te ne prendra ses fonctions qu’en mai, mais Pékin a répété, dès l'annonce des résultats que sa détermination à réaliser la réunification restait intacte. Les États-Unis ont félicité Lai pour sa victoire, mais en pesant leurs mots à l'heure d'une timide relance diplomatique avec la Chine, depuis le sommet de San Francisco, entre Joe Biden et Xi Jinping en novembre. « Nous ne soutenons pas l'indépendance », a déclaré le président américain tandis qu’une délégation de hauts diplomates américains s’est rendue dimanche à Taipei pour réaffirmer l'appui à l'île. Ces précautions n'ont pas suffi à rassurer Pékin, qui a « déploré fortement » ces félicitations, car elles envoient un « message erroné » aux forces « séparatistes ». Le statut de Taïwan est le sujet le plus explosif dans les relations entre la Chine et les États-Unis. Si Washington reconnaît Pékin au détriment de Taipei depuis 1979, le Congrès américain impose parallèlement de fournir des armes à Taïwan, dans le but affiché de dissuader la Chine de toute volonté expansionniste. Le Quai d’Orsay, comme l’UE, ont félicité « les électeurs » et « les élus », sans spécifier le nom du vainqueur du scrutin. Au lendemain du scrutin, Taïwan a perdu un de ses rares alliés diplomatiques avec l'annonce par Nauru, un micro-Etat du Pacifique, de la rupture des liens avec Taipei. Taïwan n'est désormais plus reconnu officiellement que par 12 pays dans le monde. Promettant d'être « du côté de la démocratie », le président élu prévoit de « poursuivre les échanges et la coopération avec la Chine », premier partenaire commercial de Taïwan, territoire de 23 millions d'habitants situé à 180 km des côtes chinoises. Un conflit dans le détroit les séparant serait désastreux pour l'économie mondiale : plus de 50 % des conteneurs transportés dans le monde y transitent et l'île produit 70 % des semi-conducteurs de la planète. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 21 Jan 2024 - 1h 01min - 567 - Bada : Marion Godfroy Tayart de Borms, historienne de la gastronomie (1/4)
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Marion Godfroy Tayart de Borms et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 27 novembre 2023. Pour ce nouveau Bada du Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer a eu la joie de recevoir Marion F. Godfroy-Tayart de Borms, historienne spécialiste de la gastronomie et ses chefs. Dans ce premier épisode, Marion F. Godfroy-Tayart de Borms nous plonge dans l'histoire de la gastronomie et ses chefs, explorant les différents codes de cet art, tels que les couleurs, les saveurs et la santé. Elle illustre comment le bien-vivre et la sociabilité se sont développés à travers les banquets, depuis l'époque des Romains. Elle nous raconte également l'évolution de la cuisine à travers les âges, de la période médiévale raffinée à la Renaissance et les influences nouvelles, soulignant l'importance de la codification et de l'innovation dans l'art culinaire. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 17 Jan 2024 - 18min - 566 - Un remaniement, pour quoi faire ? / Israël, toujours plus la guerre
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 12 janvier 2024. Avec cette semaine : - Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique. - François Bujon de l’Estang, ambassadeur de France. - Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Blick. - Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. UN REMANIEMENT, POUR QUOI FAIRE ? Mardi, le président de la République a fait le choix de Gabriel Attal pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon. Comme elle, issu du Parti socialiste, ce macroniste de la première heure a effectué une trajectoire gouvernementale fulgurante et, en moins de six mois Rue de Grenelle, une impressionnante ascension dans l'opinion. Sa nomination est un pari pour tenter de retrouver, avant les européennes, « l'audace » et le « mouvement » du début du premier quinquennat. Sur X (anciennement Twitter), Emmanuel Macron a défendu « la fidélité à l'esprit de 2017 : dépassement et audace ». Cette nomination s’inscrit dans la ligne de ses vœux aux Français, dans lesquels il insistait sur la nécessité d'un « réarmement » dans un certain nombre de domaines, « civique » notamment. L'Élysée précise qu’il s’agit d’« un choix de fond pour une nouvelle phase du quinquennat ». Gabriel Attal est attendu l'arme au pied par les oppositions qui n'ont vu en lui qu'un fac-similé du Président. Éric Ciotti (LR) dénonce « la communication permanente », Jean-Luc Mélenchon (LFI) moque un simple « porte-parole », le communiste Ian Brossat « un clone » et Olivier Faure (PS) juge qu'« Emmanuel Macron se succède à lui-même. » Dans la majorité, nombre de députés ont salué « l'élan » espéré via cette nomination. D'autres, tout en lui reconnaissant un grand sens politique et un « art consommé de la communication », estiment qu'il incarne le « désidéologisation de la politique ». Dans son discours d’arrivée à Matignon, Gabriel Attal a tenu à reprendre son thème fétiche des classes moyennes, de ceux « qui travaillent et qui financent nos services publics et notre modèle social » et qui « ne s'y retrouvent plus ». Le quotidien L’Opinion liste les douze travaux du tout nouveau chef du gouvernement : Vaincre le chômage ; Rembourser la dette ; Restaurer l’autorité ; Sauver la planète ; Réussir les Jeux Olympiques ; Assurer la survie du macronisme ; Vaincre le Rassemblement national ; Convaincre la droite ; Calmer l’aile gauche ; Relever le niveau à l’école ; Faire face aux urgences ; Apprivoiser les poids lourds. Le défi le plus proche est celui des élections européennes de juin prochain qui s'annoncent difficiles pour la majorité face au Rassemblement national et qui seront une étape majeure avant la présidentielle de 2027 et la succession d'Emmanuel Macron. *** ISRAËL, TOUJOURS PLUS LA GUERRE ? Trois mois après l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, Israël est toujours plongé dans la guerre et rien ne semble indiquer une prochaine sortie de crise. Le conflit pourrait même entrer dans une nouvelle phase. L'assassinat ciblé le 2 janvier, à Beyrouth, de Saleh al-Arouri, numéro deux de la branche politique du Hamas, réveille la crainte qu'il ne prenne une dimension régionale avec l'ouverture d'un nouveau front au nord d'Israël. « Le crime que constitue l’assassinat de Saleh Al-Arouri au cœur de la banlieue sud de Beyrouth est une grave agression contre le Liban (…) et ne restera pas sans riposte ou impuni », a promis le Hezbollah. Le ministère iranien des affaires étrangères a déclaré que l’assassinat de Saleh Al-Arouri allait donner encore plus de motivation à l’« axe de résistance » contre Israël. Un porte-parole de l'armée israélienne a affirmé que « Tsahal est prête à faire face à tous les scénarios », autrement dit à une guerre sur plusieurs fronts au sud à Gaza, au nord au Liban et en Syrie, sans compter de possibles tirs de missiles des Houthis yéménites alliés de Téhéran ou de milices pro-iraniennes depuis l'Irak. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant a rappelé les objectifs des forces de défense israéliennes : le retour des otages israéliens, le démantèlement militaire et opérationnel du Hamas, la suppression de la menace sécuritaire dans la bande de Gaza. Cependant, l’armée a besoin de clarifications, afin de réduire le nombre de ses troupes au sol. Un redéploiement attendu en janvier est déjà signalé. Tsahal souhaite préserver ses réservistes pour une guerre longue, qui coûte quelque 100 millions d’euros par jour, et préparer une éventuelle poursuite de la guerre au nord du pays, contre le Hezbollah libanais. D'importants renforts militaires ont été déployés en Cisjordanie ainsi qu'à la frontière avec le Liban. Le 6 janvier, l'armée israélienne annonçait avoir « achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza » : seules des bandes de miliciens isolés y agiraient encore. Plus de 80% de la population dans la bande de Gaza a dû abandonner ses foyers, plus de 22.000 personnes, civils et combattants, ont été tuées et 7.000 sont portées disparues, selon le ministère de la santé de Gaza. L'armée israélienne reconnaît implicitement que les deux tiers d'entre eux sont des civils, et non des combattants ennemis. De son côté, elle a perdu 175 soldats depuis le début de son offensive terrestre, le 27 octobre. En amont de la visite du secrétaire d’État américain Anthony Blinken dans la région, le ministre israélien de la Défense a présenté pour la première fois depuis le 7 octobre des pistes pour l'après-guerre. Dans son scénario, pas de retour des colons israéliens dans la bande de Gaza mais une administration locale validée par Israël, qui garderait le contrôle militaire du territoire. Ce plan est contesté au sein même du gouvernement israélien, dont les ministres ultra-nationalistes sont favorables à l'implantation de colonies. Benyamin Netanyahou, qui a besoin de leur soutien pour garder la majorité à la Knesset, ne s'est pas encore prononcé clairement. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 14 Jan 2024 - 1h 04min - 565 - Bada : les questions du public (Jacques Delors et Brexit)
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à l’Ecole alsacienne le 7 janvier 2024. Avec cette semaine : - Nicolas Baverez, essayiste et avocat. - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. - Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 10 Jan 2024 - 27min - 564 - L’héritage européen de Jacques Delors à l’heure de l’impérialisme russe / Le naufrage du Brexit
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à l’Ecole alsacienne le 7 janvier 2024. Avec cette semaine : - Nicolas Baverez, essayiste et avocat. - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. - Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. L’HÉRITAGE EUROPÉEN DE JACQUES DELORS À L’HEURE DE L’IMPÉRIALISME RUSSE Jacques Delors l'ancien président de la Commission européenne s'est éteint, le 27 décembre, à 98 ans. Entré en fonction à Bruxelles en janvier 1985, l'ancien ministre des Finances français prévient « L’Europe n’a d’autre choix qu’entre la survie et le déclin. Il occupera son bureau bruxellois durant dix années consécutives, et marquera la construction européenne de son empreinte, au point que la presse américaine le baptise le « tsar de Bruxelles ». Son impulsion est décisive dans l’adoption de l’Acte unique, qui donne naissance au marché unique européen. Dans ses Mémoires, Jacques Delors donne à ce marché une triple fonction : organiser « la compétition qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit. » Suivront le traité de Maastricht, la monnaie commune, la création des fonds de cohésion pour soutenir l’élargissement de l’Union à des entrants moins bien lotis économiquement que les membres fondateurs, ou encore le programme d’échanges universitaires Erasmus. Jacques Delors était devenu le partenaire de nombreux chefs d'État et de gouvernement engagés comme lui en faveur de la construction européenne : le Chancelier allemand Helmut Kohl, le Premier ministre belge Jean-Claude Dehaene, le chef du gouvernement espagnol Felipe Gonzalez et François Mitterrand. En 2015, il a été nommé « citoyen d'honneur de l'Europe » troisième personnalité à être ainsi distingué, après Jean Monnet en 1976 et Helmut Kohl en 1998. Si Jacques Delors quitte Bruxelles, en janvier 1995, avec la satisfaction d'avoir rempli sa mission, il s'en va aussi avec le regret de constater, comme bien d'autres mais en l'ayant vécu de l'intérieur, à quel point l'Europe reste un nain politique. Il reste donc un long chemin à parcourir. Il va s'y employer, dans la mesure de ses moyens, avec sa fondation, Notre Europe. En 2021, il finira par porter sur l’Union européenne un regard critique, dans son interview testamentaire au Point constatant qu’« À vingt-sept, on s'éloigne des projets qui étaient ceux de Jean Monnet ou Robert Schuman. Du moins, on les rend beaucoup plus difficiles. Rien que le fonctionnement d'une Commission européenne à vingt-sept, déjà... » Pascal Lamy, son ancien directeur de cabinet, confie que Jacques Delors avait conscience de la difficulté de la situation actuelle, dans laquelle un seul des 27 peut jouer contre les 26 autres, voire, comme l’a fait récemment Viktor Orban monnayer son vote sur l’adhésion de l’Ukraine. Au moment où Jacques Delors disparait, deux questions se posent : face aux régimes illibéraux « la compétition qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit » va-t-elle passer du marché aux marchandages ? Face à l’impérialisme russe l’Europe est-elle toujours un nain politique ? *** LE NAUFRAGE DU BREXIT Le 1er janvier 2021 la Grande Bretagne est sortie de l'Union européenne. Sept ans après le référendum qui a vu les partisans du divorce l'emporter, un sondage de l'institut Opinium publié par « The Guardian » note que les Britanniques ne sont désormais plus que 22 % à juger que la séparation a été une bonne chose pour le Royaume-Uni. L'institut a demandé à 2.000 électeurs de juger si la sortie de l'UE avait eu un effet positif ou négatif dans différents domaines. Résultat : les avis positifs ne l'emportent pour aucune question. Seul un sondé sur dix estime que la sortie de l'UE a amélioré sa situation financière personnelle ou optimisé les salaires, quand 63 % la rendent responsable d'une partie de l'inflation. « Une nette majorité de l'opinion publique estime désormais que le Brexit a été néfaste pour l'économie britannique, a fait monter les prix dans les magasins et a entravé les tentatives du gouvernement de contrôler l'immigration », résume le quotidien. En 2023, 29.437 migrants ont fait la traversée, contre 45.774 en 2022 qui avait été une année record, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur publiés le 1er janvier. Une autre enquête, menée auprès des entreprises, montre que les sociétés travaillant avec l'UE se plaignent des nouvelles règles douanières. Christopher Hayward, le président du conseil d'administration de la City of London Corporation, l'organisation qui gère le quartier financier de Londres, estime que « Le Brexit a été un long et douloureux divorce. La confiance a été anéantie. » Selon un sondage de la British Chambers of Commerce de décembre, 2023, 60 % des exportateurs vers l'UE estiment que les échanges commerciaux sont plus difficiles qu'il y a un an. Or, toutes les obligations liées au Brexit ne sont pas encore en place. Les contrôles sanitaires sur les importations n’entreront en vigueur que cette année. Pour le gouvernement de Rishi Sunak, 2024 s’ouvre dans l’appréhension d’une défaite électorale, sur fond de prédictions économiques moroses et d’un retournement d’opinion sur le Brexit Quelques sondages mesurent même un « Bregret », le regret du Brexit… Après quatorze ans au pouvoir, cinq premiers ministres, un Brexit et divers scandales, les tories sont devancés d’au moins quinze points par le Labour dans toutes les enquêtes d’opinion. Toutefois, contrairement aux précédentes le Brexit ne devrait pas s'imposer comme un thème central des élections législatives qui auront lieu cette année. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 07 Jan 2024 - 1h 04min - 563 - Bada : Laurent de Wilde, pianiste, écrivain et homme de radio (5/5)
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Laurent de Wilde et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 22 septembre 2023. Pour ce nouveau Bada du Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer a eu la joie de recevoir Laurent de Wilde, pianiste de Jazz, compositeur, producteur, écrivain et homme de radio. Dans ce cinquième et dernier épisode, il nous décrit également l’économie musicale aujourd’hui et le système de protection des interprètes : l’Adami - Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 03 Jan 2024 - 12min - 562 - Thématique : l’assassinat de Kennedy et le complotisme, avec François Carlier et François Dufour
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 8 décembre 2023. Avec cette semaine : - François Carlier, écrivain, auteur de L’assassinat de Kennedy expliqué, bilan définitif après 60 ans. - François Dufour, journaliste, auteur de L’assassinat de JFK. - Matthias Fekl, avocat et ancien ministre de l’Intérieur. L’ASSASSINAT DE JFK ET LE COMPLOTISME Le 22 novembre 1963, le 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, était assassiné alors qu'il traversait la ville de Dallas, au Texas. À l’occasion du soixantième anniversaire de cette tragédie, les médias nous ont replongé dans ses méandres, avec une couverture presque aussi opulente qu'en 2013. L’évènement est rapidement devenu une énigme criminelle alimentant fantasmes, spéculations et supputations. Sait-on enfin ce qui s’est passé ce 22 novembre ? Oui, sans aucun doute pour mes deux invités, chacun auteur d’un livre sur l’assassinat de JFK. François Dufour, vous êtes journaliste, cofondateur de Play Bac en 1985, et rédacteur en chef du Petit Quotidien, de Mon Quotidien, de L’ACTU et de L’ÉCO. Votre petit livre publié en 2018 est limpide : Lee Harvey Oswald tire trois balles. La deuxième blesse JFK. La troisième le tue. Observé et entendu pendant son acte, en fuite, son profil est signalé. Le policier Tippit essaye de l’interpeller mais Oswald le tue de quatre balles, avant de se cacher dans un cinéma où il est finalement repéré. Le reste est du cinéma, dites-vous. Notamment le film complotiste d’Oliver Stone : « JFK » (1991), dans lequel vous relevez 24 fake news. François Carlier, vous êtes quant à vous l’auteur d’une somme monumentale – 944 pages – publiée pour la première fois en 2008, et rééditée en septembre 2023 avec pour titre : « L’assassinat de Kennedy expliqué, bilan définitif après 60 ans ». Le résultat de cette entreprise, qui a mobilisé une grande partie de votre vie, est clair : Lee Harvey Oswald, et lui seul, a tué Kennedy, sans complot d’aucune sorte. « Les histoires incroyables mais vraies, cela existe », écrivez-vous. Dans sa préface à votre ouvrage Philippe Labro écrit : « J’ai balancé et parfois hésité - parfois tenté d'accepter la version du complot. Mais, avec le temps, avec la réflexion, avec mes propres travaux, je persiste et signe : il existe une vérité, solide. Il existe ce que de grands historiens américains ont appelé « la tragédie sans raison ». Cependant, cette clarté des faits ne se reflète pas dans le traitement de l'affaire par de nombreux médias et journalistes français, qui oscillent entre scepticisme et théories du complot. Des figures médiatiques comme Laurent Delahousse, Thomas Sotto ou Pascal Praud expriment des doutes, tandis que d'autres comme Franck Ferrand, Marc Dugain ou Jean-Alphonse Richard penchent vers le complotisme. Avant de laisser vous interroger sur vos travaux, dites-nous d’abord comment vous êtes, chacun, devenus des experts du « Meurtre du siècle », pour reprendre l’expression d’un autre complotiste, feu Alexandre Adler, toujours rediffusé sur France Culture. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 31 Dec 2023 - 1h 01min - 561 - Bada : Laurent de Wilde, pianiste, écrivain et homme de radio (4/5)
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Laurent de Wilde et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 22 septembre 2023. Pour ce nouveau Bada du Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer a eu la joie de recevoir Laurent de Wilde, pianiste de Jazz, compositeur, producteur, écrivain et homme de radio. Dans ce quatrième épisode, Laurent de Wilde nous parle de Thelonious Monk à qui il a dédié une biographie récompensée en 1996 par le prix Charles Delaunay du meilleur livre sur le jazz ainsi que par le prix Pelléas. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 27 Dec 2023 - 16min - 560 - Thématique : Les Juifs en France 1940-1945, avec Jacques Semelin (rediffusion)
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 18 février 2022. Avec cette semaine : - Jacques Semelin, historien, politologue, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste des processus de résistance civile au sein des dictatures ainsi que de l'analyse des massacres et génocides. - Nicolas Baverez, essayiste et avocat. - Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef du quotidien La Croix. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. « Comment se fait-il que tant de Juifs ont pu survivre en France malgré le gouvernement de Vichy et les nazis ? », demandait Simone Veil en 2008 à l’historien spécialiste des crimes de masse et de la Shoah, Jacques Semelin. Dans « Une énigme française, Pourquoi les trois quarts des Juifs en France n’ont pas été déportés », l’historien explique cette exception française. Si Serge Klarsfeld a établi que trois quarts des Juifs en France ont échappé à la mort (chiffre exceptionnel en Europe), ce n'est pas l'action des quelque 4 000 Justes français qui pouvait à elle seule l'expliquer. Pas davantage une imaginaire mansuétude de Vichy : vous démontrez que ce n’est pas grâce, mais en dépit de Vichy que la très grande majorité des Juifs en France ont pu survivre. Transformant cette abstraction des 75% en nombre, vous rapportez qu’au moins 200 000 juifs sont toujours en vie en France à la fin de l’occupation, à l’automne 1944. Beaucoup se sont dispersés à la campagne, tandis qu’au moins 40 000 sont restés à Paris. Des filières de sauvetage (juives et non juives) ont contribué à sauver environ 10 000 vies, notamment celles d’enfants. Mais l’engagement de ces organisations de résistance ne peut rendre compte de la survie d’au moins 200 000 personnes, soit 65% des Juifs étrangers et 90% des Juifs français. D’autres explications doivent donc être trouvées.Sans jamais minimiser l’horreur du crime, vous écrivez votre enquête dans la mémoire des Juifs non déportés, votre analyse des circonstances de l’époque. Vous dégagez plusieurs facteurs d’explication : la chronologie de la persécution, les statuts politiques et militaires des territoires, les géographies et cultures des régions, de l’évolution de la guerre et de la situation internationale. L’histoire culturelle et politique de la société française : l’intégration des Israélites à la nation, le rôle de l’école et de la culture républicaine, l’ouverture ou le rejet des étrangers en lien avec les besoins économiques et démographiques du pays, la propagation des idées xénophobes et antisémites, l’influence du christianisme (antijudaïsme, charité). La structure des rapports occupants-occupés, les capacités de réactivité à la persécution des individus stigmatisés comme Juifs en fonction de leur nationalité (française ou non), leur âge et situation familiale, leurs ressources linguistiques, financières et sociales. La réactivité sociale des populations non juives vis-à-vis des Juifs sur les bases de l’intérêt (économique et financier) ou des ressorts de la compassion. La formation d’une opinion hostile aux opérations les plus brutales de la persécution (arrestations et déportations des juifs apatrides), ayant provoqué une dissension publique au sein des élites catholiques, par ailleurs favorables à l’Etat collaborateur. L’influence de cette prise de parole publique sur la politique de collaboration des dirigeants français. La capacité des Juifs et non Juifs à s’organiser collectivement pour créer des réseaux clandestins de résistance civile visant au sauvetage des victimes désignées, en premier lieu des enfants. Le développement d’une « société parallèle » qui, imbriquée à la « société officielle », contribue à la protection des pourchassés et persécutés du régime. De toute cette période et sur toutes ces questions, quelle vous semble être la réalité la plus difficile à faire reconnaître par l’opinion ? Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 24 Dec 2023 - 1h 00min - 559 - Bada : Laurent de Wilde, pianiste, écrivain et homme de radio (3/5)
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Laurent de Wilde et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 22 septembre 2023. Pour ce nouveau Bada du Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer a eu la joie de recevoir Laurent de Wilde, pianiste de Jazz, compositeur, producteur, écrivain et homme de radio. Dans ce troisième épisode, Laurent de Wilde nous parle du rapport qu’il entretient avec son instrument : le piano. Il analyse plus généralement le clavier et nous parle de son livre Les Fous du Son, dans lequel il retrace l’histoire des inventeurs de claviers électroniques. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 20 Dec 2023 - 17min - 558 - Le Conseil Européen devant les tribulations de l’Ukraine
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 15 décembre 2023. Avec cette semaine : - Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique. - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. LE CONSEIL EUROPÉEN DEVANT LES TRIBULATIONS DE L’UKRAINE Le Conseil européen a réuni jeudi et vendredi les chefs d’Etat et de gouvernement des 27 à Bruxelles, Ils ont pris la décision d’entamer les négociations d’adhésion avec l’Ukraine et la Moldavie. Il devait aussi avaliser un soutien de 50 milliards d’euros pour la période 2024-2027, afin de démontrer à Vladimir Poutine que les Européens sont prêts à soutenir ce pays dans la durée. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán a tenté de bloquer ces deux décisions pour lesquelles l’unanimité est requise. Pour fléchir le dirigeant magyar, Bruxelles a cette fois mis sur la table le déblocage de 10 milliards d’euros de fonds européens gelés. En Europe comme aux Etats-Unis, le soutien financier à l'Ukraine ne va plus de soi. Quand, en juin 2022, les 27 décidèrent d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat, il était convenu que Kyiv remplisse sept conditions avant l'ouverture des négociations. Parmi celles-ci, le respect des droits des minorités, qui ont été mises à mal en Ukraine par une législation contestée. Viktor Orbán est particulièrement sensible à ce que l'Ukraine rétablisse les droits de la minorité hongroise de Transcarpathie. L'Ukraine doit faire face à des tensions avec d’autres pays, notamment avec la Pologne, pourtant soutien de la première heure. Varsovie accuse Kyiv de concurrence déloyale dans les secteurs céréaliers et routiers. Si bien qu'elle n'assure plus que les livraisons d'armes « convenues antérieurement ». Le gouvernement pro-européen qui doit entrer en fonction la semaine prochaine, pourrait changer la donne. En Slovaquie, le nouveau Premier ministre Robert Fico a bloqué début novembre, une importante livraison d'armes programmée par l'exécutif précédent. Aux Pays-Bas, la formation d'extrême droite de Geert Wilders a remporté les élections législatives fin novembre. Parmi les mesures prévues dans son programme : l'interruption des livraisons d'armes à l'Ukraine. Selon un sondage du Conseil européen pour les Relations internationales dans six Etats membres de l'UE (Allemagne, France, Danemark, Pologne, Roumanie et Autriche), un grand nombre de citoyens pense que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne nuirait à la sécurité de l'Europe (45 % en moyenne) plus qu'elle ne la renforcerait (25 %). Interrogés sur l'impact dans leur propre pays, seuls 15 % des Français et 20 % des Allemands s'attendent à ce que la sécurité de leur pays soit renforcée par une telle adhésion (39 et 47 %, respectivement, pensent que le résultat sera négatif). Il n'y a qu'en Pologne que les opinions positives l'emportent nettement (41 % contre 30 %). Si au Danemark et en Pologne, près de la moitié de la population soutient l'adhésion de l'Ukraine, à l'inverse, en Autriche, seuls 28 % des citoyens sont favorables à l'adhésion, tandis que 52 % y sont opposés. Mais dans la plupart des pays, 20 à 40 % des personnes interrogées n'ont pas d'opinion ou sont indifférentes à la perspective de l'adhésion de l'Ukraine et de l'élargissement en général. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 17 Dec 2023 - 1h 05min - 557 - Bada : Laurent de Wilde, pianiste, écrivain et homme de radio (2/5)
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Laurent de Wilde et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 22 septembre 2023. Pour ce nouveau Bada du Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer a eu la joie de recevoir Laurent de Wilde, pianiste de Jazz, compositeur, producteur, écrivain et homme de radio. Dans ce deuxième épisode, Laurent de Wilde analyse les transformations du monde du jazz et l’évolution de la place des femmes. Il nous parle également d’un instrument qui occupe une place particulière dans ce monde : l’accordéon. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 13 Dec 2023 - 16min - 556 - Quelle politique pour combattre la menace islamiste ? / La première COP vraiment géopolitique
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 8 décembre 2023. Avec cette semaine : - Matthias Fekl, avocat et ancien ministre de l’Intérieur. - Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef du quotidien La Croix. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. - Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. QUELLE POLITIQUE POUR COMBATTRE LA MENACE ISLAMISTE EN FRANCE ? L'attaque mortelle perpétrée le 2 décembre contre un touriste germano-philippin par un jeune Français fiché S, près de la tour Eiffel, confirme la persistance de la menace islamiste. Quelques semaines après Arras, en plein conflit Hamas-Israël et à huit mois des JO, les inquiétudes grandissent. Selon les différents services antiterroristes français, cette menace serait pour beaucoup le fait d'adolescents de 13 à 18 ans fascinés par la violence et enfermés dans une sorte de bulle numérique. Les prisons françaises accueillent aujourd'hui 391 détenus terroristes islamistes et 462 détenus de droit commun susceptibles de radicalisation. Déjà emprisonné pour terrorisme, et ayant fait l’objet d’un suivi psychiatrique, le profil de l’assaillant relance la polémique entre responsabilité psychiatrique et idéologie radicale. « Entre 25 % et 40 % des personnes suivies pour radicalisation sont concernées par des maladies mentales », assure Gérald Darmanin, favorable à ce que les pouvoirs publics puissent exiger une « injonction de soins pour une personne radicalisée suivie pour troubles psychiatriques ». Un préfet, et non un médecin, pourrait ainsi forcer un radicalisé souffrant de problèmes psychiatriques à continuer son traitement. « L’analyse psy, elle est fondamentale. Mais il faut la combiner avec une solide connaissance de la dimension idéologique, parce que si on prend de l’idéologie pour de la folie, on fait des erreurs d’évaluation », souligne le chercheur Hugo Micheron, spécialiste du djihadisme. Autre mesure envisagée par le ministre de l’Intérieur, et par le président du Rassemblement national, celle de durcir la « rétention de sûreté », c'est-à-dire le maintien dans une forme de détention des cas jugés toujours menaçants à l'issue de leur peine. Le ministre de l’Économie et des Finances a déploré, pour sa part, que la publication d’images, faisant l’apologie du terrorisme, ne fasse l’objet d’« aucune sanction » pénale, contrairement au partage de contenus pédopornographiques. L'attentat confirme les craintes d'une importation de la guerre au Proche-Orient, l’auteur ayant évoqué la mort de Palestiniens à Gaza pour expliquer son geste. Depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas contre Israël, l'ensemble des pays européens ont accru leur niveau de vigilance. Tout comme la France, l'Espagne et la Belgique ont notamment renforcé la protection des synagogues. Au-delà des interrogations autour du suivi psychiatrique défaillant et des services de renseignement débordés, il y a la problématique des « sortants » : ces personnes condamnées pour terrorisme, qui ont purgé leur peine, et qui restent suivies de près. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que, depuis qu'il y a des condamnations pour terrorisme, 340 personnes radicalisées qui ont purgé leur peine sont sorties de prison. « L'année prochaine, ce sera entre 30 et 35 personnes », a-t-il ajouté. *** LA PREMIÈRE COP VRAIMENT GÉOPOLITIQUE « Critique », « cruciale », « charnière » : du 30 novembre au 12 décembre la Conférence des Nations unies sur le changement climatique, la COP28 rassemble à Dubaï, l'un des Émirats arabes unis - septième producteur mondial de pétrole- plus de 70.000 personnes (dirigeants, lobbies, ONG ou journalistes...). L'année 2023 devrait être la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Les effets de ce réchauffement climatique s'aggravent : fonte des glaciers, sécheresses à répétition, pénurie d'eau, perte de la biodiversité … D’après une étude de l’agence ONU Climat, publiée mi-novembre, les engagements climatiques actuels des pays mènent à 2% de baisse des émissions mondiales en 2030 comparé à l'année 2019, loin de la réduction de 43% recommandée par le GIEC. Hypothétique sortie du pétrole, fonds pour aider les pays les plus vulnérables au changement climatique, mobilisation de la finance mondiale pour l'adaptation, bilan des efforts consentis par les États pour réduire leurs émissions ... Le programme est chargé et cristallise déjà des débats entre pays du Nord, et du Sud. Lors de l’ouverture de la conférence, le président émirati de la COP28, le sultan al-Jaber a évoqué « le rôle des combustibles fossiles ». Il avait estimé auparavant que la réduction des énergies fossiles est « inévitable et essentielle », se gardant toutefois de fixer un calendrier. Seule une vingtaine de pays, dont la France, plaident franchement pour la fin de l'ensemble des énergies fossiles. Dès le premier jour de la COP, la création d'un fonds « pertes et dommages » climatiques pour les pays les plus vulnérables a été également actée. Historique, cette décision a été saluée par une ovation debout des délégués des 196 pays participants. A ce stade, 720 millions de dollars ont été récoltés. En outre, les Émirats ont promis la création d'un fonds de 30 milliards de dollars pour aider ces pays à conduire leur transition énergétique. Pour la première fois depuis huit ans, les 196 États et l'Union européenne doivent évaluer les progrès réalisés par les pays depuis la signature de l'Accord de Paris de 2015. Ses signataires s'étaient engagés à maintenir l'augmentation de la température « bien en dessous » de 2,0 °C, et de préférence de 1,5 °C, par rapport aux niveaux préindustriels. Les débats les plus difficiles portent sur l'engagement des pays à réduire l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz, gros émetteurs de CO2. La COP28 se déroule dans un contexte géopolitique tendu lié à la guerre en Ukraine, et le conflit qui fait rage dans la bande de Gaza au Proche-Orient. Certains dirigeants présents à Dubaï, notamment les présidents israélien et français ont mené des négociations, en marge de la conférence, pour aboutir à la libération des otages détenus par le Hamas. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 10 Dec 2023 - 1h 00min - 555 - Bada : les questions du public (Hamas et populismes en Europe)
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à l’École alsacienne le 3 décembre 2023. Avec cette semaine : - Nicolas Baverez, essayiste et avocat. - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 06 Dec 2023 - 41min - 554 - Le Hamas, mort certaine ou victoire historique ? / Les populismes auront-ils l’Europe à l’usure ?
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à l’École alsacienne le 3 décembre 2023. Avec cette semaine : - Nicolas Baverez, essayiste et avocat. - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. LE HAMAS, MORT CERTAINE OU VICTOIRE HISTORIQUE ? Après les massacres du 7 octobre et la débâcle sécuritaire pour le pays, la feuille de route que s’est fixée le gouvernement israélien est « de parvenir à la destruction des capacités militaires et administratives du Hamas et du Jihad islamique de manière à les empêcher de menacer et d’attaquer les citoyens d’Israël pendant de nombreuses années ». Un objectif très proche de celui déjà formulé en 2008, au lendemain de la prise de contrôle par le Hamas de la bande de Gaza. Ce qui interroge sur sa faisabilité. Car le Hamas n’est pas seulement une organisation, elle est aussi une idéologie qui, elle, ne va pas mourir. Pour le chroniqueur du Monde, Alain Frachon « on peut même parier que le pilonnage aérien systématique, les destructions d’habitations, l’exil intérieur et les privations imposées à une population gazaouie martyrisée vont susciter la prochaine génération de djihadistes. » En poursuivant cette offensive coûteuse en vies humaines palestiniennes, l’armée israélienne se retrouve de fait sur le terrain choisi par le Hamas. Comme lors des incursions précédentes, nul doute que ses infrastructures et ses miliciens sont déjà durement touchés et le seront plus encore, mais l’éradication promise par les autorités israéliennes supposerait une campagne de plusieurs mois, étendue à la totalité de Gaza. Or, l’armée israélienne ne dispose pas d’une maîtrise totale du temps et la mondialisation du conflit ainsi que la sensibilité des opinions, que l’on peut déjà constater, jouent contre elle. Sa stratégie offensive pèse lourdement sur l'image d'Israël. Le décompte quotidien des pertes civiles à Gaza donné par le Hamas ne peut pas être vérifié, mais les images et les témoignages qui parviennent de l'enclave attestent qu'il y a de très nombreuses victimes, parmi lesquelles 60 journalistes, et de très nombreux enfants. Wassim Nasr journaliste à France 24 et membre du Soufan Center, créé par l’une des figures incontournables de l’anti-terrorisme, estime dans La Vie qu’« en libérant des femmes, des enfants et des personnes âgées, le Hamas renforce son image vis-à-vis d'un public déjà acquis à sa cause dans le monde ». Ainsi, la scénarisation des remises d'otages, pour faire un récit « positif » adapté aux réseaux sociaux, a été immédiate. Le Hamas est donc, pour l'instant, gagnant dans cette grande bataille des perceptions : il dure face à une puissance militaire non négligeable, tandis ajoute le journaliste qu’« une éventuelle victoire militaire d'Israël sera toujours relativisée à cause des milliers de civils tués pour l'obtenir ». *** LES POPULISMES AURONT-ILS L’EUROPE À L’USURE ? Partout en Europe, les partis nationalistes ou d'extrême droite ont le vent en poupe. En Allemagne, Alternative für Deutschland (AfD) a progressé jusqu’à devenir le deuxième parti le plus populaire du pays. Son succès polarise la politique locale, et il pourrait remporter les élections en Thuringe l'an prochain. Le 22 novembre, aux Pays-Bas, le leader du Parti pour la liberté Geert Wilders a enlevé 37 des 150 sièges de la Chambre basse. Une avancée qui renforce le camp des pays menés par l'extrême droite, après celle de Roberto Fico en Slovaquie le 1er octobre. L'année prochaine, l'extrême droite pourrait encore accroître son influence à l'occasion des élections européennes de juin. Les sondages d’opinons n’excluent pas que Marine Le Pen remporte l’élection présidentielle en 2027. Si la plupart de ces partis sont toujours hostiles aux étrangers, l'expérience britannique a tempéré l’hostilité de certains envers l'UE et ils sont moins nombreux à vouloir abandonner la monnaie unique. Tous expriment de nouvelles inquiétudes, rejetant ostensiblement les politiques de lutte contre le changement climatique, qui, affirment-ils, serait une invention des élites. Ensuite, le soutien dont ils bénéficient a évolué. Selon les calculs de The Economist dans 15 des 27 États membres de l'UE existent aujourd'hui des partis d'extrême droite qui obtiennent 20 % ou plus dans les sondages, y compris dans tous les grands pays, sauf l'Espagne, où les nationalistes de Vox ont essuyé une défaite aux élections de juillet. Près des quatre cinquièmes de la population de l'UE vivent désormais dans des pays où l'extrême droite séduit au moins un cinquième de l'électorat. Toutefois, ces partis ont tendance à modérer leurs opinions quand ils sont endossent des responsabilités gouvernementales, comme le prouve Georgia Meloni, la première chef de gouvernement d'extrême droite dans un pays d'Europe occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui n’a pas cherché querelle à l'Europe. Dans les pays nordiques, on constate une tendance similaire. Le Parti des Finlandais et les Démocrates de Suède, deux formations nationalistes, se montrent plus pragmatiques depuis qu'ils ont soit intégré, soit accepté d'épauler une coalition au pouvoir. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 03 Dec 2023 - 1h 07min - 553 - Bada : Laurent de Wilde, pianiste, écrivain et homme de radio (1/5)
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Laurent de Wilde et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 22 septembre 2023. Pour ce nouveau Bada du Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer a eu la joie de recevoir Laurent de Wilde, pianiste de Jazz, compositeur, producteur, écrivain et homme de radio. Dans ce premier épisode, Laurent de Wilde nous parle de son enfance, sa découverte du jazz et ses années d’apprentissage - de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm à New York. Il revient également sur l’évolution de la diffusion du jazz. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 29 Nov 2023 - 17min - 552 - L’obsession allemande du frein à l’endettement va-t-elle plomber l’Europe ? / La société idéale aux yeux des Français
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 24 novembre 2023. Avec cette semaine : - Matthias Fekl, avocat et ancien ministre de l’Intérieur. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. - Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. L’OBSESSION ALLEMANDE DU FREIN À L’ENDETTEMENT VA-T-ELLE PLOMBER L’EUROPE ? Depuis la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine, la crise énergétique et la flambée inflationniste, les règles de la discipline budgétaire régissant la zone euro ont été mises en suspens. Elles seront appliquées à nouveau le 1er janvier prochain. Ces critères de Maastricht, jugés unanimement obsolètes, fixent des seuils de 3 % du PIB maximum pour le déficit et de 60 % pour la dette. Ils resteront d’actualité. Le débat porte sur la façon de revenir à ces critères pour les États qui ne les respectent pas, une majorité parmi les vingt membres de la zone euro. Si Paris soutient la proposition de la Commission européenne en faveur de trajectoires de désendettement à la carte, négociées de gré à gré entre chaque pays et l'exécutif européen, Berlin refuse cette approche trop souple et réclame un ratio commun de désendettement, de 1 % par an pour les États dépassant les 3 % de déficit. La Commission a tenté un compromis en proposant 0,5 %. La dette des pays de l'UE culmine aujourd'hui à près de 150% du PIB en Italie et 110% en France. Si les règles sont rétablies au début de l'an prochain, la France ferait partie des sept pays qui « devraient en théorie se retrouver placés par la Commission sous la procédure de déficit excessif », avec l'Italie, la Belgique, la Slovénie, la Slovaquie ou Malte. En Allemagne, le projet de loi budgétaire adopté le 5 juillet marque le retour de la rigueur. Le ministre libéral des Finances, Christian Lindner, souhaite diminuer de 30 milliards les dépenses publiques et propose de baisser les budgets de tous les ministères, à l'exception de celui de la Défense. L'objectif est de faire passer le déficit budgétaire de l'Allemagne de 4,25 % du PIB à 1,75 %, et le niveau d'endettement du pays de 67,75 % à 66,5 %. Il s’agit de remettre le pays sur la voie du « frein à l'endettement », un concept inscrit dans la Constitution pour limiter le déficit budgétaire. Cette année, le gouvernement allemand tout comme le FMI ou les principaux instituts économiques allemands prévoient une récession de -0,4%. Selon la Commission, dix pays européens devraient être en récession cette année. Outre l’Allemagne, c'est le cas de la Suède, de l'Autriche, de l'Irlande, du Luxembourg, de la République tchèque, de la Hongrie et des trois pays Baltes. Le 15 novembre, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a annulé la deuxième loi de finances rectificative qui comportait 60 Mds d'euros en faveur du climat. Une décision qui prive le gouvernement allemand de toute marge de manœuvre au moment où les 27 doivent débattre, lors du prochain Conseil européen des 14 et 15 décembre, d'une révision, à mi-mandat, du cadre budgétaire européen. La Commission européenne avance que les caisses sont désormais vides. Selon elle, il est impératif de soutenir l'Ukraine de 50 Mds supplémentaires jusqu'en 2027, d'affecter 15 nouveaux Mds aux partenariats extérieurs pour gérer les migrations, de créer un fonds de soutien de 10 Mds aux technologies critiques, de couvrir la hausse des taux du grand emprunt européen et rehausser les traitements des fonctionnaires pour tenir compte de l'inflation. *** LA SOCIÉTÉ IDÉALE AUX YEUX DES FRANÇAIS Ipsos pour la Fondation Jean-Jaurès en partenariat avec la CFDT, a mené en mars 2023, une enquête d’opinion sur « la société idéale de demain aux yeux des Français», publiée ce mois-ci. Société, lieux de vie et mobilités, relations familiales, travail et temps libre, réussite et argent, rythmes de vie, modes de consommation, sont les principaux items. Une majorité écrasante de Français (95 %) exprime un désir de changement de la société actuelle, avec 59 % favorables à une réforme en profondeur ou à une transformation radicale. Ce sentiment transcende les clivages d’âge et de catégorie sociale, bien que les sympathisants de la droite extrémiste soient particulièrement enclins à souhaiter des changements radicaux. Les principaux pôles d’appartenance aux yeux des Français sont la famille (61%), le pays (10%) et les groupes d’amis (4%). Les célébrations traditionnelles jouent un rôle clef dans le renforcement de l’identité nationale. Parallèlement, une courte majorité (53%) valorise la reconnaissance des identités multiples en termes de genre, de religion, d’origine et de sexualité. Si le travail continue de représenter un élément important de la vie des Français, ils souhaitent pouvoir donner leur avis sur son organisation, en particulier afin de pouvoir le concilier plus facilement avec leurs autres activités. Environ 58 % des répondants préfèrent travailler dans une ou deux entreprises tout au long de leur vie professionnelle, indiquant une prédilection pour une carrière stable avec peu de changements. Ils aspirent également à plus d’horizontalité dans la gestion des entreprises. Ils sont 32 % à souhaiter alterner télétravail et présentiel, et 12 % seulement souhaitent ne faire que du télétravail à l'avenir. Six Français sur dix (60 %) estiment que l’écart de salaire mensuel entre la personne la plus pauvre et la plus riche dans une société idéale devrait être au maximum dans un rapport de 1 à 10. Si la démocratie reste le modèle de gouvernance privilégié, ses modalités posent débat : 45 % privilégient la démocratie représentative et 40 % la démocratie directe ou participative. Le rejet de la démocratie reste marginal, avec 7 % préférant un « dirigeant fort » sans contre-pouvoirs. A l’encontre des idées reçues, dans la société idéale, l’information passe par les journaux ou la radio et non par les réseaux sociaux sur lesquels l’invective est facile et l’information jugée pas toujours fiable. Le mode d'achat idéal pour 52 %, c'est l'achat dans des petits commerces spécialisés, puis les grandes surfaces et enfin les plateformes Internet. Les Français privilégient le modèle de « ville nature » et une préférence marquée pour la proximité de services publics essentiels. 56% des répondants privilégient le calme et la tranquillité. 37 % mettent en avant la possibilité d’avoir un espace privé important (comme une surface habitable avec jardin). 36 % apprécient la proximité de la campagne ou des forêts. 32 % valorisent des relations sociales faciles et apaisées entre les habitants. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 26 Nov 2023 - 59min - 551 - Bada : Constance Rivière, haute fonctionnaire, écrivaine et directrice du Palais de la Porte Dorée (3/3)
Pour ce Bada du Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer a eu la joie de recevoir Constance Rivière, haute fonctionnaire, écrivaine et directrice du Palais de la Porte-Dorée. Dans ce troisième et dernier épisode, Constance Rivière nous parle du Palais de la Porte-Dorée qu’elle dirige depuis un an. Elle revient sur la nouvelle exposition permanente du Musée national de l’histoire de l’immigration ainsi que l’aquarium tropical situé au sous-sol du Palais. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 22 Nov 2023 - 18min - 550 - Mélenchon, la gauche et la République / Royaume-Uni : où vont les Conservateurs ?
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 17 novembre 2023. Avec cette semaine : - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - David Djaïz, essayiste, entrepreneur et ancien secrétaire général du Conseil National de la Refondation. - Michel Eltchaninoff, rédacteur en chef du mensuel Philosophie Magazine. - Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef du quotidien La Croix. MÉLENCHON, LA GAUCHE ET LA RÉPUBLIQUE Après l'attaque du Hamas contre Israël, le refus de Jean-Luc Mélenchon de qualifier le Hamas d'organisation terroriste a creusé un peu plus le fossé avec les autres composantes de la Nupes et fracturé son propre parti. Les « frondeurs » du mouvement s’opposent désormais ouvertement à lui tandis qu’un collectif de 420 militants réclame une « refondation du mouvement », en plaidant pour « une VIe République à La France Insoumise ». Les communistes ont tourné la page de la Nupes, suivis par le mouvement Génération Écologie et les socialistes ont déclaré un « moratoire » en attente d'une « clarification ». En matière de politique internationale, tout ou presque oppose LFI aux autres partis de gauche : la Russie et l’Otan, l’Ukraine, la Palestine et Israël, la Chine, le Tibet, Taïwan aussi bien que le soutien mélenchoniste aux dictatures « socialistes » latino-américaines. Alors que LFI est une force eurosceptique, les autres formations sont europhiles (le Parti communiste français est dans une position intermédiaire). Lors de la séquence des retraites, en choisissant une stratégie de l'obstruction à tout débat, Jean-Luc Mélenchon a brusqué le reste de la gauche et une partie du front syndical uni. En septembre 2022, son soutien à son lieutenant Adrien Quatennens, condamné pour violences envers son épouse, avait fait s'interroger de nombreuses personnes, y compris dans son propre camp. La semaine dernière la députée de Seine-Saint-Denis, Raquel Garrido, qui avait accusé Jean-Luc Mélenchon de nuire à LFI, a été suspendue pour quatre mois de son rôle d’oratrice à l’Assemblée nationale. Intransigeant « laïcard » à ses débuts, Jean-Luc Mélenchon, s'est mué en pourfendeur de « l'islamophobie ». Une partie de la classe politique juge qu'il serait sorti du « champ républicain », et trouve des traces d’antisémitisme dans ses innombrables tweets. Pour le politologue Jérôme Fourquet, « comme La France insoumise a fait des quartiers populaires peuplés de descendants de l'immigration son socle électoral, il y a une tentation d'axer sur le civilisationnel, voire le religieux ». Selon un sondage Cevipof-OpinionWay après le premier tour de la présidentielle de 2022, 68 % des Français musulmans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Au sortir de la présidentielle de 2017, il était la personnalité préférée des Français avec 61 % de bonnes opinions selon l'Ifop. Désormais, selon un sondage CSA pour CNews, 71 % des Français voient en lui un « danger pour la démocratie ». L'institut Odoxa qui interroge les Français sur la personnalité qui leur inspire le plus de « rejet », le place aujourd’hui, avec 62 %, comme la personnalité la plus rejetée de France, devant Éric Zemmour. *** ROYAUME-UNI : OÙ VONT LES CONSERVATEURS ? Le parti Conservateur au pouvoir au Royaume-Uni a subi, le 20 octobre, une sévère défaite lors de deux élections partielles face au parti travailliste. Ces deux scrutins se tenaient au moment où la cote du Premier ministre, Rishi Sunak, qui s'efforce de se présenter comme une incarnation du changement bien que son parti soit au pouvoir depuis 13 ans, est au plus bas depuis son arrivée à Downing Street il y a près d'un an. Les sondages récents donnent une avance de 17 à 20 points au Labour. À l’actif du Premier ministre : le rapprochement avec le continent, symbolisé par la signature d’un accord augmenté sur l’Irlande du Nord en février, le ralentissement de l’inflation observé ces derniers mois et la baisse d’un tiers du nombre de traversées de la Manche, en partie grâce à la signature d’un accord de renvoi des Albanais déboutés de l’asile vers leur pays d’origine. La volonté politique de limiter l’immigration se heurte toutefois à la réalité des besoins économiques. En l'occurrence, ceux d'un pays qui connaît de graves pénuries de main-d’œuvre dans des secteurs comme l'agriculture, l'hôtellerie-restauration, le bâtiment, le transport routier, les hôpitaux ou l'aide à domicile. Des métiers boudés par les « White British », occupés par les Polonais, les Roumains et les Bulgares avant que le Brexit les en chasse sans ménagement. L’économie demeure morose et The Guardian dénonce une nouvelle forme de pauvreté, créée par les Tories : l’an passé 3,8 millions de personnes étaient dans la misère au Royaume-Uni, l’équivalent de la moitié de la population de Londres incapable de se nourrir, se vêtir, et se chauffer. Un chiffre qui a doublé au cours de ces cinq dernières années. Le 7 novembre, le gouvernement britannique a dévoilé ses projets pour combattre la criminalité et relancer la croissance économique. Le Premier ministre Rishi Sunak s'est employé à se démarquer du parti travailliste, en misant sur le durcissement des peines pour les auteurs d'infractions violentes et en révisant à la baisse les objectifs du pays en matière de climat, présentés comme un fardeau pour les ménages. Le 13 novembre, le Premier ministre a créé la surprise, en rappelant au gouvernement son prédécesseur David Cameron, l'homme du référendum du Brexit, comme chef de la diplomatie. Attendu depuis des mois, un changement du gouvernement conservateur semblait inéluctable pour renvoyer la très à droite ministre de l'Intérieur Suella Braverman, dont les critiques formulées à l'encontre de la police la semaine dernière ont constitué la provocation de trop. Au Home Office, elle est remplacée par l'ex-chef de la diplomatie James Cleverly, qui devra assumer une politique très restrictive sur le droit d'asile. Mercredi, la Cour suprême britannique a confirmé l'illégalité du projet controversé d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile, d'où qu'ils viennent, arrivés illégalement sur le sol britannique. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 19 Nov 2023 - 1h 05min - 549 - Bada : Constance Rivière, haute fonctionnaire, écrivaine et directrice du Palais de la Porte Dorée (2/3)
Pour ce Bada du Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer a eu la joie de recevoir Constance Rivière, haute fonctionnaire, écrivaine et directrice du Palais de la Porte-Dorée. Dans ce deuxième épisode, Constance Rivière revient sur ses cinq années de secrétaire générale du Défenseur des droits, Jacques Toubon. Elle nous parle également de l’économie du spectacle vivant et l’éducation artistique qu’elle a pu observer de près comme conseillère chargée de la culture au cabinet de François Hollande. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 15 Nov 2023 - 15min - 548 - Projet de loi sur l’immigration / Les élections polonaises
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 10 novembre 2023. Avec cette semaine : - Matthias Fekl, avocat et ancien ministre de l’Intérieur. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. PROJET DE LOI SUR L’IMMIGRATION Promis par Emmanuel Macron durant sa campagne de 2022, présenté le 1er février 2023 en Conseil des ministres, le projet de loi immigration a commencé son parcours au Parlement au Sénat à la mi-mars 2023. Les sénateurs de la commission des Lois avaient alors considérablement durci cette première mouture. Sur fond de grogne sociale sur la réforme des retraites et face à ce détricotage du Sénat, après plusieurs mois d'hésitations, le texte, toujours décrié à gauche comme à droite et contesté par les associations de défense des exilés, a finalement repris lundi au Sénat son parcours parlementaire. En présentant les contours de la loi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en a résumé ainsi l'esprit : « Être méchant avec les méchants, et gentil avec les gentils ». Depuis la Seconde Guerre mondiale, le pays a connu en moyenne une réforme migratoire tous les deux ans. L’actuel projet de loi devrait être le 30ème texte sur l'immigration adopté depuis 1980.La multiplication par trois des flux migratoires en Méditerranée l'an passé, comme le récent attentat terroriste d'Arras ont poussé l'exécutif à légiférer, une fois de plus, cinq ans seulement après la précédente réforme, celle de Gérard Collomb. Le projet de loi visant à « contrôler l'immigration » et à « améliorer l'intégration » vise notamment à : expulser en priorité les étrangers « délinquants », réformer le système d'asile, donner un tour de vis aux dispositifs de santé et de regroupement familial, mais aussi régulariser certains travailleurs sans-papiers… Dans une chambre contrôlée majoritairement par la droite, les sénateurs ont adopté l’instauration de « quotas », avec le principe d’un débat annuel au Parlement pour fixer des plafonds d’immigration pour certains flux ainsi qu’un durcissement des conditions du regroupement familial. Mardi, les centristes et les Républicains se sont accordés, sur la suppression de l'article 3 qui visait à régulariser les sans-papiers dans les métiers en tension. Il s’agissait d’une ligne rouge pour la droite sénatoriale. La suppression de l'article 3 se ferait toutefois en échange de quelques concessions de la part de la droite : si Républicains et centristes se sont accordés sur un nouvel article qui durcit les conditions de régularisation par le travail, ils laissent le pouvoir décisionnaire aux préfets. Les sénateurs LR ont également voté le rétablissement du délit de séjour irrégulier et supprimé l’aide médicale d’Etat (l’AME) remplacée par une aide médicale d’urgence (AMU) plus étroite. Mercredi, ils ont supprimé l’automaticité de l’accès à la nationalité à leur majorité pour les jeunes nés en France de parents étrangers, en exigeant des jeunes qu’ils demandent désormais explicitement à devenir Français pour être naturalisés. Selon une étude Opinionway pour le quotidien Le Parisien, 87% des sondés estiment, qu'il faut changer les règles relatives à l'immigration et le sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro indique que 78 % à se disent « favorables » au texte porté par le ministre de l'Intérieur. Les débats doivent durer jusqu’au 14 novembre, jour du vote solennel. L’Assemblée nationale devrait ensuite examiner le texte en décembre, si le calendrier est maintenu. *** LES ÉLECTIONS POLONAISES En Pologne, l'opposition centriste pro-européenne a remporté la majorité parlementaire aux législatives du 15 octobre, battant les populistes nationalistes, le parti Droit et Justice (PiS), au pouvoir depuis 2015 et l'extrême droite. Les trois partis démocrates, disposent à la Diète d’une majorité de 248 sièges sur 460, et de 66 sur 100 au Sénat. Le chef de la Coalition civique (KO), Donald Tusk, est pressenti pour redevenir Premier ministre, fonction qu’il a déjà occupée entre 2007 et 2014. Il devra faire face à une opposition résolue du parti PiS, fort de 194 élus, ainsi qu’à une cohabitation houleuse avec le président Andrzej Duda (issu du PiS), au moins jusqu’à l’élection présidentielle de 2025. La participation électorale record de 73,9 %, a été permise grâce à une mobilisation des femmes et des jeunes. Leur participation a atteint 68,8 % selon l'institut de sondage Ipsos. La question de l’interdiction de l’avortement par le PiS, et sa politique sociétale très conservatrice, ont été déterminantes pour cet électorat. L'un des premiers défis auquel le nouveau gouvernement sera confronté sera de maintenir ou non le même niveau de dépenses sociales pour les Polonais, pierre angulaire de la politique menée par le PiS. Sur ce plan, la pression du marché, déjà nerveux, mais aussi celle des agences de notation, montent. Si la Bourse de Varsovie et le zloty ont bondi après la victoire de l'opposition, l'UE prévoit un taux d'inflation de 11,4% en 2023, ainsi qu’une croissance faible, de +0,5% du PIB. Toutefois, les marchés comptent sur une détente vis-à-vis de Bruxelles où 36 milliards d'euros destinés à la Pologne sont aujourd'hui gelés, tant que Varsovie ne respecte pas l'indépendance des juges. La Pologne a d’autant plus besoin de cet argent qu'elle a accueilli plus d'un million de réfugiés ukrainiens et qu'elle est en train de moderniser son armée. Dès le 25 octobre, Donald Tusk s’est donc rendu à Bruxelles. La Pologne qui a envoyé des quantités d'armes et d'aide à Kyiv, joue un rôle clé dans le transit pour les approvisionnements occidentaux. Mais la décision de Varsovie d'arrêter les importations de céréales ukrainiennes pour protéger ses propres agriculteurs a irrité l’Ukraine. Varsovie a menacé de restreindre ses livraisons d'armes. Les tensions devraient persister également sur la question migratoire : Tusk a promis à son électorat de ne pas céder sur la relocalisation des migrants européens, l'électorat polonais y restant opposé à 80 %. Le PiS, qui reste numériquement le premier parti du pays, va tout faire pour conserver les postes et l’ossature administrative qu’il a bâtie en huit ans, tandis que le président, Andrzej Duda peut bloquer certaines législations par son veto. La future coalition majoritaire devra concilier de nombreux courants politiques, allant de la droite démocrate-chrétienne à la gauche progressiste et laïque. Elle se heurtera à « l'État profond » installé par le PiS, notamment dans la justice et au Tribunal constitutionnel. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 12 Nov 2023 - 1h 05min - 547 - Bada : Les questions du public (Ukraine et Israël)
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à l’École alsacienne le 5 novembre 2023. Avec cette semaine : - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - François Bujon de l’Estang, ambassadeur de France. - Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. - Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Blick. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 08 Nov 2023 - 36min - 546 - Nouvelle situation sur le front ukrainien / Le gouvernement Netanyahou a-t-il une stratégie au-delà des destructions civiles et militaires ?
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à l’École alsacienne le 5 novembre 2023. Avec cette semaine : - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - François Bujon de l’Estang, ambassadeur de France. - Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. - Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Blick. NOUVELLE SITUATION SUR LE FRONT UKRAINIEN Le 30 octobre, le magazine américain Time a décrit une atmosphère défaitiste à la présidence ukrainienne, entre colère et désillusion face à la baisse de soutien des pays alliés. Time relève les obstacles auxquels fait face Kyiv : front enlisé, difficultés à mobiliser dans l’armée, corruption profonde… Le texte, massivement repris et traduit dans les médias ukrainiens, a été salué pour sa lucidité par une partie de l’opinion du pays, et critiqué par d’autres. Un passage a suscité l'attention : la promesse, évoquée par des conseillers du président Zelinsky, d'un imminent « changement majeur de stratégie militaire » ainsi que d'un remaniement de grande ampleur de l'entourage du président. Deux jours plus tard, l’hebdomadaire britannique The Economist, a publié un entretien particulièrement alarmiste avec le commandant en chef des forces armées, Valeri Zaloujny. A propos de la contre-offensive ukrainienne lancée au début du mois de juin pour récupérer les territoires occupés par la Russie, le général reconnaît un « échec » et la dépeint bloquée dans une « impasse ». Le haut gradé évoque la transformation du front en une guerre de positions, très défavorable à l’Ukraine, qui ne pourra pas tenir en matière de ressources humaines face à la Russie. Le général va jusqu’à évoquer une « défaite » en cas de retard dans les livraisons d’armement, des méthodes et un matériel « dépassés ». Selon lui, aucun des deux camps ne peut avancer car ils sont chacun sur un plan d'égalité technologique. Mais ce bourbier profite à la Russie, qui a augmenté ses capacités de production malgré les fortes sanctions et accru son budget militaire. Pour gagner la guerre, prévient Zaloujny, l'Ukraine doit impérativement jouir de la supériorité dans les airs. Cela implique de bénéficier de F-16 et de drones plus sophistiqués. L'armée doit aussi améliorer ses capacités de guerre électronique et son artillerie de précision avec l'aide de ses alliés. Elle a besoin enfin de moyens de déminage. Surtout, Kyiv doit mobiliser davantage. L'Ukraine, qui dépend des livraisons d'armes occidentales pour son effort de guerre, a dit craindre cet hiver une nouvelle campagne de bombardements russes massifs visant ses infrastructures énergétiques, pour plonger la population dans le noir et le froid. Face à la crainte d'une baisse du soutien occidental, l’Ukraine s'efforce désormais d'attirer les industriels de la défense pour fabriquer armes et munitions sur son sol. Mais depuis la fin de l'été, Kyiv voit se fragiliser la coalition des pays qui la soutiennent. La Slovaquie a déjà stoppé ses livraisons d'armes après l'arrivée au pouvoir du dirigeant populiste prorusse Robert Fico. La Pologne aussi, à la suite d'un différend sur l'exportation des céréales ukrainiennes. La France a averti fin septembre, que ses armes ne seront plus livrées gratuitement à l'Ukraine, sauf exception. Aux États-Unis, le Congrès américain se montre de plus en plus réticent à voter les budgets d'aide militaire à l'Ukraine. De son côté, la Russie a acté fin septembre une hausse considérable de son budget militaire et elle a revendiqué avoir enrôlé 385.000 nouveaux soldats dans son armée depuis le début de l'année, après avoir mobilisé 300.000 réservistes en septembre 2022. *** LE GOUVERNEMENT NETANYAHOU A-T-IL UNE STRATÉGIE AU-DELÀ DES DESTRUCTIONS CIVILES ET MILITAIRES ? A Gaza, les intentions politiques israéliennes restent, pour le moment, confuses : « éliminer » le Hamas pour le ministre de la Défense, Yoav Gallant, ou transformer ses zones d’opération « en ruines » pour le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Sur le statut politique à venir de la bande de Gaza, les positions avancées par les dirigeants de Tel-Aviv sont diverses. « Nous n’avons aucun intérêt à occuper Gaza ou à rester à Gaza », a déclaré l’ambassadeur israélien auprès des Nations unies. Benny Gantz et Gadi Eisenkot, deux leaders de l’opposition, ont rejoint le gouvernement d’unité nationale à la condition que soit formulé un plan opérationnel de sortie de Gaza. Ces derniers jours, des députés du Likoud souhaitaient publiquement une « Nakba 2 » en référence à l’exil forcé de 600 000 à 800 000 Palestiniens en 1948. Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a annoncé une « diminution du territoire de Gaza » après la guerre. De manière générale, le gouvernement de Benyamin Nétanyahou revendique sans s’en cacher une poursuite accrue de la colonisation, voire tout simplement l’annexion de pans des territoires palestiniens. En mars, la ministre des Implantations et des Missions nationales Orit Strock appelait à une recolonisation de Gaza. La Direction de la planification des forces de défense israéliennes a été officiellement chargée de coordonner la stratégie post-guerre. Différentes options sont étudiées : transférer la gestion des Palestiniens de Gaza à l’Égypte ou à des organisations internationales ; réinstaurer à Gaza le pouvoir de l’Autorité palestinienne (très décriée en Cisjordanie) ; déplacer la population vers certaines zones de Gaza, vers le Sinaï ou la Jordanie (ce que refusent en chœur l’Égypte et la Jordanie) ; annexer et contrôler militairement des pans de la bande … A ce jour, titre le Financial Times : “Il n’y a pas de plan pour le jour d’après ». L’historien Yuval Noah Harari estime que « le processus de paix semble désormais enterré pour de bon, à moins que des forces extérieures n'interviennent pour désamorcer la guerre ». Henry Laurens, professeur au Collège de France, en charge de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe en doute : « je ne crois malheureusement pas qu’une intervention extérieure puisse véritablement accélérer le processus de paix : la paix est impossible — au sens où Raymond Aron l’entendait lorsqu’il disait « paix impossible, guerre improbable ». Aujourd’hui on pourrait dire : « paix impossible et guerre certaine ». Nous sommes dans une impasse qui semble devoir perdurer pour une durée indéterminée ». Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 05 Nov 2023 - 1h 10min - 545 - Bada : Constance Rivière, haute fonctionnaire, écrivaine et directrice du Palais de la Porte Dorée (1/3)
Pour ce Bada du Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer a eu la joie de recevoir Constance Rivière, haute fonctionnaire, écrivaine et directrice du Palais de la Porte-Dorée. Dans ce premier épisode, Constance Rivière nous parle de son dernier livre, La vie des Ombres, consacré à l’œuvre de Frederick Wiseman. Elle revient également sur l’importance de son père dans sa découverte du cinéaste. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 01 Nov 2023 - 17min - 544 - L’Argentine entre deux populismes / L’Europe et la sécurité
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le Avec cette semaine : - Nicolas Baverez, essayiste et avocat. - Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique. - Michel Eltchaninoff, rédacteur en chef du mensuel Philosophie Magazine. - Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. L’ARGENTINE ENTRE DEUX POPULISMES En Argentine, alors que tous les sondages donnaient le libertarien Javier Milei vainqueur il a obtenu 30, 2% des voix au premier tour de la présidentielle contre 36,3% à son rival, Sergio Massa, ministre de l’Économie et candidat de la coalition péroniste de gauche sortante Unión por la patria. Alors que voter est obligatoire en Argentine, le scrutin a été marqué par une abstention record : 74 % de participation, en recul de 9 points par rapport à 2019. Pour le deuxième tour, le 19 novembre, les deux hommes se disputeront notamment les voix de la droite traditionnelle, éliminée avec Patricia Bullrich et ses 23,8 %,. L’actuel ministre de l’Économie a pourtant été incapable de juguler une inflation de 140 %, dans un pays où 40 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, où le dollar atteint 1.000 pesos au marché noir et où le PIB perd 3,3 % par an. Pour effectuer sa « remontada » par rapport aux élections primaires d'août qui le donnait deuxième, ( il est passé de 5,3 millions à 9,6 millions de voix), Sergio Massa a annoncé une série de mesures destinées à protéger le pouvoir d'achat des électeurs. Il a mis en place un remboursement de la TVA sur les produits de première nécessité pour les salaires inférieurs à 700.000 pesos par mois (soit six fois le salaire minimum). Il a supprimé l'impôt sur le revenu pour l'immense majorité des travailleurs. Il veut « reconstruire la patrie » grâce à un large programme pour faciliter l'accès à la terre et au logement. Il veut renforcer les entreprises publiques, prône une politique d'adaptation volontariste au réchauffement climatique, et promet une « révolution éducative » dont le contenu reste vague. Sergio Massa se fixe quatre objectifs macroéconomiques : l'ordre fiscal, l'augmentation de l'excédent de la balance commerciale, qui devrait permettre de renflouer la Banque centrale, le développement dans l'inclusion sociale. Enfin, il veut rembourser au plus vite la dette que le pays a contractée auprès du F. M.I. Javier Milei, quant à lui, est un polémiste surgi en 2021 des plateaux TV sur la scène politique, souvent comparé à Donald Trump. Il a depuis suivi un fil rouge « dégagiste » contre la « caste parasite », visant les péronistes (centre-gauche) et les libéraux qui alternent au pouvoir depuis vingt ans. Anti-étatiste, son « plan tronçonneuse » vise à diminuer les dépenses publiques en supprimant plusieurs ministères (Éducation, Santé, Travaux publics et Développement social, Femmes), à libéraliser le port d'armes pour les civils et le commerce d'organes Il entend remplacer la monnaie nationale par le dollar, comme l'ont déjà fait le Panama ou l'Équateur. Mais dans un texte publié début septembre, 170 économistes qualifiaient cette dollarisation de « mirage », en raison du manque de dollars en circulation dans le pays et dans les coffres de la banque centrale. Il est opposé à l'avortement, doute de l'origine humaine du changement climatique, considère l'homosexualité comme un handicap et célèbre Viktor Orbán, Giorgia Meloni et Marine Le Pen. Lundi matin à l'ouverture des marchés, le risque pays, tel que mesuré par JP Morgan, a augmenté de plus de 10 %. *** L’EUROPE ET LA SÉCURITÉ Deux citoyens suédois ont été tués et un autre grièvement blessé à Bruxelles, le 16 octobre, par un homme qui s’est présenté ensuite, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, comme un membre de l’organisation Etat Islamique. L’auteur des faits, Abdesalem Lassoued, un Tunisien de 45 ans sans papiers, a été tué par la police. Le royaume, qui a connu deux attentats meurtriers faisant trente-cinq morts en 2016, compterait aujourd’hui quelque 600 « fichés S » dont la surveillance serait difficilement assurée. L’auteur de l’attentat ne figurait toutefois pas sur les listes de l’Office central d’analyse de la menace, a assuré le ministre de la Justice qui a démissionné. La Sûreté de l’Etat – le service de renseignement intérieur – a appelé récemment à un renforcement de ses moyens dans la lutte contre le terrorisme. Après l’assassinat dans un lycée à Arras du professeur Dominique Bernard et le meurtre des deux touristes suédois à Bruxelles, des aéroports ont été évacués en catastrophe en France, des frontières intérieures se sont fermées... L'Europe fait face à un risque terroriste bien plus important depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Le 19 octobre, à Luxembourg, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont discuté de l'importation du conflit israélo-palestinien et de leurs corollaires, qu'il s'agisse d'antisémitisme ou d'islamophobie. Plusieurs ministres ont appelé à des politiques migratoires plus strictes consistant à mieux filtrer les entrées dans l'Union européenne et à pouvoir renvoyer plus rapidement les demandeurs d'asile qui présentent un risque pour la sécurité. Gérald Darmanin a dénoncé « un peu de naïveté dans les institutions de certains pays ou de l'Union européenne » face à ce qu'il appelle le « djihadisme d'atmosphère ». L'UE dispose désormais d'outils bien plus coercitifs que lorsque la France et la Belgique avaient été frappées en 2015 et en 2016. D’abord le règlement de l'UE adopté en 2021 et mis en œuvre depuis juin 2022 qui oblige les plateformes à supprimer en une heure les contenus terroristes, sur injonction des autorités compétentes des États membres. Mais également, le Digital Service Act, cette loi récente portée par le commissaire français Thierry Breton et qui vise à la modération des contenus diffusés sur internet. La guerre entre le Hamas et Israël, la polarisation croissante observée dans nombre d'États membres et le risque terroriste, conjugués aux importantes arrivées irrégulières dans l'UE, font monter la pression autour du pacte migration et asile, cet ensemble de textes présentés en septembre 2020 et toujours en discussion. Réunis en conseil à Bruxelles, jeudi et vendredi, les Vingt-Sept ont fait le point sur la sécurisation des frontières extérieures de l’UE. Certains États membres ont d'ores et déjà choisi de ne pas attendre davantage. Comme l'Autriche, l'Italie a décidé de réintroduire des contrôles à la frontière avec la Slovénie. Les gouvernements européens craignent une poussée des tensions communautaires à mesure qu’augmentera le nombre de victimes civiles dans la guerre d’Israël contre le Hamas. Dans plusieurs pays, dont la France, les actes antisémites, et, dans une moindre mesure, islamophobes, ont augmenté. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 29 Oct 2023 - 1h 05min - 543 - Bada : Les questions du public (faut-il désespérer de la politique ?)
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à la Fondation Jan Michalski le 12 octobre 2023. Avec cette semaine : - David Djaïz, ancien secrétaire général du Conseil National de la Refondation. - Françoise Fressoz, éditorialiste au journal Le Monde. - Jean-Jacques Roth, ancien directeur du quotidien Le Temps. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 25 Oct 2023 - 41min - 542 - Thématique : faut-il désespérer de la politique ?
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à la Fondation Jan Michalski le 12 octobre 2023. Avec cette semaine : - David Djaïz, ancien secrétaire général du Conseil National de la Refondation. - Françoise Fressoz, éditorialiste au journal Le Monde. - Jean-Jacques Roth, ancien directeur du quotidien Le Temps. Notre temps semble caractérisé par une crise de la politique nationale qui se manifeste pour ainsi par le haut, avec la dilution du pouvoir des États-nations dans la mondialisation, et par le bas, avec la perte de confiance dans le personnel politique et les institutions. À mesure que la mondialisation progresse, les marges de manœuvre des États-nations, par définition localisées, semblent de plus en plus limitées. Contraints de répondre à des enjeux globaux comme le réchauffement climatique, les flux migratoires ou la régulation financière internationale, leurs leviers d’action nationaux paraissent impuissants. Le pouvoir des États-nations est concurrencé par des firmes qui ignorent les frontières ou par des entités supra-étatiques comme la Commission européenne. David Djaïz, vous avez ainsi écrit dans la Revue Esprit que l’État « ressemble de plus en plus à un « sujet passif », partiellement dépossédé de sa souveraineté. » De plus, la dette publique, les taux d'intérêt croissants et les déficits publics élevés limitent les politiques budgétaires. Ainsi cette impuissance manifeste se traduit-elle par un désenchantement, voire un rejet de la politique nationale, auquel s’ajoute une crise de confiance dans les institutions. Cette crise s’illustre par plusieurs types de comportements : l'abstention aux élections, la progression des partis politiques anti-systèmes, la demande de mécanismes de démocratie directe ou la participation à des mouvements de protestation non institutionnalisés. La dernière vague du baromètre de la confiance politique du Cevipof, réalisée entre le 27 janvier et le 17 février 2023, indique qu’en France, la confiance dans les institutions est à son plus bas niveau depuis la crise des Gilets jaunes. Près des deux tiers considèrent que la démocratie ne fonctionne pas bien – 10 points de plus qu’il y a deux ans –, 68 % d’entre eux demandent une plus grande implication de la société civile dans la vie politique et 70 % estiment que les hommes politiques sont principalement préoccupés par leurs intérêts personnels. Face à cette crise multidimensionnelle, diverses propositions émergent pour rééquilibrer la mondialisation et renouveler la confiance dans la politique nationale. L’économiste Dani Rodrik plaide depuis plusieurs années pour que les accords internationaux visent à améliorer le fonctionnement de l'État-nation plutôt qu'à l'affaiblir. Quant à l’adhésion des citoyens, plusieurs réformes institutionnelles sont envisagées en France : revenir au septennat, introduire une dose de proportionnelle aux élections législatives, supprimer l’article 49.3 et donner plus de pouvoir au Parlement, mettre en place des référendums d’initiative citoyenne ou encore une véritable démocratie participative en faisant entrer les citoyens au parlement, comme le proposent une note de Terra Nova. En contrepoint, beaucoup d’observateurs soulignent l'efficacité de la Constitution suisse. Ainsi Giuliano Da Empoli a-t-il loué dans le quotidien Le Temps les vertus d’un système permettant de désamorcer toute déstabilisation forte. Enfin, Dominique Schnapper a fait dans la revue Telos un éloge de la culture du compromis qu’elle nomme également conversation. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 22 Oct 2023 - 54min - 541 - Bada : Les questions du public (attentats du 7 octobre en Israël)
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à l’École alsacienne le 15 octobre 2023. Avec cette semaine : - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - David Djaïz, essayiste et ancien secrétaire général du Conseil National de la Refondation. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 18 Oct 2023 - 34min - 540 - Hamas -Israël un cauchemar à deux faces / Le 7 octobre et la France
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à l’École alsacienne le 15 octobre 2023. Avec cette semaine : - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - David Djaïz, essayiste et ancien secrétaire général du Conseil National de la Refondation. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. HAMAS-ISRAËL, UN CAUCHEMAR À DEUX FACES Pearl Harbour, octobre 1973, 11 septembre israélien, pogrom, razzia… les médias peinent à qualifier les attaques conduites par le Hamas en Israël, le 7 octobre. Les hostilités ont commencé à l’aube par un déluge de roquettes tirées depuis la bande de Gaza, vers les localités israéliennes voisines mais aussi plus en profondeur jusque vers Tel-Aviv et Jérusalem. Profitant de l'effet de surprise, des combattants du Hamas se sont joués de l'imposante barrière de sécurité érigée par Israël autour de la bande de Gaza, attaquant des positions militaires ou des civils en pleine rue. Des actes de sauvagerie ont été commis et filmés. Selon les derniers décomptes quelques 1.300 Israéliens ont été tués et environ 150 binationaux et étrangers, hommes, femmes et enfants, en majorité des civils, sont retenus en otage par le mouvement islamiste. En trente ans, l’État d’Israël a libéré près de 7.000 prisonniers palestiniens pour obtenir en échange la libération de 19 Israéliens et récupérer les corps de huit autres. Les enlèvements actuels placent l’État hébreu dans une position inédite et complexe. Quarante-huit heures après le choc de l’attaque du 7 octobre, Israël a déclenché une offensive militaire de très grande ampleur contre la bande de Gaza, visant à en éradiquer le Hamas. Ses autorités comptaient hier plus de 2 200 morts palestiniens et neuf otages tués dans les bombardements israéliens. Elles ont menacé d’exécuter un otage à chaque fois qu’un civil gazaoui serait tué par une frappe israélienne. L’armée israélienne a demandé aux habitants du nord de la bande de Gaza d’évacuer vers le sud. Comme l'Ukraine, la question palestinienne provoque une vive opposition entre le bloc occidental qui condamne sans réserve les massacres du Hamas et le bloc des pays du Sud, qui oscille, à quelques exceptions près, entre ambiguïté quant aux responsabilités et appel à la désescalade comme le font la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud et soutien clair aux terroristes du Hamas comme l'Iran, l'Algérie, la Tunisie ou le Soudan. Seul dirigeant de l'Otan à ne pas avoir condamné l'attaque menée par le mouvement terroriste, le président turc Erdogan a dénoncé les « méthodes honteuses » d'Israël. Au Liban, des scènes de liesse ont accueilli les attaques du Hamas. Les États-Unis, qui ont déployé en Méditerranée orientale le porte-avions USS Gerald Ford, le plus gros navire de guerre du monde, ont mis en garde lundi le Hezbollah de ne pas ouvrir un “deuxième front” contre Israël. L'Arabie saoudite a suspendu le14 octobre les discussions sur une possible normalisation avec Israël. *** LE 7 OCTOBRE ET LA FRANCE Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, a condamné le 7 octobre sur X, anciennement Twitter, « les attaques terroristes qui frappent Israël ». Parmi les partis d'opposition, la plupart ont manifesté leur soutien à l’État juif. Toutefois, La France insoumise a renvoyé dos à dos le Hamas et Israël, bien que, dès le 7 octobre, quelques voix se soient démarquées comme celles de François Ruffin et d’Alexis Corbière qui ont condamné, sans ambiguïté, l’acte terroriste du Hamas. A gauche de l’extrême gauche, le Nouveau Parti Anticapitaliste NPA a pris parti pour le Hamas. L’attitude des « insoumis » inquiète l’exécutif qui redoute que le conflit ne s’importe en France. Le ministère de l’intérieur rappelle que 10 % de la population se déclare musulmane. Gérald Darmanin avait annoncé, dès le 8 octobre, un renforcement de la sécurité des lieux de culte et établissements scolaires juifs dans plusieurs villes de France. Parlant d’un « djihad d’atmosphère », il a alerté sur l’existence de « relais politiques du Hamas en France ». Depuis samedi, plus de deux cents actes antisémites ont été recensés. Vendredi dernier, Dominique Bernard, professeur de français au lycée Gambetta Carnot d’Arras a été poignardé à mort par un jeune homme fiché S, membre radicalisé de la communauté tchétchène. Trois autres personnes ont été blessées. Dans son allocution télévisée, jeudi soir, Emmanuel Macron avait appelé les Français à rester « unis comme nation et comme République » assurant que « c’est ce bouclier de l’unité qui nous protégera de tous les débordements, de toutes les dérives et de toutes les haines ». Selon un sondage Elabe/BFM 68% des Français pensent que le conflit au Proche-Orient « présente un risque de tensions en France ». Le président de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), Samuel Lejoyeux, estime que « les élus Insoumis comme ceux du RN sont tous deux dangereux pour les juifs de France ». Celui-ci s'appuie sur le baromètre Ifop pour l'UEJF paru en septembre, qui indique que 83% des étudiants de confession juive estiment qu'il existe une montée de violences d'extrême gauche au sein des universités, et 53% concernant les violences d'extrême droite. La France compte à la fois la plus grande communauté juive d'Europe et la plus forte communauté musulmane. Après l’attaque à caractère terroriste qui s’est produite vendredi à Arras la Première ministre, Élisabeth Borne, a décidé d’élever la posture du plan Vigipirate sur l’ensemble du territoire national au niveau « Urgence attentat ». Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 15 Oct 2023 - 1h 02min - 539 - Bada : Hugues Gall, directeur d’opéra (3/3)
Bada #210 / Si c’est pour la Culture, on a déjà donné (102) / 11 octobre 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Hugues Gall et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 23 juin 2023. Entre 1980 et 1995, Hugues Gall a dirigé le Grand Théâtre de Genève, en récompense de quoi la ville lui accorde la Bourgeoisie d’honneur en 1995. Pendant 15 ans, il œuvre au renouvellement du répertoire de l’opéra et à son rayonnement international, donnant à l’établissement de nouvelles lettres de noblesse. A partir de 1995, Hugues Gall prend les rênes de l’Opéra de Paris. Dans cet épisode, notre invité évoque son action sur les liens entre l’institution et l’Etat et la façon dont il est parvenu à intégrer l’Opéra Bastille, alors l’objet de nombreuses critiques, pour former l’établissement prestigieux que nous connaissons aujourd’hui. Succès et compromis, regrets et réussites : l’épisode conclusif de notre supplément consacré à Hugues Gall tire le bilan de ses 30 années passées à la tête des plus grands opéras européens. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 11 Oct 2023 - 30min - 538 - L’impossible sérieux budgétaire / Élections en Slovaquie et extrême-droite européenne
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 6 octobre 2023. Avec cette semaine : - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. - Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Blick. L’IMPOSSIBLE SÉRIEUX BUDGÉTAIRE Le 27 septembre, le gouvernement a présenté à l’Assemblée nationale le projet de loi de finances pour 2024, dont l’adoption permettra à la France de toucher les subsides du plan de relance européen lancé juste après le pic de la pandémie à l'été 2020. Le déficit devrait être réduit de 4,9 à 4,4 %, et la dette dégonfler de 111,8 à 109,7 %... si une croissance de 1,4 % est bien au rendez-vous. Une trajectoire « peu ambitieuse », basée sur des hypothèses de croissance « optimistes », « alors que le consensus des économistes l'estime à 0,8 % et la Banque de France à 0,9 % » a estimé le président du Haut conseil des finances publiques, Pierre Moscovici. Avant le marathon budgétaire de l'automne, l'exécutif a promis de fermer le robinet des aides. Le budget 2024 devait être celui du retour au sérieux budgétaire. Avec des économies de 16 milliards d'euros, le gouvernement annonce une diminution des dépenses de l'État de 5 milliards. Plutôt que des coupes dans les dépenses, la majorité des économies du budget 2024 (14,4 milliards sur 16) proviendra de la non-reconduction des dispositifs de crise : bouclier tarifaire sur le gaz, supprimé au mois de juin, réduction du bouclier sur l’électricité, fin des dispositifs d’aides aux entreprises énergivores. Le reste est obtenu grâce à une diminution de 800 millions des politiques de l’emploi (coûts des contrats des apprentis, emplois aidés…) et à la réforme de l’assurance-chômage, (700 millions). Malgré les promesses de sobriété budgétaire, les dépenses publiques hors mesures exceptionnelles de soutien vont augmenter de 2,2 % l'an prochain. Le retour au sérieux budgétaire maintes fois promis, a été maintes fois reporté. La persistance de l’inflation et la remontée des prix du carburant sont venues percuter les ambitions de Bercy. L’annonce du président de la République de mettre en place une aide de 100 euros pour les automobilistes complique l'équation budgétaire de l'exécutif. Les 25 milliards consacrés à l'indexation des prestations sociales sur la hausse des prix sont désormais mises en avant par le ministre de l’Economie et des Finances. Pour redresser les services publics, Bercy a concédé une hausse de plus de 8.000 fonctionnaires, après une augmentation de 10.790 en 2023. Le budget prévoit également de nombreuses hausses de crédits pour servir les priorités d'Emmanuel Macron : 7 milliards pour la transition climatique, 3,1 milliards pour l'Éducation nationale, et 5 milliards aux ministères régaliens (Justice, Défense, Intérieur). Il faut également amortir le choc de la hausse des taux d'intérêt, avec une charge de la dette grimpant de 10 milliards à 48 milliards. C’est désormais à partir de 2025 que l’exécutif compte s’attaquer aux dépenses « pérennes ». Bruno Le Maire présentera mi-octobre devant l’Assemblée nationale le 49ème budget en déficit du pays. *** ELECTIONS EN SLOVAQUIE ET EXTRÊME DROITE EUROPÉENNE En Slovaquie, l'ancien communiste Robert Fico est arrivé en tête des législatives du 30 septembre. Son parti, le Smer a réuni 23,3 % des suffrages sur une ligne prorusse et eurocritique. Pour former une majorité, il va devoir obtenir le soutien des 27 élus du parti social-démocrate HLAS, arrivé troisième avec 14,7 % des voix, et des dix du parti d'extrême droite prorusse SNS, qui a obtenu 5,6 %. Ces législatives ponctuent un cycle de crises gouvernementales depuis 2020 où trois gouvernements se sont succédé. Ce pays d'Europe centrale de 5,5 millions d'habitants, devenu indépendant en 1993, à la suite d'une séparation pacifique avec la République tchèque, est rongé par les affaires politiques et judiciaires, la corruption, d'importantes inégalités sociales, des services publics exsangues, le chômage, l'inflation ou encore l'exode des jeunes. Déjà deux fois premier ministre (en 2006-2010 puis en 2012-2018) Robert Fico a profité du chaos politique pour revenir sur le devant de la scène au terme d'une campagne fortement influencée par la désinformation en ligne. National-populiste venu de la gauche, Robert Fico, 59 ans, mêle rhétorique anti-Otan, anti-migrants et anti-LGBTQ. La victoire de Fico pourrait signifier la fin de la politique pro-occidentale d'un pays membre de la zone euro et frontalier d'une Ukraine avec laquelle Bratislava s'est toujours montrée très solidaire depuis le début de la guerre. La Slovaquie fait partie des pays qui ont le plus aidé l'Ukraine. Robert Fico a déclaré vouloir arrêter cette aide et s’opposer aux sanctions contre Moscou. Jacques Rupnik, professeur émérite au Ceri-Sciences Po observe qu’« au début du conflit, il y a dix-neuf mois, les pays de l'Est étaient, à l'exception de la Hongrie, les plus mobilisés face au danger russe alors que ceux de l'Ouest semblaient un peu hésitants […] La situation s'est désormais renversée : l'Ouest tient bon, mais des failles apparaissent à l'Est dans chacun des pays, même si les raisons d'un pays l'autre sont différentes ». Tandis qu’en Hongrie, Viktor Orbán, qui a salué « la victoire incontestable » d'un « patriote avec lequel il est toujours bon de travailler », affiche toujours plus ouvertement ses sympathies pro-Poutine, en Bulgarie, une grande partie de l'opinion continue à pencher du côté du grand frère russe, alors qu’en Pologne, une certaine lassitude face à la guerre d'Ukraine monte aussi. Partout dans cette partie de l’Europe, les leaders populistes au pouvoir et ceux qui cherchent à le conquérir usent d'un même narratif expliquant qu'il faut au plus vite arrêter la guerre et que livrer des armes à Kyiv ne ferait que prolonger inutilement le bain de sang. « La guerre pour la Slovaquie est toujours venue de l'Ouest et la paix de l'Est » a déclaré Robert Fico durant sa campagne. Ce narratif plaît aux Slovaques qui, en majorité, estiment que la responsabilité de la guerre revient à l'Occident ou à l'Ukraine. Ils sont à peine 40% à accuser la Russie. Le soutien à l'Otan, en outre, s'érode, passant en un an de 72 % à 58 %. A peine 31 % des Slovaques gardent une opinion favorable à Zelensky. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 08 Oct 2023 - 1h 06min - 537 - Bada : Hugues Gall, directeur d’opéra (2/3)
Bada #209 / Si c’est pour la Culture, on a déjà donné (101) / 4 octobre 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Hugues Gall et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 23 juin 2023. Dans ce deuxième épisode, Hugues Gall raconte ses premiers pas à l’Opéra Garnier et à l’Opéra-Comique. Il assiste Rolf Liebermann, alors en charge de la gestion artistique et financière des deux établissements. Pour celui qui dirigera 10 ans l’Opéra de Paris, c’est une expérience riche et fondatrice : elle lui permet non seulement de comprendre les rouages et les traditions de l’établissement, mais aussi d’apprendre à diriger un Opéra qui traverse alors de nombreuses crises. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 04 Oct 2023 - 25min - 536 - Planification écologique : le chemin des possibles ? / Giorgia Meloni, l’avenir des droites européennes ?
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 29 septembre 2023. Avec cette semaine : - Nicolas Baverez, essayiste et avocat. - François Bujon de l’Estang, ambassadeur de France. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE : LE CHEMIN DES POSSIBLES ? Le Président de la République a présenté lundi les grands axes de sa « planification » pour une écologie « souveraine », « compétitive » et « juste », promettant d'annoncer en octobre une reprise du « contrôle sur notre prix de l'électricité ». Après avoir vanté dimanche soir à la télévision une « écologie à la française », censée répondre à un triple défi, « celui du dérèglement climatique et de ses conséquences, celui d’un effondrement de notre biodiversité et celui (…) de la rareté de nos ressources », le chef de l'État a peaufiné sa vision au terme d'une réunion ministérielle à l'Élysée. Une doctrine où toute idée de contraintes ou de changements sociétaux est repoussée. Concocté depuis quatorze mois à Matignon par le Secrétariat général à la planification écologique, le plan validé lundi comporte une cinquantaine de « leviers », visant à réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici à 2030, mais aussi à lutter contre l'effondrement de la biodiversité. Beaucoup sont déjà connus et certains déjà activés. Emmanuel Macron a fait quelques annonces nouvelles, comme une enveloppe immédiate de 700 millions d'euros de l'État pour bâtir 13 RER métropolitains, soit plus que les dix chantiers envisagés initialement, précisant que ces projets coûteraient au total 10 milliards d'euros. Concernant la voiture électrique, le Président a répété son objectif d'un million de véhicules produits sur le sol français en 2027. A cette date, le pays devrait être exportateur net de batteries grâce aux quatre gigafactories (en français usine géantes) créées dans les Hauts-de-France. Le leasing permettant l’accès à une voiture électrique pour 100 euros par mois sera lancé en novembre et réservé aux véhicules « produits en Europe ». Dans le logement, les chaudières à gaz ne seront pas interdites, on incitera plutôt à leur remplacement en développant une filière industrielle de pompes à chaleur. Dont on espère tripler la production d'ici à la fin du quinquennat. L’idée est d'arriver à un équipement qui soit de 75 à 85% français, contre 50% au mieux aujourd'hui. Sortir du charbon en 2027 et réduire la dépendance aux énergies fossiles de 60 % à 40 % en 2030 offrirait, aux yeux du président ‘opportunité pour la France, « de développer une écologie qui crée de la valeur » dans un pays plus souverain. Dans le même esprit, il veut « lancer un grand inventaire des ressources minières » de notre sous-sol, pour sécuriser notre accès aux matières premières de la transition énergétique comme le cobalt, le lithium ou l'hydrogène naturel. Emmanuel Macronl a réitéré l'idée de convertir en centrales biomasses les deux centrales à charbon qui fonctionnent encore sur le territoire. Il a précisé le calendrier à venir : stratégie biodiversité en octobre, plan d'adaptation en décembre, notamment. Le plan de cette « écologie à la française » doit désormais être décliné dans les collectivités locales. *** GIORGIA MELONI, EUROPÉENNE À L’EXTÉRIEUR, RÉACTIONNAIRE À L’INTÉRIEUR, DESSINE-T-ELLE L’AVENIR DES DROITES EUROPÉENNES ? Le 25 septembre 2022, la leader du parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni remportait les élections législatives. S’inscrivant dans les pas de son prédécesseur, Mario Draghi, la première femme présidente du Conseil italien a surpris à l’extérieur, rassuré les capitales et lissé son image. Elle a tenu les finances publiques, permettant à l'Italie d'emprunter sans mal sur les marchés. Malgré les sympathies pro-Poutine chez ses alliés européens, elle s'est rangée dans le camp atlantiste et derrière l'Ukraine. Tenant son rang dans les organisations internationales, celle qui avait durement bataillé contre l'Europe a su établir des rapports de confiance avec Ursula von der Leyen. La leader romaine renvoie ainsi une image de politicienne pragmatique et mesurée, loin des récits la décrivant comme « post-fasciste » voire « fasciste ». Cette posture lui permet par exemple de mieux négocier les termes du plan de relance européenne qui promet à Rome près de 200 milliards d'euros. En décidant de voter en faveur du compromis sur le nouveau pacte sur la migration et l’asile, Meloni a passé un autre test d’eurocompatibilité. En se concentrant comme elle l’a fait sur des campagnes sur l’identité en Italie, sans les exporter en Europe, la patronne de Fratelli d’Italia a pour l’instant évité de commettre des erreurs et de franchir les lignes rouges de l’UE. Si elle est un exemple pour les droites radicales espagnoles et finlandaises, le RN, notamment, tient à s'en distinguer. Conciliante et alignée sur les positions européennes et occidentales en politique étrangère, la dirigeante d'extrême droite se montre en revanche radicale et identitaire en Italie : son gouvernement a doublé le nombre de centres de permanence pour les expulsions, facilité les procédures de renvoi, entravé le travail des organisations humanitaires en mer Méditerranée. En échec sur la promesse d'enrayer l'arrivée des migrants (il en est arrivé 130.000 cette année en Italie contre 70 000 à la même époque en 2022), elle donne des gages aux plus radicaux en durcissant la législation contre la communauté LGBT : les couples de même sexe n'ont pas accès au mariage, ni à l'adoption, ni à la procréation médicalement assistée. Cet été les parlementaires italiens ont également voté un projet de loi faisant de la gestation pour autrui - interdite en Italie - un « crime universel ». Si elle est approuvée par le Sénat, cette mesure permettrait de punir ceux y ayant recours, d'une peine allant jusqu'à deux ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Pour l'heure, si l'économie ralentit et près de 60 % des Italiens critiquent l'action gouvernementale sur la question migratoire, Giorgia Meloni résiste dans les sondages : avec 28 % d'intentions de vote, Fratelli d'Italia demeure largement le premier parti du pays. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 01 Oct 2023 - 55min - 535 - Bada : Hugues Gall, directeur d’opéra (1/3)
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Hugues Gall et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 23 juin 2023. Le Nouvel Esprit Public a eu l’honneur de recevoir Hugues Gall, qui a été successivement directeur du Grand théâtre de Genève puis de l’Opéra de Paris. Avec Philippe Meyer, notre invité est revenu sur les différentes étapes marquantes d’une carrière dédiée au monde des arts et de la culture. Dans ce premier épisode, notre invité raconte comment, fraîchement diplômé de Sciences Po, il sera propulsé dans le tourbillon des cabinets ministériels et y fera la rencontre décisive d’Edmond Michelet, alors en charge de la Culture. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 27 Sep 2023 - 16min - 534 - L’agression contre le Haut-Karabakh / La France a-t-elle perdu pied en Afrique ?
Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 22 septembre 2023. Avec cette semaine : - Nicolas Baverez, essayiste et avocat. - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - Michel Eltchaninoff, rédacteur en chef du mensuel Philosophie Magazine. - Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. L’AGRESSION CONTRE LE HAUT-KARABAKH L'Azerbaïdjan a lancé le 19 septembre une opération militaire qualifiée par elle « d'antiterroriste » dans le Haut-Karabakh, territoire à majorité arménienne où la souveraineté de l’Azerbaïdjan est aujourd’hui reconnue et où les quelques 120.000 Arméniens qui y vivent jouissent d’une forme d’autonomie. Depuis la dislocation de l’Union soviétique, fin 1991, le Haut-Karabakh est un point de tension quasi constant Deux guerres meurtrières y ont déjà eu lieu, la première en 1988-1994 et la seconde en 2020, à l’issue de laquelle la Russie a déployé des forces chargées de garantir la libre circulation dans le corridor de Latchine, seul axe routier reliant le Haut-Karabakh à l'Arménie. Après une courte période d'accalmie, les tensions ont repris, Bakou menant une guerre d'usure à force de coupures de gaz, d'électricité, de tirs sur les paysans et de kidnappings. Fin 2022, les Azéris ont bloqué la circulation dans le corridor de Latchine. Ce blocus, renforcé en juillet, isole la population arménienne de l’enclave. Il a provoqué ces dernières semaines un début de famine. La Croix-Rouge n’est parvenue que le 18 septembre à faire passer une cargaison de vingt tonnes de farines et de produits médicaux. Les 2.000 soldats russes déployés dans l’enclave après le cessez-le-feu de 2020 et censés assurer la sécurité des Arméniens n’ont pas cherché à empêcher le blocus. Aucun pays ne reconnaît les autorités séparatistes arméniennes du Haut-Karabakh, pas même Erevan, qui les soutient. La première réaction publique du premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a été d'écarter fermement l'option d'une intervention militaire de la République d'Arménie. Il a réaffirmé l'absence de soldats de son pays dans le Haut-Karabakh. Ces déclarations ont provoqué la colère de milliers d'Arméniens, qui sont venus manifester mardi devant le siège du gouvernement, à Erevan, pour affirmer leur solidarité avec les Arméniens du Haut-Karabakh et réclamer la démission de M. Pachinian. Mercredi, après 24 heures sous les frappes, les autorités arméniennes du Haut-Karabakh ont annoncé leur intention de déposer les armes, selon les conditions imposées par l’Azerbaïdjan pour toute négociation de cessez-le-feu. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a confirmé le désarmement des forces du Karabakh ainsi que l'ouverture de négociations en Azerbaïdjan. Les discussions porteront sur la réintégration de la région à population arménienne à l'Azerbaïdjan. L’opération militaire azerbaïdjanaise a fait au moins 200 morts et 400 blessés, d’après le dernier bilan des séparatistes arméniens, alors que 7.000 habitants auraient été évacués. *** LA FRANCE A-T-ELLE PERDU PIED EN AFRIQUE ? Les présidents de l'ex-pré-carré français en Afrique sont renversés les uns après les autres : le malien Ibrahim Boubacar Keita en août 2020, le guinéen Alpha Condé en septembre 2021, le burkinabé Roch Kaboré en janvier 2022, le nigérien Mohamed Bazoum au mois de juillet et fin août, le gabonais Ali Bongo. Dans la foulée de ces coups d’état, la France a dû évacuer ses militaires du Mali (août 2022), puis de Centrafrique (décembre 2022), du Burkina Faso (février 2023) et peut-être bientôt du Niger où elle déploie encore 1.500 militaires. Au Niger, le président français a choisi la fermeté : refus de reconnaître les autorités putschistes, exigence d'un retour au pouvoir du président Bazoum et rejet des injonctions de la junte, qui exige le départ de l'ambassadeur à Niamey et réclame le retrait des militaires français. Un mois après le coup d'État au Niger, la position de la France reste assez isolée. Joe Biden, qui veut sauver sa base militaire au Niger, ne voit pas d'inconvénients à dialoguer avec la junte. Les Allemands se désolidarisent de la position française au Niger, de même que les Italiens en Libye, tandis que les Espagnols reconnaissent le Sahara occidental pour se rapprocher du Maroc. Les pays d'Afrique de l'Ouest renâclent à intervenir militairement. La France est devenue indésirable dans ce qu’elle considérait jadis comme son « pré carré », décriée comme prédatrice économique par toute une génération et comme porteuse de valeurs honnies par des groupes islamistes orthodoxes et radicaux. Marquée du sceau colonial, la France vit d’autant plus mal son éviction de la région, qu’elle a le sentiment de s’être acquittée, à la demande des autorités locales, d’une tâche que les armées africaines ne parvenaient pas à remplir seules : la lutte antiterroriste contre le djihad. Le lent déclin de la présence française sur le continent se constate aussi sur le plan économique. La France n'est plus le premier fournisseur ni le premier investisseur du continent. Si, en valeur, les exportations françaises vers l'Afrique ont fortement augmenté, leur poids relatif a été toutefois divisé par deux, passant de 12 % de part de marché à 5 % entre 2000 et 2021. Pour Antoine Glaser, journaliste spécialiste de l’Afrique, et auteur de l’ouvrage « Le piège africain de Macron » « la France n’a pas vu l’Afrique se mondialiser, ni su solder sa présence post-coloniale, terreau du sentiment anti-français. Depuis la fin de l’opération Barkhane, le leadership français en Afrique est terminé. » Cependant, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna souligne que l’Afrique n’est pas que le Sahel. Elle assure que nos relations se développent avec des États dans lesquels nous étions moins présents, comme le Kenya, l’Afrique du Sud ou l’Éthiopie. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 24 Sep 2023 - 1h 09min - 533 - Bada : Les questions du public (Macron homme-orchestre & Inde) (2/2)
Bada #207 / 20 septembre 2023 Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en Public à l’École alsacienne le 10 septembre 2023. Avec cette semaine : - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. - Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Blick. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 20 Sep 2023 - 20min - 532 - Thématique : le café, avec Jean-Pierre Blanc
n° 315 / 17 septembre 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 19 avril 2023. Avec cette semaine : - Jean-Pierre Blanc, Directeur général de Malongo. - Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique. - Matthias Fekl, avocat et ancien ministre de l’Intérieur. - Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Jean-Pierre Blanc, vous êtes le Directeur général de Malongo, la PME française spécialisée dans l'importation, la torréfaction et la distribution de cafés biologiques et équitables. Vous avez effectué l’intégralité de votre carrière dans cette entreprise, où vous occupez le poste de Directeur général depuis 1980 après avoir été Responsable des ventes pendant 5 ans. Votre dernier ouvrage, « Voyages aux pays du café » a été publié aux éditions Erick Bonnier en novembre 2022. Vous y faites le récit de vos séjours à Cuba, au Laos ou encore au Congo, où vous avez engagé Malongo dans une démarche de commerce équitable afin de soutenir le développement local et la préservation de la biodiversité. Vous y racontez comment vous avez fait, au Mexique, en 1992, la rencontre du Padre Francisco van der Hoff, le cofondateur du premier label de commerce équitable « Max Havelaar ». C’est lui qui vous a convaincu du bien-fondé de ce modèle, fondé sur des partenariats pluriannuels avec des coopératives de petits producteurs qui garantissent des prix rémunérateurs pour les producteurs et valorisent des modes de production respectueux de l’environnement. Malongo est aujourd’hui le premier intervenant des cafés issus du commerce équitable et de l’agriculture biologique. Cette entreprise de torréfaction, fondée à Nice en 1934, emploie près de 400 collaborateurs et génère plus de 110M€ de chiffre d’affaires, selon les chiffres de 2019. 66% de son volume de café importé est certifié « Max Havelaar » et 26% est certifié « agriculture biologique ». L’entreprise travaille avec 16 pays producteurs de café équitable et reverse chaque année aux coopératives plusieurs millions d’euros de primes bio et développement. Plus récemment, Malongo s’est illustré sur un autre segment de l’économie responsable, en relocalisant intégralement la fabrication de sa machine à café à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Le marché de l’alimentation « responsable » subit aujourd’hui les contrecoups de l’envolée des prix à la consommation. Dans sa dernière note de conjoncture en date du 14 avril, l’INSEE relève ainsi que les prix à la consommation ont augmenté, au mois de mars 2023, de 5.7% sur un an. Selon le quatrième baromètre de la transition alimentaire, réalisé par OpinionWay, le prix est devenu le critère prioritaire lors du passage en caisse pour sept Français sur dix. Cela représente une hausse de 7 points en un an et de 10 points en deux ans. Cette tendance concerne cependant moins certains groupes de la population, comme les 18-24 ans qui restent particulièrement sensibles à l’empreinte écologique de leur alimentation. Le modèle du commerce équitable doit également répondre aux critiques sur la multiplication des labels, qui entretient selon ses détracteurs l’opacité sur les cahiers des charges et sur le respect effectif de celui-ci par les producteurs. Certains labels ont été accusés de faciliter le « socialwashing » des entreprises, dans un contexte où le commerce équitable gagne des parts de marché et a franchi la barre des 2 milliards d’euro de vente en France en 2021. Des voix s’élèvent également pour dénoncer l’impact écologique de ce système et privilégient les circuits courts, la production locale et la consommation de saison. Face à ces difficultés, le chercheur à l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) Frédéric Amiel pense que le commerce équitable doit « se repenser » pour « aller plus loin » et propose à cette fin le développement de clauses de « garantie d’achat » améliorant la visibilité à moyen-terme des producteurs et l’assouplissement de la réglementation fiscale sur les produits équitables importés. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 17 Sep 2023 - 59min - 531 - Bada : Les questions du public (Macron homme-orchestre & Inde) (1/2)
Bada #206 / 13 septembre 2023 Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en Public à l’École alsacienne le 10 septembre 2023. Avec cette semaine : - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. - Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Blick. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 13 Sep 2023 - 19min - 530 - Le chef de l’Etat, « homme-orchestre » de la République / G20 versus BRICS, le jeu de l’Inde
N°314 / 10 septembre 2023 Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à l’École alsacienne le 10 septembre 2023. Avec cette semaine : - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. - Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Blick. Le chef de l’État, « Homme-orchestre de la République » Avec la rentrée, le Président de la République se montre sur tous les fronts. Diplomatique, d’abord, avec, du 28 au 30 août, au Quai d’Orsay, la traditionnelle Conférence des ambassadeurs. Dans le quotidien L’Opinion, Jean-Dominique Merchet estime que « loin de se contenter de fixer les grandes lignes de la politique étrangère, le chef de l'État mettra les mains dans le cambouis de tous les détails de l'action extérieure de la France ». Si dans la Ve République, la diplomatie fait partie du domaine réservé du chef de l’État, l'ancien ambassadeur Michel Duclos estime toutefois que « la centralité de la fonction présidentielle dans notre dispositif diplomatique peut devenir une faiblesse, car il n'est pas sain dans le monde complexe actuel que tout repose à ce point sur les épaules d'une seule personnalité. » Dans la foulée, Emmanuel Macron a reçu, le 30 août au soir, avec Élisabeth Borne, les chefs des partis politiques représentés au Parlement, ainsi que les présidents des trois chambres Yaël Braun-Pivet (Assemblée nationale), Gérard Larcher (Sénat) et Thierry Beaudet (Conseil économique, social et environnemental), à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Objectif affiché du Président : trouver des « voies » pour faire « avancer » le pays, en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée. Au menu : « la situation internationale et ses conséquences sur la France », mais aussi « les nuits d’émeutes que nous avons vécues, avec pour objectif de prendre des décisions pour renforcer l’indépendance de notre pays et rebâtir notre nation et tout ce qui la tient : la famille, l’école, le service national universel, la transmission de notre culture, notre langue, la régulation des écrans », ou encore « notre organisation et nos institutions dans tous les territoires ». Après le grand débat, les conventions citoyennes, le Conseil national de la refondation, le Président recourt maintenant à une nouvelle « innovation démocratique ». « C’est le président qui prend le volant, c’est clair et net », note le président de l’Union des démocrates et indépendants (UDI), Hervé Marseille. Le 4 septembre, à l’occasion de la rentrée scolaire, Emmanuel Macron a répondu sur YouTube, aux questions du vidéaste Web Hugo Travers, dit Hugo Décrypte. Troubles dépressifs, urgence climatique, réduction des vacances d’été, harcèlement à l’école, pacte enseignant, coût de la vie, RSA, Restos du cœur… Pendant près de deux heures, le chef de l’État a abordé plusieurs sujets censés préoccuper les moins de 26 ans, en insistant sur ceux qui concernent l’éducation nationale. Le Président assume cette omniprésence. « Compte tenu des enjeux, l’éducation fait partie du domaine réservé du président », justifiait-il dans les colonnes du Point, le 23 août. L’école, « c’est le cœur de la bataille que l’on doit mener, parce que c’est à partir de là que nous rebâtirons la France », insistait-il. Pour autant, son entourage réfute le terme de « super ministre de l’Éducation ». Mais, les médias observent qu’en mettant l'école « au cœur » de son projet, Emmanuel Macron prend directement le dossier en main et se désigne comme le véritable responsable. *** G20 versus BRICS, le jeu de l’Inde Le sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) du 22 au 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud, a été l'occasion d'affirmer une fois de plus leur force de contrepoids à l'influence occidentale. Ce bloc représente plus de 42 % de la population mondiale, 30 % de son territoire, 23 % du PIB mondial et 18 % du commerce mondial. Cependant, seuls 6 % du commerce total s'opèrent entre eux. Créé au départ avec quatre membres en 2009, les BRICS ont été rejoint par l'Afrique du Sud en 2010. Six nouveaux membres ont adhéré cette année : l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Egypte, les Emirats arabes unis, l’Ethiopie et l’Iran. Avec six des dix premiers producteurs de pétrole, les BRICS contrôlent désormais le marché mondial. L'arrivée de ces nouveaux « coffres-forts » qui disposent d'importantes réserves de change s'accompagne de l'entrée en force du monde arabo-musulman, avec l'Egypte et l'Iran. Ces pays ont peu en commun, si ce n'est un objectif prioritaire : le rééquilibrage de l'ordre économique mondial en leur faveur, grâce notamment à la « dédollarisation ». Comme le souligne la déclaration finale du sommet, les BRICS veulent basculer vers plus de paiements en monnaies locales : l'Inde paie déjà le pétrole russe en roupies, la Chine commence à payer le pétrole saoudien en yuans. En présidant cette année le G20, qui rassemble depuis hier à New Delhi les dirigeants des 19 économies les plus développées plus l’Union européenne, l'Inde entend préserver la pertinence du forum, le seul où les pays occidentaux côtoient les pays émergents du Sud. Les sujets ne manquent pas : guerre en Ukraine, lutte contre les effets du changement climatique, sécurité alimentaire, conflits commerciaux, solidarité avec les pays en développement, rivalité technologique avec la montée en puissance des cryptoactifs… L’absence de deux hôtes de marque - le président russe, Vladimir Poutine pour cause de sanctions, et son homologue chinois, Xi Jinping, illustre les tensions entre leurs membres. Après dix-huit mois de guerre, le forum reste profondément divisé au sujet de l’invasion russe. Plusieurs dirigeants des pays émergents sont soucieux, à l’instar de Narendra Modi, le Premier ministre indien, de ne pas choisir leur camp entre Moscou et Kyiv. Tensions également entre la Chine et l'Inde après la publication par Pékin d'une carte revendiquant des terres que l'Inde affirme posséder dans l’Himalaya où des combats ont opposé les deux armées en 2020. Défi de la montée en puissance des BRICS qui comprennent désormais l’Arabie saoudite et l'Argentine. Tout en gardant un œil inquiet sur la Chine, l’Inde navigue entre les Etats-Unis, dont elle s’est rapprochée, la Russie, qui lui est encore très utile, et quelques puissances moyennes. Au non-alignement a succédé à New Delhi le « pluri-alignement » ou « plurilatéralisme ». Celui-ci consiste à préserver la liberté de choix et d’action de l’Inde sur la scène internationale, et donc à démultiplier les relations avec un maximum d’États ou groupes d’États dans le monde, en ne se rendant dépendant d’aucun en particulier et en ignorant autant que possible les rivalités entre eux. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 10 Sep 2023 - 1h 06min - 529 - Bada Si vous l’avez manqué : Sandy Vercruyssen (3/3) « Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte »
Bada # 205 / 6 septembre 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Sandy Vercruyssen et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 1er juillet 2022. Dans ce bada découpé en trois parties, nous discutons avec Sandy Vercruyssen, professeure de français au collège Pablo Neruda à Aulnay-sous-Bois. Elle nous raconte son expérience dans cet établissement en REP+ et les différentes activités culturelles qu’elle a pu mener avec ses classes. Elle évoque ainsi le partenariat de son établissement avec la Comédie-Française, mais aussi les bienfaits de la Cité Educative et les améliorations possibles au Pass Culture. Il s’agit d’un véritable rayon d’espoir dans le pessimisme ambiant qui entoure cette rentrée scolaire et les discours sur l’école. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 06 Sep 2023 - 20min - 528 - Thématique : les droites en Europe, avec Dominique Reynié
N° 313 / 3 septembre 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 16 juin 2023. Avec cette semaine : - Dominique Reynié, enseignant à Sciences Po agrégé de sciences politiques. - Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. LES DROITES EN EUROPE Dominique Reynié, vous êtes Professeur des Universités à Sciences Po et agrégé de sciences politiques. Vous dirigez, depuis 2008, la Fondation pour l’innovation politique, un think tank indépendant et reconnu d’utilité publique qui s’inscrit dans « une perspective libérale, progressiste et européenne ». Vos travaux portent sur les transformations du pouvoir politique, l'opinion publique, les mouvements électoraux, la droite et le populisme. Vous avez dirigé l’ouvrage de la Fondapol intitulé Les droites en Europe. Il retrace la montée en puissance des partis de droite au sein de l’Union européenne dès le milieu des années 1980, dans le contexte de l’effondrement du communisme et de l’épuisement de la social-démocratie. Il montre comment, sous l’effet du vieillissement démographique et de la pression migratoire, les Européens sont devenus de plus en plus soucieux de préserver leur niveau de vie et leur identité, un patrimoine à la fois matériel et culturel. Les mouvements populistes ont très tôt orienté leurs discours et leurs programmes autour de cet « enjeu patrimonial ». Ils ont ainsi opéré une large poussée en Europe dès les années 1990, au point de figurer parmi les principaux adversaires de la droite de gouvernement. Le basculement électoral à droite qui s’opère aujourd’hui en Europe rappelle l’actualité de ces analyses. En mai, en Espagne, les scrutins locaux se sont traduits par un échec sévère pour la gauche, au pouvoir depuis 2018. La droite de gouvernement est sortie gagnante du vote en totalisant plus de 7 millions de suffrages. La formation d’extrême droite Vox a doublé son score en quatre ans et a effectué une poussée spectaculaire dans plusieurs parlements régionaux. En Grèce, le parti conservateur du Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis a remporté une nette victoire en mai dernier. Le nationalisme turc a été renforcé par la réélection récente de Recep Tayyip Erdogan, et une semblable percée électorale de la droite et de l’extrême droite a été observée ces derniers mois en Finlande, en Suède, et en Italie. A partir des résultat des élections européennes de 2019, la Fondapol a calculé que les électeurs de listes de droite représentent en Europe 43.4% des suffrages, soit presque le double des suffrages alloués aux listes de gauche. Dans une autre étude, en 2021, vous montrez la conversion profonde des Européens aux valeurs de droite. Elle est nourrie par trois thèmes particulièrement mobilisateurs : le libéralisme économique, le nationalisme, via la question identitaire, et le libéralisme politique, indexé à l’individualisme. La recomposition politique bat son plein en Europe et interroge la droite sur sa doctrine, son programme de gouvernement et son système d'alliance. Dans divers pays d’Europe, la frontière entre droite et extrême-droite s’efface progressivement. L’Europe hérite de la stratégie « d’union des droites » mise en place par Sylvio Berlusconi dès 1994 avec l’alliance, jusque-là inconcevable, de son parti libéral « Forza Italia », du parti conservateur « Lega Nord » et du parti néofasciste « MSI ». Depuis, la droite radicale a modéré son discours, notamment sur l’Union européenne, et est devenue l’alliée de la droite de gouvernement dans plusieurs pays du Nord de l’Europe, comme la Finlande ou la Suède. En France, seul Éric Zemmour appelle pour l’instant à cette « union des droites ». Mais l’offensive des LR sur l’immigration, qui proposent de modifier la Constitution pour y inscrire « la possibilité de déroger à la primauté du droit européen quand les intérêts fondamentaux de la nation sont en jeu », pourrait accélérer le rapprochement idéologique avec l’extrême-droite. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 03 Sep 2023 - 1h 01min - 527 - Bada Si vous l’avez manqué : Sandy Vercruyssen (2/3) « Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte »
Bada # 204 / 30 août 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Sandy Vercruyssen et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 1er juillet 2022. Dans ce bada découpé en trois parties, nous discutons avec Sandy Vercruyssen, professeure de français au collège Pablo Neruda à Aulnay-sous-Bois. Elle nous raconte son expérience dans cet établissement en REP+ et les différentes activités culturelles qu’elle a pu mener avec ses classes. Elle évoque ainsi le partenariat de son établissement avec la Comédie-Française, mais aussi les bienfaits de la Cité Educative et les améliorations possibles au Pass Culture. Il s’agit d’un véritable rayon d’espoir dans le pessimisme ambiant qui entoure cette rentrée scolaire et les discours sur l’école. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 30 Aug 2023 - 25min - 526 - Thématique (rediffusion) : la psychiatrie dans la cité, avec Raphaël Gaillard
N°312 / 27 août 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, originellement diffusée le 26 juillet 2020. Avec : - Raphaël Gaillard, professeur de psychiatrie à l’Université Paris Descartes et chef de pôle à l’hôpital Sainte-Anne à Paris. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. - Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. LA PSYCHIATRIE DANS LA CITÉ Merci de nous avoir rejoint pour cette discussion en compagnie de Raphaël Gaillard, professeur de psychiatrie à l’Université Paris Descartes et chef de pôle à l’hôpital Sainte-Anne à Paris. Dans une tribune publiée par Le Monde du 1er juillet, l’économiste Jean de Kervasdoué et le psychiatre Daniel Zagury écrivent : « Les partis politiques n’abordent les questions de santé que sous leur aspect économique et financier. Il y a fort à parier que, après le choc de l’épidémie de Covid-19, il ne sera pas dit grand-chose de la santé mentale qui, à notre connaissance, n’est pasà l’agenda du Ségur de la santé lancé le 25 mai. Pourtant, depuis une décennie, la situation est passée de grave à catastrophique. Certes, de tout temps, la folie – terme aujourd’hui refoulé – a dérangé, mais le rejet collectif du différent, de l’anormal dans une société du bien-être n’explique pas à lui seul la persistance du massacre. Certes, la reconnaissance publique par Agnès Buzyn de l’abandon de la psychiatrie a dégagé l’Etat d’une posture perverse de déni, mais, sur le fond, rien n’a changé. » L’institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) a publié en juin une étude consacrée aux effets du confinement sur la santé mentale des Français : un tiers des répondants déclare avoir été en situation de détresse psychologique durant le confinement. La psychiatrie a un rôle important à jouer dans la gestion de l’après-coronavirus mais les décideurs publics se sont, depuis de nombreuses années, détournés du soin des troubles mentaux. Cette spécialité est pourtant un observatoire pertinent de notre société : les troubles qu’elle cherche à soulager sont en effet les conséquences de notre organisation sociale et de ses dysfonctionnements. De plus, elle témoigne de la manière dont la déviance est appréciée dans notre pays. Raphaël Gaillard, en tant que président du Congrès de l’encéphale, , vous êtes auteur de nombreux articles qui permettent de découvrir la gestion de la crise sanitaire de l’intérieur. On peut y lire que la psychiatrie a, une fois encore, été le parent pauvre des politiques menées avec un oubli du GHU Psychiatrie dans la distribution de masques. Celui-ci accueille 70.000 patients par an. Vous livrez également votre vécu de la crise en tant que chef d’un pôle qui compte 600 soignants qui ont dû parfois recourir au système D pour continuer à prodiguer des soins. Par ailleurs, l’observation clinique que vous faite du champ politique dans le cadre de cette vous conduit à remarquer une recherche de coupables qui témoigne de l’impossibilité pour de nombreux citoyens de vivre avec la contingence d’un virus que nous découvrons chaque jour. Cet effritement de la contingence constitue « l’être au monde du paranoïaque », ce qui doit nous interroger. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 27 Aug 2023 - 59min - 525 - Bada Si vous l’avez manqué : Sandy Vercruyssen (1/3) « Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte »
Bada # 203 / 23 août 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Sandy Vercruyssen et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 1er juillet 2022. Dans ce bada découpé en trois parties, nous discutons avec Sandy Vercruyssen, professeure de français au collège Pablo Neruda à Aulnay-sous-Bois. Elle nous raconte son expérience dans cet établissement en REP+ et les différentes activités culturelles qu’elle a pu mener avec ses classes. Elle évoque ainsi le partenariat de son établissement avec la Comédie-Française, mais aussi les bienfaits de la Cité Educative et les améliorations possibles au Pass Culture. Il s’agit d’un véritable rayon d’espoir dans le pessimisme ambiant qui entoure cette rentrée scolaire et les discours sur l’école. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 23 Aug 2023 - 22min - 524 - Thématique (rediffusion) : les pratiques culturelles des Français, avec Loup Wolff
N°311 / 20 août 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, originellement diffusée le 30 août 2020. Avec : - Loup Wolff, qui a dirigé l’étude du ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français. - David Djaïz, essayiste et enseignant à Sciences Po. - Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. POLITIQUE CULTURELLE, PRATIQUES CULTURELLES Loup Wolff, vous avez dirigé pour le ministère de la Culture avec Philippe Lombardo la dernière en date des enquêtes sur les pratiques culturelles des Français. La première remonte à 1973, ce qui donne la possibilité de distinguer les dynamiques à l’œuvre. Votre étude a été réalisée auprès de 9.200 personnes âgées de 15 ans et plus, entre février 2018 et mars 2019. Vous constatez que notre société est de plus en plus culturelle. De nouvelles manières de créer, d'apprécier et de « consommer » la culture s’y développent. Les domaines autrefois réservés aux milieux aisés et diplômés comme la musique ou le cinéma se sont démocratisés pour attirer au quotidien des publics larges, de milieux sociaux, de lieux et d'âges divers. Toutefois, bien davantage que les politiques publiques, c’est l’essor du numérique qui a fait l’essentiel de cette démocratisation, comme il a fait l’essentiel de la réduction des inégalités territoriales. C’est aussi l’essor du numérique qui a fait se développer de nouveaux produits culturels comme le jeu vidéo et c’est lui qui a permis à certains artistes – les rappeurs, par exemple, ou les standupeurs - de contourner les réseaux de diffusion et de distribution et de trouver leur public, le plus souvent un public jeune et de tous les milieux sociaux, tant urbains que ruraux. Ce fort appétit culturel se satisfait pourtant aux dépends de la culture patrimoniale, marginalisée par ces mêmes jeunes. Sa consommation ne participe plus de leur statut social, ils lisent moins, écoutent moins de musique classique, vont moins au théâtre et se détournent des formes de productions moins accessibles et plus exigeantes. Dans les années 1970, un effet de bascule générationnelle à partir duquel les usages classiques des baby boomers ne sont plus repris par les générations suivantes, participe de cette conversion à la culture numérique. L’intérêt constant et croissant des jeunes pour le « tout numérique », pose la question de l’avenir de la culture patrimoniale. Son public, plus aisé et diplômé, plus féminin que masculin, est vieillissant. Ces pratiques nouvelles semblent également se substituer à l'écoute de la radio, à l'usage de la télévision et aux pratiques de sortie. Enfin, les pratiques en amateur s'essoufflent. Pour ne prendre que l’exemple du théâtre, seuls 1% des sondés déclare pratiquer le théâtre en amateurs. Quant aux sorties au théâtre, les trois quarts des 25-39 ans ne s’y sont adonnés que pour aller voir un one-man-show, un spectacle d’improvisation ou de café-théâtre. Si les politiques culturelles ont longtemps pris ces changements à contre-courant pour réorienter les publics vers la culture classique, elles constatent aujourd'hui leurs limites, voire leur échec. Depuis mars, la fermeture des lieux de culture en extérieur a accéléré ce mouvement de transition vers une consommation culturelle de plus en plus numérique. Elle a forcé la production de contenus comme les concerts et les expositions à être compatibles à une diffusion sur la toile, et les normes sanitaires restreignent les formes de créations collectives. S'il est urgent de répondre à la crise économique immédiate du secteur de la culture traditionnelle, la mise en danger de la diversité des expressions par l'omniprésence des acteurs privés multinationaux doit également préoccuper. Leur recherche de profit les amène à avoir une approche uniquement numérique de la qualité des productions, qui contredit la légitimation institutionnelle des arts et appelle à la redéfinition de ses critères. Enfin, ces deux univers culturels du numérique et du patrimonial s'ignorent et lorsque les institutions culturelles traditionnelles se lancent dans le numérique, elles attirent le même public que celui qui les fréquentes déjà. L’État doit-il continuer à concentrer ses efforts vers la culture patrimoniale ou bien épouser la dynamique de numérisation de la culture chez les publics jeunes ? Quels objectifs alors que l’appréciation des œuvres correspond à leur degré de popularité dans le monde numérique tandis que la qualité prime dans l’univers classique ? Comment travailler avec ou concurrencer le secteur privé qui occupe une place de plus en plus grande dans le milieu culturel ? Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 20 Aug 2023 - 1h 01min - 523 - Bada Si vous l’avez manqué : Julien Le Bot : Mark Zuckerberg et l’empire romain
Bada # 202 / 16 août 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Julien Le Bot et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 22 avril 2022. Journaliste et spécialiste des questions numériques, Julien Le Bot a publié en 2019 Dans la tête de Mark Zuckerberg. Préambule à l’émission thématique consacrée au fondateur de Facebook, ce bada évoque l’intérêt de Mark Zuckerberg pour les empereurs romains, pour la psychologie, ainsi que les enjeux auxquels Facebook fait face dans le contexte de la guerre en Ukraine. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 16 Aug 2023 - 16min - 522 - Thématique (rediffusion) : Génération offensée, avec Caroline Fourest
N°310 / 13 août 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, originellement diffusée le 11 avril 2021. Avec : - Caroline Fourest, journaliste, documentariste, autrice de Génération offensée. - David Djaïz, essayiste et enseignant à Sciences Po. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. - Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Blick. - Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. GÉNÉRATION OFFENSÉE : DE LA POLICE DE LA CULTURE À LA POLICE DE LA PENSÉE Caroline Fourest, vous êtes journaliste, essayiste et éditorialiste à Marianne. Depuis de nombreuses années, vous militez en faveur de l'égalité et de la liberté, contre le racisme, le sexisme et l'homophobie. Vous êtes rédactrice en chef de la revue ProChoix que vous avez cofondée en 1997 et qui a pour objet « la défense des liberté individuelles contre toute idéologie dogmatique, liberticide, essentialiste, raciste ou intégriste ». En 2018, après de nombreux documentaires, vous avez réalisé votre premier film de fiction intitulé Soeurs d'Armes. En février 2020, vous avez publié chez Grasset « Génération offensée : de la police de la culture à la police de la pensée ». Vous y alertez contre la montée en France d'une gauche moraliste identitaire déjà très répandue aux Etats-Unis. Sa vision confuse de l'anti-racisme la pousse non pas à réclamer l'éradication des préjugés mais un traitement particulier au nom de l'identité. Reprenant à l'extrême droite les thématiques identitaires, elle la fait se placer en défenseure de la mémoire et de la liberté d'expression. Loin de contester les catégories ethnicisantes de la droite suprémaciste, la gauche identitaire s'y enferme. Au lieu de rechercher la mixité et le métissage, elle fractionne nos vies et nos débats entre « racisés » et « non-racisés », monte les identités les unes contre les autres jusqu'à mettre les minorités en compétition. Vous dites qu'il ne faut pas laisser la critique de cette gauche identitaire à la droite conservatrice mais que seul un antiracisme sincère est à-même de lutter contre ses contradictions. Vous vous revendiquez ainsi d'un antiracisme universaliste et d'une approche par le « droit à l'indifférence », qui permet selon vous d'éviter l'essentialisation des identités et à chacun de s'autodéterminer. Dans cet esprit, vous niez le bien-fondé des usages de plus en plus abusifs du concept d'appropriation culturelle et rappelez que la culture, autant que la politique, ne saurait être quelque chose d'exclusif. C'est au contraire le mélange, la source même de la créativité, qui permet de composer un monde commun. Lieu de liberté, vous dites qu'internet est aussi celui de tous les procès, et dénoncez les tentatives d'intimidations de cette gauche identitaire dans le cadre de phénomènes de meutes 2.0 sur les réseaux sociaux. Surtout, vous alertez contre la démarche de plus en plus victimaire de la jeunesse hyper-sensible d'une société qui ne flatte plus le courage ou l'honneur mais le statut de victime et dont l'université n'éduque plus à l'esprit critique. Cette jeunesse se veut « woke » et éveillée à l'injustice, mais les réseaux sociaux la poussent à décontextualiser ses luttes. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 13 Aug 2023 - 1h 03min - 521 - Bada Si vous l’avez manqué : Bruno Patino : le Métaverse
Bada # 201 / 9 août 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Bruno Patino et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 15 avril 2022. Directeur d’Arte, Bruno Patino a publié La civilisation du poisson rouge puis Tempête dans le bocal chez Grasset. Avant la mise en ligne de l’émission thématique consacrée à son enquête sur la société numérique, ce bada est l’occasion d’aborder les questions du métavers, de la gamification du monde et de la socialisation sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 09 Aug 2023 - 17min - 520 - Thématique (rediffusion) : Molière, avec Georges Forestier
N°309 / 6 août 2023 Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, originellement diffusée le 29 mai 2022. Avec cette semaine : - Georges Forestier, homme de lettres, spécialiste du XVIIème siècle et biographe de Molière. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. MOLIÈRE Georges Forestier, vous êtes agrégé de lettres classiques et docteur d'état, vous avez enseigné au Portugal à Rouen à Reims, à la Sorbonne nouvelle puis à Sorbonne université et vous avez dirigé le centre d'étude de la langue et des littératures françaises. Vous êtes l'inventeur de la génétique théâtrale, sur laquelle vous vous êtes appuyé pour étudier Pierre Corneille puis Jean racine puis Molière. Votre livre sur Molière paru chez Gallimard a reçu un excellent accueil, il a été précédé d’un Molière à Paris, il y a une trentaine d’années et, il y a une dizaine d’années, c’est sous votre direction associée à Claude Bourqui que La Pléiade a publié les œuvres complètes de l’auteur du Tartuffe. De ce Tartuffe, vous avez établi ce que vos recherches vous ont amené à considérer comme la version interdite, une version en trois actes, qui se termine par la victoire de Tartuffe et qui a été représentée cet hiver et ce printemps par la Comédie française dans une mise en scène d’Ivo van Hove donnée pour la première fois le 15 janvier dernier, date anniversaire de la naissance de Molière. Nous en parlerons assurément. Dans le très précieux journal de la littérature en ligne « En attendant Nadeau », Dominique Guy-Blanquet introduit son élogieuse analyse par ce chapô : « Si vous pensez tout savoir de Molière, l'auteur le plus joué en France avant d'être devancé depuis quelques décennies par Shakespeare, détrompez-vous. Georges Forestier rectifie des faits qu'on croyait établis, déplace les projecteurs, tel un éclairagiste judicieux et nous fait découvrir un nouveau Molière au sein du paysage théâtral qu'il a animé : les gazetiers se bousculent pour exploiter son succès, le grand Corneille s'en inquiète, les princes le font jouer à domicile, Boileau l'encourage contre les esprits chagrins, le jeune Racine le salut au lever du roi. » Sans aucun doute, la lecture de votre Molière fait voler en éclats quantité de représentations répandues dans le public depuis sa mort. Sa mort qui n’est pas le sujet de la moindre de ces légendes d’autant plus tenaces qu’elles se nourrissent de clichés sur les artistes maudits, ou en tout cas réprouvés et qu’elles s’en nourrissent en retour. Mais votre livre est aussi un portrait de Paris et de ceux, petits et grands dont Molière reproduira les travers et les qualités, les ridicules et les délicatesses. À une époque où il est fréquent que des comédiens écrivent eux-mêmes les pièces qu’ils jouent, Donneau de Visée remarque que Molière se distingue en faisant « des farces qui réussirent un peu plus que des farces et qui furent un peu plus estimées dans toutes les villes que celles que les autres comédiens jouaient ». Molière fut aussi parmi les premiers à ne pas se contenter d’écrire des farces, de petites pièces comiques en un acte dont les scènes sont à peine ébauchées. Georges Forestier, vous avez, en quelque sorte, dépouillé Molière des différentes couches d’oripeaux dont on l’avait revêtu au fil des 349 ans qui nous séparent de sa mort. Pour introduire notre conversation, j’aimerais savoir ce qui vous a le plus surpris dans vos découvertes. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 06 Aug 2023 - 1h 01min - 519 - Bada Si vous l’avez manqué : Alexandre Gady : le musée du Grand siècle
Bada # 200 / 2 août 2023. Si c’est pour la culture, on a déjà donné, avec ALEXANDRE GADY. Alexandre Gady est historien de l'architecture, professeur à Sorbonne université, directeur du centre André Chastel et président d'honneur de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. Il raconte comment concevoir le musée du Grand Siècle dont il a la charge. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 02 Aug 2023 - 24min - 518 - Thématique : le Conseil National de la Refondation, avec David Djaïz
N°308 / 30 juillet 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 23 juin 2023. Avec cette semaine : - David Djaïz, rapporteur général du Conseil National de la Refondation. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. - Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Blick. LE CONSEIL NATIONAL DE LA REFONDATION David Djaïz, vous êtes haut-fonctionnaire, essayiste, diplômé de l’Ecole Normale Supérieure et de l’ENA. Vous rejoignez en 2017 l’Inspection Générale des Finances avant d’être nommé, en 2021, Directeur de la stratégie et de la formation de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Depuis près d’un an, vous êtes le rapporteur général du Conseil National de la Refondation (CNR) auprès du haut-commissaire au plan, François Bayrou. Le CNR a été créé le 8 septembre 2022 par le Président de la République Emmanuel Macron. C’est une instance de concertation au sein de laquelle citoyens, associations, professionnels et élus sont amenés à échanger et à proposer des solutions sur les grands enjeux de demain. Vous travaillez dans ce cadre sur les 9 thématiques identifiées par le Gouvernement, relatives au plein-emploi, à l'école, à la santé, au logement et aux transitions écologique et démographique. Le CNR se présente d’abord comme « une méthode nouvelle » pour construire les politiques publiques. Il s’agit de répondre au sentiment de mal-être démocratique partagé, selon un sondage de l’IFOP récemment publié, par 64% Français, dont une majorité se déclare favorable à davantage d’inclusion et de participation des citoyens. Ainsi, 76% souhaitent élargir l’usage du référendum, et 66% sont partisans du développement de conventions citoyennes. La « méthode CNR », quant à elle, consiste à associer citoyens, corps intermédiaires et représentants élus à la prise de décisions. Elle souhaite redonner du pouvoir aux acteurs de terrain dans le cadre de concertations locales, les « CNR territoriaux », qui aboutissent à des projets concrets et de petite échelle. L’instance faciliterait les compromis et permettrait de « bâtir du consensus sur la situation de la France et son avenir », selon les mots du Président de la République. A son démarrage, le CNR a cependant été boudé par l’opposition politique et syndicale. Après le RN et LFI, le Président du Sénat Gérard Larcher a décliné l’invitation, craignant que le Parlement ne se fasse « court-circuiter » par cette nouvelle instance. Face à la méfiance des députés et sénateurs, le porte-parole du Gouvernement a dû affirmer que le CNR ne sera « ni un préalable ni un substitut au Parlement », tandis que le haut-commissaire au plan exhortait les députés de la majorité à s’emparer de ce nouvel outil. Depuis son lancement, le CNR a recueilli plus de 100.000 contributions citoyennes dans le cadre de sa consultation nationale en ligne. Plus de 17.000 établissements scolaires sont engagés dans une démarche de concertation locale. 250 CNR ont été tenus dans les établissements de santé et bénéficieront à terme d’un budget de 30 millions d’euros. Enfin, des CNR sur le climat et la biodiversité se déroulent actuellement dans plus de 60 territoires afin d’adapter la transition écologique aux particularités locales. Au niveau national, les conclusions du CNR jeunesse ont été rendues publiques le 21 juin. Elles ont nourri le « plan jeunesse » du Gouvernement, comportant notamment l’abaissement de l’âge légal de conduite à 17 ans, la rénovation de certaines résidences universitaires ou l’évaluation des « savoirs verts » en fin de collège. Quelques mois auparavant, les conclusions du CNR avaient abouti au « plan logement » d’Elisabeth Borne et à la proposition de loi pour le bien vieillir en France, dont l’examen sera bientôt repris par l’Assemblée nationale. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 30 Jul 2023 - 1h 00min - 517 - Bada Si vous l’avez manqué : Alexandre Gady : la défense du patrimoine
Bada # 199 / 26 juillet 2023. Si c’est pour la culture, on a déjà donné, avec ALEXANDRE GADY. Alexandre Gady est historien de l'architecture, professeur à Sorbonne université, directeur du centre André Chastel et président d'honneur de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. Il raconte comment se battre pour la préservation du patrimoine et en quoi consiste l’action de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 26 Jul 2023 - 26min - 516 - Thématique : la gastronomie, avec Jean-Robert Pitte
N° 307 / 23 juillet 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 23 juin 2023. Avec cette semaine : - Jean-Robert Pitte, géographe specialiste des paysages et de la gastronomie. - François Bujon de l’Estang, ambassadeur de France. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. LA GASTRONOMIE Jean-Robert Pitte, vous êtes géographe, professeur émérite et ancien président de l’Université de Paris IV – Sorbonne. Depuis 2008, vous faites partie de l’Académie des sciences morales et politiques, dont vous avez été six ans le secrétaire perpétuel. Spécialiste du paysage et de la gastronomie, vous figurez également parmi les membres de l’Académie du Vin de France. Vous présidez depuis 2008 la Mission pour le Patrimoine alimentaire français. Celle-ci a permis l’inscription, en 2010, du « Repas gastronomique des Français » sur la liste du Patrimoine immatériel de l’UNESCO. La France a en effet cultivé l’art de bien manger et de bien boire tout au long de son histoire, au point d’en faire un élément essentiel de son « art de vivre ». Notre histoire gastronomique remonte aux Gaulois et à leur « art du banquet », alors que les repas offraient l’occasion d'affirmer son rang, sa richesse et son prestige. Le règne personnel de Louis XIV marque un tournant décisif dans la gastronomie française. Elle se démarque du modèle hérité de Rome pour affirmer le pouvoir du Roi sur la haute noblesse et l’éclat de la France en Europe. Les premiers restaurants naissent en France, à Paris, au tournant de la Révolution, ainsi que le terme de « gastronomie » en 1801, sous la plume du poète Joseph Berchoux. Les recettes de terroir intègrent le patrimoine culinaire au cours du XXe siècle et la gastronomie devient un rouage essentiel de l’identification à la nation, à forte dimension politique et géopolitique. Encore aujourd’hui, l’attachement des Français à leur patrimoine culinaire est important. Selon un sondage de l’IFOP en date de 2016, trois quarts d’entre eux déclarent « bien cuisiner » et plus de la moitié des sondés s’essayent au moins une fois par semaine à la préparation de plats qui « sortent de l’ordinaire ». La réputation internationale de la gastronomie française n’est pourtant pas assurée. En 2015, le classement des « 50 meilleurs restaurants » de la revue britannique « Restaurant » ne compte aucun chef français dans le top 10, et seulement 4 parmi les 50. Les critères de ce classement sont vivement critiqués et une liste alternative, créé la même année et fondé sur la compilation de 200 guides nationaux, place la France au deuxième rang mondial, derrière le Japon, un pays que vous connaissez particulièrement bien. En parallèle, de nouvelles cuisines s’affirment sur la scène internationale, parfois soutenues par leur gouvernement dans le cadre d’une politique de « gastro-diplomatie ». Ainsi, le programme « Global Thaï » lancé en 2002 par la Thaïlande a permis de multiplier par trois le nombre de restaurants thaï dans le monde en moins de 20 ans et d’attirer plus de 30 millions de visiteurs dans le pays en 2016. Ces dernières années, les contours du paysage gastronomique mondial ont rapidement évolué sous l’effet de nouveaux enjeux. Avec la mondialisation, les nouvelles tendances culinaires se créent et se diffusent à une vitesse sans précédent mais ne s’intègrent pas toujours avec succès aux cuisines nationales. La montée en puissance de la consommation engagée interroge nos modèles alimentaires tandis que de nouveaux préceptes de santé publique remettent en cause certaines de nos traditions culinaires, comme la consommation de vin. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 23 Jul 2023 - 1h 02min - 515 - Bada Si vous l’avez manqué : Grégoire Ichou, conférencier chantant
Bada # 198 / 19 juillet 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Grégoire Ichou et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 15 décembre 2021. Grégoire Ichou est chanteur lyrique et guide conférencier. Ces compétences jointes lui permettent de proposer deux formats culturels uniques : les conférences-concerts et visites chantées. Les correspondances entre les arts visuels, sonores, littéraires et vivants sont nombreuses, entremêlés ils faciliteraient l’appréhension d’une époque, une œuvre, un contexte en particulier. L’auditoire de Grégoire Ichou à la basilique cathédrale de Saint-Denis, au musée du Louvre ou encore au Théâtre du Châtelet bénéficie ainsi de visites auxquelles se greffent des interprétations de chants tirés de répertoires classiques comme populaires, rattachés tous au lieu, à l’histoire, aux œuvres présentées. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 19 Jul 2023 - 21min - 514 - Thématique : les toilettes publiques, un enjeu de santé, avec Julien Damon
N°306 / 16 juillet 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 30 juin 2023. Avec cette semaine : - Julien Damon, sociologue, enseignant à Sciences Po et à HEC. - Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. - Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. LES COMMODITES URBAINES Julien Damon, vous êtes sociologue, enseignant à Sciences Po et à HEC. Vous venez de publier, aux Presses de SciencesPo, un essai intitulé « Toilettes publiques » où vous réhabilitez dans le débat public, avec science et humour, ces lieux auxquels nous consacrons en moyenne 6 mois de notre vie. Alors que les toilettes publiques se raréfient dans les villes et qu’une partie d’entre elles sont devenus payantes, vous défendez l’idée d’un « droit aux toilettes » qui garantisse à tous l’accès à des commodités gratuites, propres et sécurisées. Cette question est essentielle pour les sans-abris, mais elle concerne plus largement chacun des usagers de la ville, habitué ou de passage, lors ses mobilités quotidiennes. Pour relever ce défi, vous proposez notamment de rémunérer les bars, cafés, restaurants et fast-foods mettant à disposition leurs toilettes gratuitement et de façon indifférenciée, sur le modèle de l’Allemagne ou du Royaume-Uni. Le « droit aux toilettes » suppose par ailleurs de garantir un accès égal aux commodités pour les hommes et pour les femmes, qui y passent en moyenne une minute de plus. Il implique également de considérer l’offre sanitaire de l’ensemble des espaces collectifs, comme les entreprises ou les écoles, alors qu’un sondage de l’IFOP en date d’avril 2022 indique que 55% des employés jugent les toilettes de leurs entreprises sales et que 45% d’entre eux les trouvent trop peu éloignées du reste des locaux. A l’échelle internationale, le sujet est porté par l’ONU qui a fait de l’accès à l’eau et à l’assainissement un droit de l’homme en 2010. Des progrès notables en matière d’installations sanitaires ont été observés depuis 20 ans, tirés notamment par les « plans toilette » de la Chine et de l’Inde. Ainsi, si environ un tiers de l’humanité ne disposait d’aucun assainissement basique en 2015, la proportion est descendue à un humain sur cinq en 2020. Ces investissements sont particulièrement rentables car ils diminuent les frais de santé, limitent les hospitalisations, réduisent le nombre de jours non travaillés, améliorent les capacités des enfants à l’école et la productivité des travailleurs. Mais d’importantes lacunes persistent dans certaines régions et plombent les perspectives de développement économique et social. A titre d’exemple, plus de la moitié des établissements en Afrique subsaharienne ne disposent d’aucune installation sanitaire. Cette carence pénalise particulièrement les filles et compte parmi les raisons de leur sous-scolarisation persistante. Il ne s’agit pourtant pas seulement d’augmenter l’offre de toilettes publiques, mais aussi de repenser son modèle : au XXIème siècle, la croissance mondiale des toilettes doit être « durable ». Le modèle occidental, fondé sur les toilettes à chasses connectés à des réseaux centralisés d’assainissement, est très gourmand en eau. L’ensemble des Français destinent à cet usage l’équivalent de 500.000 piscines olympiques chaque année. De nombreux modèles plus écologiques ont été proposés, le plus souvent décentralisés, fondés sur le recyclage des eaux plutôt que sur leur évacuation. Des urinoirs secs, les « uritrottoirs », ont même été installés à Paris à l’été 2018 ; mais l’expérience s’est rapidement soldée par un échec, qui montre la force des habitudes en la matière et l’ampleur des travaux à accomplir. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 16 Jul 2023 - 1h 00min - 513 - Bada Si vous l’avez manqué : Nieves Salzmann, régisseuse plateau au Théâtre-Français et peintre
Bada # 197 / 12 juillet 2023. SI C’EST POUR LA CULTURE, ON A DÉJÀ DONNÉ (20)…Avec Nieves Salzmann, régisseure générale à la Comédie française. Peintre, scénographe, créatrice lumière, Nieves a multiplié les expériences artistiques avant d’être chargée, dans la plus ancienne institution théâtrale de France, de veiller à la totalité d'un spectacle, aujourd’hui, Le Bourgeois gentilhomme, mis en scène par Christian Hecq et Valérie Lesort. L’exemple de ce travail encore en chantier donne à comprendre la richesse et la diversité d’un métier essentiel à la réussite d’un spectacle. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 12 Jul 2023 - 28min - 512 - Thématique : les pays Baltes, avec Yves Plasseraud
N°305 / 9 juillet 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 9 juin 2023. Avec cette semaine : - Yves Plasseraud, juriste et spécialiste des États baltes. - Nicolas Baverez, essayiste et avocat. - François Bujon de l’Estang, ambassadeur de France. - Michel Eltchaninoff, rédacteur en chef du mensuel Philosophie Magazine. LES PAYS BALTES Yves Plasseraud, vous êtes juriste et présidez depuis 1996 le Groupement pour le droit des minorités, ONG qui bénéficie d’un statut consultatif auprès des Nations unies, de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. Vous êtes un spécialiste des pays baltes et avez récemment publié deux ouvrages sur cette région du monde, qui regroupe l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Dans Les pays baltiques - Le pluriculturalisme en héritage, paru en 2020, vous montrez comment l’histoire de ces pays est marquée par la menace constante de puissances impériales comme l’Allemagne ou la Russie, ainsi que par la diversité de leurs peuples et de leurs cultures. Vous avez également consacré, en 2022, un ouvrage aux peuples Germano-Baltes, nés au XIII° siècle des migrations de colons allemands à Riga, l’actuelle capitale de la Lettonie. Les pays baltes regroupent aujourd’hui plus de 6 millions d’habitants et représentent un PIB d’approximativement 120 Mds€. Bordés par la mer Baltique à l'ouest, ils s’étendent sur 175 000 km2 et partagent leurs frontières avec la Russie, la Biélorussie et la Pologne. A mi-chemin entre la Russie et l’Europe de l’Ouest, ils constituent une interface stratégique entre l’Orient et l’Occident, au cœur des enjeux géopolitiques et militaires contemporains. L’héritage soviétique pèse lourd dans ces anciennes Républiques socialistes soviétiques, territoire convoité par la Russie depuis Pierre le Grand pour son ouverture sur la mer Baltique. Avant l’invasion de l’Ukraine, la Fédération de Russie était l’un des principaux partenaires commerciaux de la région. Il lui fournissait également l’essentiel de son approvisionnement en gaz naturel, à hauteur de 42% en Lituanie, de 93% en Estonie et 100% en Lettonie. Les russophones constituent une importante minorité au sein des Pays Baltes et représentent jusqu’à 30% de la population en Lettonie. La mémoire de l’annexion russe, enfin, reste problématique, comme l’illustre la récente loi sur la destruction des monuments soviétiques promulguées par l’Estonie en début d’année. Pour se prémunir des menaces russes, les pays baltes ont choisi l’ancrage à l’Ouest. Ils ont adhéré à l’Union européenne en 2004, marquant la réussite de la transition démocratique et économique accomplie depuis 1991. La même année, les États baltes rejoignent l’OTAN. L’Alliance implante dès 2008 son centre de cyberdéfense à Tallin, à la suite de la cyberattaque de l’Estonie dirigée par le Kremlin une année auparavant. A la suite du sommet de 2016, à Varsovie, des troupes permanentes sont déployées par l’OTAN dans les Pays baltes dès 2017, ainsi que des forces navales et aériennes en mer Baltique. L’invasion de l’Ukraine par la Russie projette les Pays Baltes au cœur des enjeux de défense du monde occidental. Ces États, qui ont mis en garde l’UE contre la menace russe dès 2004, s’inquiètent d’être les prochaines cibles de Vladimir Poutine. Le corridor de Suwalki, qui permet aux Russes de desservir leur enclave européenne de Kaliningrad par la Biélorussie et comporte depuis 2016 des batteries de missile à capacité nucléaire, est au centre des tensions. Une crise avait même éclaté en juin 2022, à la suite de la décision de la Lituanie de restreindre le transit de marchandises par voie ferrée vers l’enclave russe, en accord avec les sanctions européennes. Dans ce contexte explosif, le prochain sommet de l’OTAN se tiendra en juillet à Vilnius, capitale de la Lituanie. Il y sera notamment question de la mise en place de nouveaux plans de défense pour la région baltique, mais aussi de l’adhésion de la Suède, candidate fortement soutenue par les Etats baltes. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 09 Jul 2023 - 57min - 511 - Bada : Les questions du public à Alain Aspect, prix Nobel de physique (2/2)
Bada # 196 / 5 juillet 2023 Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à l’École alsacienne le 25 juin 2023. Avec cette semaine : - Alain Aspect, physicien, spécialiste de l’optique quantique et récipiendaire du prix Nobel de physique. - Sven Ortoli, journaliste scientifique. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 05 Jul 2023 - 23min - 510 - La Russie après la marche de Wagner / Mayotte
N°304 / 2 juillet 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 30 juin 2023. Avec cette semaine : - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. - Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. LA RUSSIE APRÈS LA MARCHE DE WAGNER La prise de la grande base arrière russe de l'opération militaire en Ukraine, à Rostov-sur-le-Don, par les 5.000 mercenaires du groupe paramilitaire privé Wagner d’Evgueni Prigojine, a été réalisée sans le moindre coup de feu. Le lancement d’un raid armé vers Moscou ne s'est arrêté qu'à 200 kilomètres de la capitale et n'a été entravé par aucune force militaire substantielle. Juste avant de se lancer dans sa marche forcée Prigojine a brisé le tabou du mensonge, révélant que les généraux russes (et donc Poutine) avaient menti sur la guerre, sur les pertes humaines, les territoires reconquis par les Ukrainiens et même sur les buts de guerre, qu’il a déclarés « infondés ». Construisant son empire médiatique et industriel à visage couvert, niant le moindre lien avec la milice Wagner spécialisée dans la guerre hybride, déployée là où la Russie défend ses intérêts sans vouloir apparaître - Ukraine, Syrie, Libye, République centrafricaine, Mali - Progojine n’a reconnu en être le créateur qu’en septembre 2022. Après l’avoir utilisé, puis l'avoir laissé recruter des prisonniers de droit commun ayant commis des crimes de sang, sans la moindre base légale, l'armée russe a interdit ces pratiques pour les reprendre à son compte. Une compétition avec Wagner s'est ensuite engagée, alors même que les deux forces faisaient face à la contre-offensive ukrainienne. Tandis que Prigojine insultait le commandement militaire russe pour son incompétence et appelait à sa démission, ses troupes ont été privées de vivres et de munitions. L’armée russe a demandé à intégrer la milice. L’incursion des groupes armés en provenance d’Ukraine dans la région de Belgorod, l’attaque de drones à Moscou puis l’avancée de Wagner vers la capitale ont posé la question de la capacité de l’Etat russe à défendre son territoire. Cependant, l’élite politique a fait corps : toute la journée du samedi, députés, gouverneurs ou élus locaux ont diffusé des messages de soutien au président. Lundi, sans le nommer, Vladimir Poutine a qualifié Evgueni Prigojine de « traître » − une désignation qui vaut en théorie condamnation à mort. Au lieu de cela, dans la soirée le chef du Kremlin a offert à Prigojine des garanties de sécurité. Il a réaffirmé que ces combattants - ayant joué un rôle essentiel dans la guerre en Ukraine - ne feraient l'objet d'aucune poursuite. Ils pourront, au choix, signer un contrat avec le ministère de la Défense pour intégrer l'armée régulière russe, rentrer chez eux, ou rejoindre la Biélorussie, où doit s'exiler Prigojine. Lundi, l’homme d’affaires a réaffirmé que le but de sa « marche » n’était pas « la prise du pouvoir », mais seulement « d’empêcher le démantèlement » de Wagner. Certes, il « regrette » la mort de militaires russes. Mais M. Prigojine continue de se présenter en chef du groupe et assure qu’Alexandre Loukachenko, le président de la Biélorussie, lui aurait proposé une solution permettant « la poursuite du travail dans un cadre légal ». Lundi, le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a assuré que la société allait « poursuivre » son travail en Afrique et ailleurs. *** MAYOTTE A Mayotte, 101e département français, marqué par de récurrents épisodes de violences et de tensions sociales, l'opération Wuambushu ("reprise en main") a été lancée le 24 avril. Il s’agit selon le ministre de l’Intérieur et des outre-mer de lutter contre la délinquance et l’insécurité, en détruisant certains bidonvilles et en expulsant des étrangers en situation irrégulière, principalement des Comoriens. Les autorités ont l'intention d'expulser entre 10.000 et 20.000 sans-papiers : Mayotte compte 310.000 habitants, dont on estime que la moitié sont étrangers. L’opération s’est rapidement heurtée à deux obstacles majeurs : le refus des Comores voisines d'accueillir leurs ressortissants expulsés, et les multiples recours judiciaires déposés par des familles de clandestins. Dès le deuxième jour, l'opération était suspendue par le tribunal judiciairequi considérait la démolition des bidonvilles « illégale », avant que le tribunal administratif de Mayotte ne tranche finalement en faveur de l'État. Plus de 400 policiers et gendarmes supplémentaires sont sur l'île, portant à 1.800 les effectifs des forces de l'ordre présents sur place. Malgré la multiplication des « plans » pour Mayotte, les services publics dans l’île sont en déshérence : pas assez d’écoles pour scolariser tous les enfants (6.000 à 7.000 enfants sont déscolarisés) ; peu d’accès à la santé, et un manque flagrant de personnels soignants ; l’accès à l’eau potable est une problématique majeure marquée par des coupures d’eau quatre fois par semaine. La situation de mal-logement est massive : 57 % des ménages vivent en surpeuplement, 40 % des logements sont en tôle, 30 % des logements ne sont pas raccordés à l’eau, 10 % n’ont pas l’électricité. « Musulmane à 95 % », Mayotte a voté à 59,10 % pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle de 2022. Les 24 et 25 juin, deux mois après le début de l’opération, le ministre de l’intérieur a effectué un déplacement pour défendre un premier bilan de l’opération soutenue localement, mais dénoncée par plusieurs associations, dont la Cimade et Médecins du monde, comme « tout sécuritaire ». Gérald Darmanin a précisé que l'intervention sera rallongée de « plus d'un mois » puis qu'un « deuxième type d'opération » débuterait en septembre, ciblant, par des procédures judiciaires, l'agriculture et la pêche illégales, ainsi que les marchands de sommeil. Il a affirmé qu'en deux mois, « les violences contre les personnes ont été réduites de 22 % » et les cambriolages, vols et atteintes aux biens, « de 28 % », revendiquant aussi avoir « divisé par trois le flux entrant de clandestins ». Le dernier objectif de « Wuambushu », la lutte contre la criminalité, pose des problèmes de surpopulation carcérale : dans l'unique prison de l'île le taux d'occupation est passé à 230 %. La construction d’une nouvelle prison et d’un nouveau centre de rétention est envisagée, mais aucun terrain n’a encore été identifié pour les bâtir. Le ministre a promis de « revenir en septembre prochain ». Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 02 Jul 2023 - 1h 05min - 509 - Bada : Les questions du public à Alain Aspect, prix Nobel de physique (1/2)
Bada # 195 / 28 juin 2023 Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à l’École alsacienne le 25 juin 2023. Avec cette semaine : - Alain Aspect, physicien, spécialiste de l’optique quantique et récipiendaire du prix Nobel de physique. - Sven Ortoli, journaliste scientifique. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 28 Jun 2023 - 25min - 508 - Thématique : la physique quantique, avec Alain Aspect
N°303 / 25 juin 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée en public à l’École alsacienne le 25 juin 2023. Avec cette semaine : - Alain Aspect, physicien, spécialiste de l’optique quantique et récipiendaire du prix Nobel de physique. - Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors. - Sven Ortoli, journaliste scientifique. - Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 25 Jun 2023 - 59min - 507 - Bada : Brigitte Lefèvre, danseuse et chorégraphe (4/4)
Bada # 194 : Si c’est pour la Culture, on a déjà donné (99) / 21 juin 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une conversation entre Brigitte Lefèvre et Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 21 avril 2023. Elle a été tour à tour danseuse, chorégraphe, directrice adjointe de l’opéra Garnier puis directrice de la Danse de l’Opéra de Paris : tout au long de sa vie, Brigitte Lefèvre n’aura eu de cesse de se consacrer à sa passion, la danse. Le parcours de Brigitte Lefèvre est intimement lié à l’Opéra de Paris, où elle entre 8 ans et dont elle dirige le Ballet entre 1995 et 2014. Elle nomme, au cours de cette période, plus d’une dizaine d’étoiles et intègre de nouvelles chorégraphies au répertoire du Ballet, comme les œuvres contemporaines « Glacial Decoy » de Trisha Brown et « Rain » d’Anne Teresa de Keersmaeker. Sa longévité exceptionnelle à la direction de la danse lui a permis d’exercer une influence considérable sur l’histoire contemporaine de l’Opéra. Invitée du Nouvel Esprit Public, Brigitte Lefèvre retrace les grandes étapes de son parcours et discute les nouveaux défis de l’Opéra de Paris. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Wed, 21 Jun 2023 - 20min - 506 - Les déserts médicaux / Le sommet du triangle de Weimar
N°302 / 18 juin 2023. Connaissez-vous notre site ? www.lenouvelespritpublic.fr Une émission de Philippe Meyer, enregistrée au studio l’Arrière-boutique le 16 juin 2023. Avec cette semaine : - Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef du quotidien La Croix. - Béatrice Giblin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique. - Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. - Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. LES DÉSERTS MÉDICAUX Un Français sur dix, plus de six millions de personnes n'a pas de généraliste à proximité de chez lui, alors que la population vieillit. En 10 ans, le nombre de généralistes a baissé de 3%. Ils sont 53.000 en exercice, un sur quatre est en âge de partir à la retraite. Pour deux médecins sur le départ, un seul peut prendre le relais. Selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publiée le 25 mai, les deux tiers des médecins généralistes déclarent désormais refuser des patients comme médecin traitant, contre 53 % en 2019. Huit médecins sur dix jugent que les médecins ne sont pas assez nombreux sur leurs zones géographiques respectives, soit 11 points de plus qu'en 2019. Durant les « trente glorieuses », le nombre de médecins explosait. Avec le choc pétrolier et le ralentissement de l’activité économique, les dépenses de santé sont alors jugées dispendieuses et les pouvoirs publics mettent en place la contrainte du numerus clausus. Mécaniquement, au début des années 2000, le nombre de médecins n’augmente qu’à la marge, diminuant même dans les rangs des généralistes, tandis qu’en parallèle les besoins ne cessent d’augmenter, avec une population qui vieillit et une demande de soins en hausse. Depuis les années 2000, chaque ministre a fait son plan : des aides, des bourses, des incitations, des soutiens… la panoplie des outils incitatifs n'a pas marché. Aucun n’a mis en place de régulation ou de coercition. Face à ce problème, l'Assemblée nationale a lancé lundi l'examen d'un texte de la majorité sur l'accès aux soins. Dans son préambule, il est indiqué que « 87 % du territoire est un désert médical, résultat d'une longue fragilisation du système de santé et d'aspirations professionnelles des nouvelles générations jusqu'à présent mal anticipées ». La loi devrait notamment permettre de simplifier l'exercice des « praticiens diplômés hors de l'UE » et de s'opposer à l'intérim médical dans certains établissements en début de carrière, ou encore élargir le nombre d'étudiants pouvant signer des « Contrats d'engagement de service public » avec une allocation mensuelle versée en contrepartie d'un engagement dans un désert médical. Sous la pression de l'exécutif, une mesure a été supprimée : la régulation de l'installation des médecins censée lutter contre les déserts médicaux. Le ministre de la Santé, François Braun « reste opposé à la coercition à l’installation. » Considérant la mesure comme un « levier » indispensable, le député socialiste Guillaume Garot a décidé de déposer un amendement pour la réintégrer, soulignant qu’« il y a aujourd'hui trois fois plus de généralistes par habitant dans les Hautes-Alpes que dans l'Eure, 18 fois plus d'ophtalmos par habitant à Paris que dans la Creuse, et 23 fois plus de dermatos dans la capitale que dans la Nièvre ». Après l’Assemblée nationale, le texte partira ensuite au Sénat, où la majorité Les Républicains, opposée à cet amendement comme d'ailleurs à l'ensemble du texte, pourra apporter des modifications. Déjà, trois syndicats de médecins hospitaliers appellent à une « journée de grève et d'action le 4 juillet ». *** LE SOMMET DU TRIANGLE DE WEIMAR Dans une intervention le 31 mai devant le think tank Globsec à Bratislava, en Slovaquie, le président français a assuré que la France apportait clairement son soutien à l'option d'une Ukraine ayant à terme sa place dans l'Alliance atlantique et devant bénéficier « de garanties de sécurité crédibles et tangibles ». Il a également plaidé pour élargir « le plus vite possible » l’édifice bâti par les Vingt-Sept. Une façon d’envoyer un signal fort aux Etats d’Europe centrale les plus pressés d’accueillir Kyiv et Chișinău. Après quelques hésitations, Paris propose désormais d’ouvrir les négociations avec les deux pays candidats, dès la fin de l’année. En rejetant toute idée de cessez-le-feu ou de conflit gelé, le président contribue à clarifier le débat, rejoignant la position des Européens de l'Est. « Nous avons perdu une occasion de vous écouter », leur a-t-il dit à Bratislava. Le lendemain, les représentants des 47 pays composant la Communauté politique européenne (CPE) se sont réunis à Chișinău, en Moldavie. Née de la guerre en Ukraine pour donner une perspective à Kyiv, la CPE rassemble des États souverains qui, parce qu’ils habitent le même continent, font face à des problématiques communes, en matière sécuritaire ou énergétique, notamment. Emmanuel Macron, avait, le 9 mai 2022, lancé l’idée de cette Communauté politique européenne, arguant que « l’UE ne peut pas être le seul moyen de structurer le continent ». Au sein de ce nouveau club, tous les Etats sont sur un pied d’égalité. Sur la question européenne, Emmanuel Macron a réitéré sa position d’ouverture à l’élargissement, appelant l'UE à repenser sa gouvernance et à « inventer plusieurs formats » pour répondre aux aspirations d'adhésion de pays d'Europe de l'Est et des Balkans. L'élargissement de l'UE a été de nouveau au menu d'un dîner de travail entre le président et Olaf Scholz, le 6 juin, à Potsdam, destiné à préparer la visite d'État d’Emmanuel Macron en Allemagne, début juillet. Le chancelier se montre très prudent. « Les conditions pour l'adhésion sont les mêmes pour tous » répond Olaf Scholz, qui refuse d'évoquer le moindre passe-droit susceptible de favoriser l'Ukraine par rapport aux autres pays candidats. Lors d'un dîner de travail lundi à l'Elysée dans le cadre du Triangle de Weimar, les présidents français et polonais et le chancelier allemand ont discuté de l'aide militaire et des garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine. Le format dit de Weimar est une plateforme d'échanges réguliers entre Paris, Berlin et Varsovie, fondée en 1991, deux ans après la chute du mur de Berlin. Emmanuel Macron a confirmé que la contre-offensive de l'armée ukrainienne contre les forces russes avait commencé, estimant qu'elle allait durer « plusieurs semaines, voire mois », il a ajouté « nous avons intensifié les livraisons d'armes et de munitions, de véhicules blindés, de soutien aussi logistique ». La réunion visait à coordonner les positions des trois pays en amont du sommet de l'Otan à Vilnius, les 11 et 12 juillet, et du Conseil européen des 29 et 30 juin. Chaque semaine, Philippe Meyer anime une conversation d’analyse politique, argumentée et courtoise, sur des thèmes nationaux et internationaux liés à l’actualité. Pour en savoir plus : www.lenouvelespritpublic.fr
Sun, 18 Jun 2023 - 1h 00min
Podcasts similar to Le Nouvel Esprit Public
 El Partidazo de COPE COPE
El Partidazo de COPE COPE Herrera en COPE COPE
Herrera en COPE COPE The Dan Bongino Show Cumulus Podcast Network | Dan Bongino
The Dan Bongino Show Cumulus Podcast Network | Dan Bongino Es la Mañana de Federico esRadio
Es la Mañana de Federico esRadio La Noche de Dieter esRadio
La Noche de Dieter esRadio Affaires étrangères France Culture
Affaires étrangères France Culture A voix nue France Culture
A voix nue France Culture Les Nuits de France Culture France Culture
Les Nuits de France Culture France Culture Répliques France Culture
Répliques France Culture Dateline NBC NBC News
Dateline NBC NBC News Más de uno OndaCero
Más de uno OndaCero La Zanzara Radio 24
La Zanzara Radio 24 L'Heure Du Crime RTL
L'Heure Du Crime RTL El Larguero SER Podcast
El Larguero SER Podcast Nadie Sabe Nada SER Podcast
Nadie Sabe Nada SER Podcast SER Historia SER Podcast
SER Historia SER Podcast Todo Concostrina SER Podcast
Todo Concostrina SER Podcast 安住紳一郎の日曜天国 TBS RADIO
安住紳一郎の日曜天国 TBS RADIO![アンガールズのジャンピン[オールナイトニッポンPODCAST]](https://cdn.podcasts-online.org/static/main/images/podcast-default.png) アンガールズのジャンピン[オールナイトニッポンPODCAST] ニッポン放送
アンガールズのジャンピン[オールナイトニッポンPODCAST] ニッポン放送 辛坊治郎 ズーム そこまで言うか! ニッポン放送
辛坊治郎 ズーム そこまで言うか! ニッポン放送 飯田浩司のOK! Cozy up! Podcast ニッポン放送
飯田浩司のOK! Cozy up! Podcast ニッポン放送 武田鉄矢・今朝の三枚おろし 文化放送PodcastQR
武田鉄矢・今朝の三枚おろし 文化放送PodcastQR
Other News & Politics Podcasts
 Les Grosses Têtes RTL
Les Grosses Têtes RTL Hondelatte Raconte - Christophe Hondelatte Europe 1
Hondelatte Raconte - Christophe Hondelatte Europe 1 L'œil de Philippe Caverivière RTL
L'œil de Philippe Caverivière RTL C dans l'air France Télévisions
C dans l'air France Télévisions Laurent Gerra RTL
Laurent Gerra RTL Enquêtes criminelles RTL
Enquêtes criminelles RTL Bercoff dans tous ses états Sud Radio
Bercoff dans tous ses états Sud Radio Hondelatte Raconte - Cote B Europe 1
Hondelatte Raconte - Cote B Europe 1 L’heure du crime : les archives de Jacques Pradel RTL
L’heure du crime : les archives de Jacques Pradel RTL Les récits de Stéphane Bern Europe 1
Les récits de Stéphane Bern Europe 1 Global News Podcast BBC World Service
Global News Podcast BBC World Service LEGEND Guillaume Pley
LEGEND Guillaume Pley C ce soir France Télévisions
C ce soir France Télévisions L'Heure des Pros CNEWS
L'Heure des Pros CNEWS RTL Matin RTL
RTL Matin RTL Le grand rendez-vous Europe 1
Le grand rendez-vous Europe 1 TOCSIN PODCAST TOCSIN MÉDIA
TOCSIN PODCAST TOCSIN MÉDIA Gaspard Proust - Les signatures d'Europe 1 Europe 1
Gaspard Proust - Les signatures d'Europe 1 Europe 1 Lenglet-Co and You RTL
Lenglet-Co and You RTL Culture médias - Thomas Isle Europe 1
Culture médias - Thomas Isle Europe 1









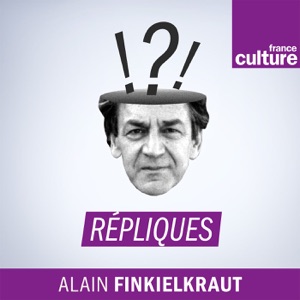









![アンガールズのジャンピン[オールナイトニッポンPODCAST]](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Podcasts126/v4/a3/d0/03/a3d0036b-fb99-56ad-928e-2fdabbea43b6/mza_8898289893618631728.jpg/300x300bb.jpg)